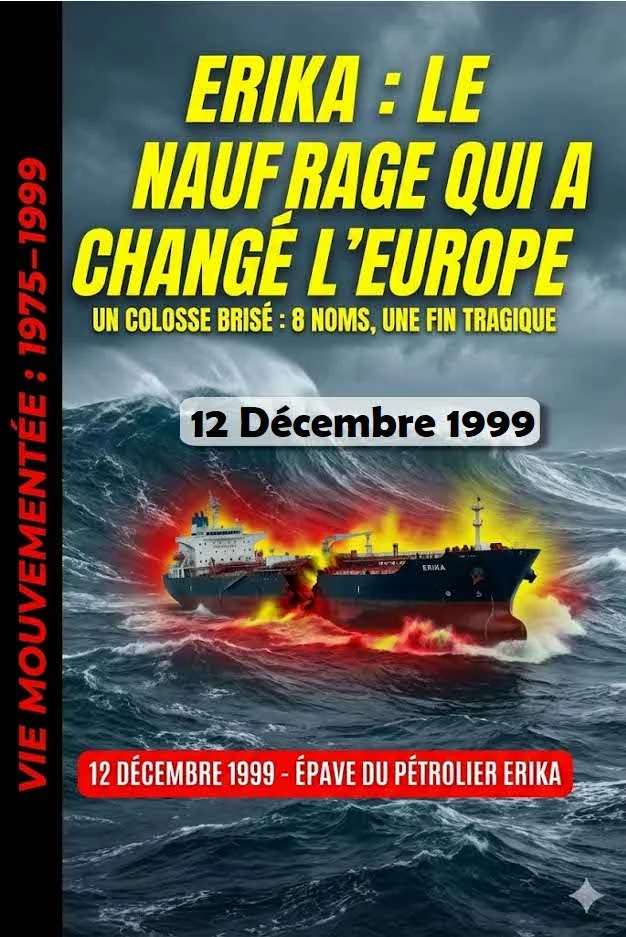Des documents pour approfondir la réflexion :
Le Grand Tremblement de terre du Kantô :
Version Papier : https://amzn.to/3JTWeYw
Version Ebook : https://amzn.to/3HY4zd4
Le Grand Séisme de Kantō : Une Catastrophe Dévastatrice aux Répercussions Profondes au Japon 🇯🇵
Le 1er septembre 1923, le Japon fut le théâtre d’une catastrophe naturelle d’une ampleur sans précédent dans son histoire moderne : le Grand Séisme de Kantō. Cette secousse tellurique, dont l’impact fut ressenti avec une violence inouïe dans la plaine du Kantō, sur l’île principale de Honshū, a non seulement remodelé le paysage physique de la région, mais a également laissé une marque indélébile sur la société japonaise, déclenchant des vagues de destruction, de violence et, finalement, de résilience et de reconstruction. Cet article se propose de détailler les circonstances de cet événement tragique, ses conséquences immédiates et à long terme, ainsi que les leçons tirées qui continuent de façonner la politique de prévention des catastrophes au Japon.
🕰️ Le Jour du Cataclysme : 1er Septembre 1923
Le tremblement de terre, connu sous le nom de Kantō daishinsai (関東大震災), s’est produit précisément le 1er septembre 1923, à 11h58 du matin. Ce moment précis, juste avant midi, fut particulièrement funeste, car il correspondait à l’heure où de nombreux foyers s’apprêtaient à préparer le déjeuner. La secousse frappa la vaste région du Kantō, alors peuplée d’environ 8 millions d’habitants.
L’estimation ultérieure de la magnitude de moment de ce séisme a été fixée à 7,9 en 1977. Une telle magnitude indique une libération d’énergie considérable, et l’impact sur le sol fut direct et puissant. Le tremblement de terre ne se contenta pas de secouer la terre, il entraîna également une élévation de la région d’environ 1 cm.
🌪️ Un Contexte Géologique Complexe et Explosif
La région du Kantō se situe dans un contexte géologique particulièrement mouvementé et complexe, caractérisé par la rencontre de quatre plaques tectoniques distinctes. Il s’agit de la plaque pacifique, de la plaque philippine, de la plaque eurasienne et de la plaque nord-américaine. Cette convergence de forces sismiques est rendue encore plus critique par la présence de deux jonctions triples situées à moins de 200 km l’une de l’autre.
Le séisme de Kantō s’est précisément manifesté sur la zone de subduction qui relie ces deux points triples. Il s’agit spécifiquement de la fosse de Sagami, une zone où la plaque philippine s’enfonce sous la plaque nord-américaine. Cette subduction est à l’origine des contraintes géologiques qui, une fois libérées, provoquent de violents tremblements de terre.
Les scientifiques ont tenté de modéliser avec précision la géométrie du plan de faille responsable de ce séisme. Bien que cette géométrie ne soit pas définie avec une certitude absolue, diverses études ont proposé des modèles variant en complexité, allant d’un seul segment de faille à deux, voire trois, pour expliquer l’ensemble des mouvements du sol qui ont été observés (grâce à des observations géodésiques). Ce que l’on sait, c’est que la faille plonge vers le nord-nord-est avec un pendage d’environ 27° par rapport à l’horizontale. Le mouvement sur le plan de faille était inverse, accompagné d’une composante décrochante dextre. La segmentation de la faille à son extrémité ouest pourrait être due à une courbure éventuelle du plan de faille.
Ces dynamiques tectoniques ont également engendré d’importants changements dans la topographie du terrain, avec des zones qui se sont surélevées et d’autres qui se sont affaissées.
🔥 La Dévastation par le Feu : Un Brasier Infernale
Bien que la magnitude du séisme ait été considérable, la majeure partie des décès et des destructions ne fut pas directement causée par les secousses terrestres, mais par les nombreux incendies que le tremblement de terre a engendrés. Le contexte urbain de l’époque était propice à une catastrophe de cette ampleur : un habitat dense et très majoritairement construit en bois.
Le moment de la secousse, juste avant le déjeuner, a été un facteur aggravant majeur. De nombreux foyers avaient alors leurs réchauds ou braseros allumés. Le tremblement de terre les a violemment renversés, propageant immédiatement des flammes aux matériaux hautement inflammables présents dans les maisons traditionnelles japonaises, comme les tatamis en paille de riz et les cloisons et parois légères des habitations en bois qui s’étaient effondrées.
Très rapidement après la secousse initiale, un nombre colossal d’incendies ont éclaté dans l’agglomération de Tokyo, s’étendant de Chiba jusqu’à Yokohama. La propagation de ces feux fut dramatiquement accélérée par des vents forts provenant d’un typhon qui se trouvait à proximité de la péninsule de Noto. Le météorologue japonais Sakuhei Fujiwhara (1884-1950) a d’ailleurs mené une étude approfondie sur les conditions météorologiques qui ont contribué à cette propagation fulgurante.
D’autres facteurs ont accentué l’ampleur des incendies : la densité urbaine et l’absence regrettable de planification urbaine intégrant des zones coupe-feux. Pour couronner le tout, le tremblement de terre avait détruit les accès à l’eau, rendant la tâche des pompiers quasi impossible. Il fallut deux jours entiers pour éteindre tous les feux.
🏙️ Villes Rasées : Tokyo et Yokohama
Les conséquences de ces incendies furent catastrophiques pour les grandes villes de la plaine du Kantō. Tokyo, la capitale, fut détruite à 70 %. Yokohama, une ville portuaire majeure, subit un sort encore plus tragique, étant détruite à 85 %. Des bâtiments emblématiques, comme le Ryōunkaku, furent entièrement détruits par le séisme et les incendies qui suivirent.
💔 Un Bilan Humain et Matériel Tragique
Le séisme de Kantō reste à ce jour la catastrophe naturelle la plus meurtrière du Japon. Les chiffres exacts varient légèrement selon les sources et les périodes d’évaluation, mais tous convergent vers un bilan humain effroyable.
Le rapport officiel japonais, publié le 30 août 1926, fit état de 91 344 morts. Ce rapport soulignait que l’immense majorité de ces décès, 83 %, étaient dus aux incendies. En plus des morts, le rapport recensait 50 000 blessés graves et 13 000 disparus. Quant aux destructions matérielles, plus de 3,4 millions de bâtiments auraient été détruits ou endommagés.
D’autres estimations peignent un tableau encore plus sombre :
- Le volcanologue américain Thomas Jaggar, dans un article de 1924, avançait le chiffre terrifiant de 400 000 morts.
- Une étude plus récente, réalisée en 2004 par le centre de recherche Kajima Kobori, estime le nombre de personnes tuées ou portées disparues à 105 385.
- Cette même étude chiffrait à plus de 570 000 le nombre de maisons détruites, laissant environ 1,9 million de sans-abris.
Dans le district de Honjo, plusieurs sources mentionnent la mort d’une foule de 32 000 personnes prise au piège par le feu. Au-delà des dégâts directs, la panique générale qui s’est emparée des populations a également coûté la vie à de nombreuses victimes.
Les dommages économiques furent colossaux. Ils ont été estimés à plus d’un milliard de dollars américains aux valeurs contemporaines. Thomas Jaggar, quant à lui, estimait les dommages à un montant stupéfiant de 4,5 milliards de dollars de l’époque. Cette catastrophe a donc eu un impact économique dévastateur sur un pays déjà en pleine transformation.
👥 La Face Sombre : Violences et Rumeurs Post-Séisme
Au-delà de la destruction physique et des pertes humaines directes, le séisme de Kantō a révélé une facette sombre de la société, marquée par le chaos, la panique et des violences tragiques, alimentées par de fausses rumeurs.
📢 La Propagation des Rumeurs : Le Poison de la Panique
Le tremblement de terre, par son ampleur et la désorganisation qu’il a engendrée, a créé un terreau fertile pour le développement de nombreuses rumeurs infondées. Certains journaux japonais de l’époque ont malheureusement contribué à ce climat anxiogène en diffusant des informations extravagantes, voire exagérées. On rapportait, par exemple, l’annihilation complète de Tokyo, l’enfoncement de la totalité de la plaine du Kantō dans la mer, la destruction de l’archipel d’Izu par des éruptions volcaniques, ou encore l’apparition d’un tsunami gigantesque atteignant le mont Akagi, pourtant situé au centre du pays. Ces récits, loin de rassurer, ont exacerbé la peur et la suspicion.
🇰🇷 Cibles des Violences : Les Coréens, les Chinois et les Militants Politiques
Dans ce climat d’extrême panique, une rumeur particulièrement pernicieuse se répandit, accusant les Coréens résidant au Japon de profiter de la catastrophe pour piller et rançonner, d’empoisonner les puits et d’allumer des incendies. La présence de nombreux feux partout dans les villes, dont l’origine était pourtant naturelle (les réchauds renversés), a paradoxalement renforcé ces rumeurs insidieuses.
Dès le lendemain du séisme, le ministère de l’Intérieur a imposé la loi martiale et a envoyé une directive à chaque ville, demandant de « prendre les mesures appropriées » contre les « Coréens rebelles », avec le concours de la population. Cette incitation officielle a eu des conséquences dramatiques. Des groupes d’autodéfense japonais se sont formés, parfois soutenus par la police et l’armée, et certains d’entre eux ont commis des massacres visant les Coréens.
Pour identifier leurs cibles, ces groupes utilisèrent des shibboleths, des mots dont la prononciation correcte était censée distinguer les Japonais des Coréens. Des barrages étaient mis en place où l’on demandait de prononcer des mots comme jū-go-en, go-jus-sen (15円 50銭?) et gagigugego (がぎぐげご?). Ceux qui ne les prononçaient pas correctement, souvent en raison d’un accent différent, étaient battus, voire tués. Ce procédé barbare a malheureusement conduit à l’identification erronée et à la mort de nombreux Chinois, Okinawais, ou même des Japonais originaires d’autres régions.
En plus des violences ethniques, la panique a été exploitée pour des motifs politiques. La police militaire japonaise (Kenpeitai) et la police politique (Tokkō) ont profité de ce chaos pour commettre des assassinats politiques, ciblant spécifiquement les socialistes, les anarchistes et les syndicalistes. Parmi les victimes célèbres, on compte Noe Itō, un épisode connu sous le nom d’incident d’Amakasu. Dans le quartier ouvrier de Kameido, dix syndicalistes, dont Hirasawa Keishichi, furent exécutés au cours de l’incident de Kameido.
⚖️ Les Chiffres et la Mémoire des Victimes des Violences
Les estimations officielles de l’époque concernant les victimes de ces violences étaient bien en deçà de la réalité. Les autorités japonaises de l’époque ont officiellement avancé le chiffre de 231 Coréens, 3 Chinois et 56 Japonais (incluant les Okinawais) tués. Cependant, une étude gouvernementale de 2009 a très nettement revu ce nombre à la hausse, faisant état de 2 600 à 6 600 victimes coréennes, ainsi que de plusieurs centaines de Chinois et également des militants politiques japonais.
Quant aux auteurs de ces violences, 362 civils japonais furent arrêtés et condamnés. La plupart d’entre eux bénéficièrent de peines légères, et une partie fut même libérée de prison lors des grâces liées au mariage du Prince Hirohito.
La mémoire de ces massacres est un sujet sensible au Japon. Des révisionnistes japonais tentent encore aujourd’hui d’atténuer, voire d’effacer le souvenir de ces lynchages. Ce n’est qu’en 1973 qu’une stèle fut érigée en mémoire des Coréens assassinés, près du mémorial construit pour les victimes du séisme. Chaque 1er septembre, des associations se recueillent en ce lieu, mais cet hommage est parfois source de heurts avec des mouvements d’extrême droite qui nient la réalité du massacre. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, proche du Parti libéral-démocrate (PLD au pouvoir), a également refusé de prendre part à ces commémorations.
🏗️ La Reconstruction et les Leçons pour l’Avenir
Face à une telle dévastation, la tâche de la reconstruction était immense. Le gouvernement japonais fit appel à Gotō Shinpei, nommé ministre de l’Intérieur, pour organiser cette entreprise titanesque. La destruction massive des villes a paradoxalement stimulé urbanistes et architectes, qui ont proposé dans diverses revues de nombreux plans de reconstruction.
Gotō Shinpei proposa un plan ambitieux pour Tokyo, visant à transformer la ville en une métropole moderne et plus sûre. Ce plan prévoyait le tracé de larges avenues, l’aménagement de voies circulaires, la construction de ponts anti-sismiques et la création de grands parcs dans la ville. Une attention particulière fut portée aux écoles, pour lesquelles il était prévu un espace ouvert servant à la fois de cour de récréation, de terrain de sports et, en cas de catastrophe, de zone refuge.
Cependant, l’ampleur des indemnisations à prévoir pour les personnes qui auraient dû être expropriées, l’opposition farouche des associations de commerçants, et le fait que de nombreux Tokyoïtes avaient déjà commencé à reconstruire leurs maisons et refusaient d’être déplacés, obligèrent le gouvernement à revoir ce plan ambitieux à la baisse.
Malgré ces contraintes, le plan de reconstruction a tout de même permis des avancées significatives. Il a notamment favorisé la construction des premiers habitats en dur à loyer modéré. Surtout, le séisme de Kantō a eu un impact majeur sur la communication et la gestion des crises : il a accéléré la création de la chaîne publique de radio NHK et le déploiement de la TSF (télégraphie sans fil), dans le but explicite de lutter contre la propagation des fausses rumeurs qui avaient suivi le séisme. Le Japon a ainsi pris conscience de l’importance cruciale d’avoir accès à des informations fiables lors des catastrophes naturelles.
Les instructions à suivre lors d’un tremblement de terre au Japon recommandent depuis lors de se procurer des informations fiables grâce à la radio et de ne pas écouter les rumeurs. En reconnaissance de l’impact profond de cette catastrophe, le 1er septembre fut désigné en 1960 comme le « Jour de la prévention des désastres ». Cette journée commémore le tremblement de terre et rappelle aux citoyens l’importance de se préparer aux catastrophes, d’autant plus que les mois de septembre et octobre sont au milieu de la saison des typhons.
Le Grand Séisme de Kantō de 1923 reste un jalon tragique mais essentiel dans l’histoire du Japon. Il a montré la vulnérabilité de l’humanité face aux forces de la nature, la capacité de la peur à engendrer la violence, mais aussi la résilience et la détermination d’une nation à se reconstruire et à apprendre de ses épreuves pour mieux se préparer à l’avenir.