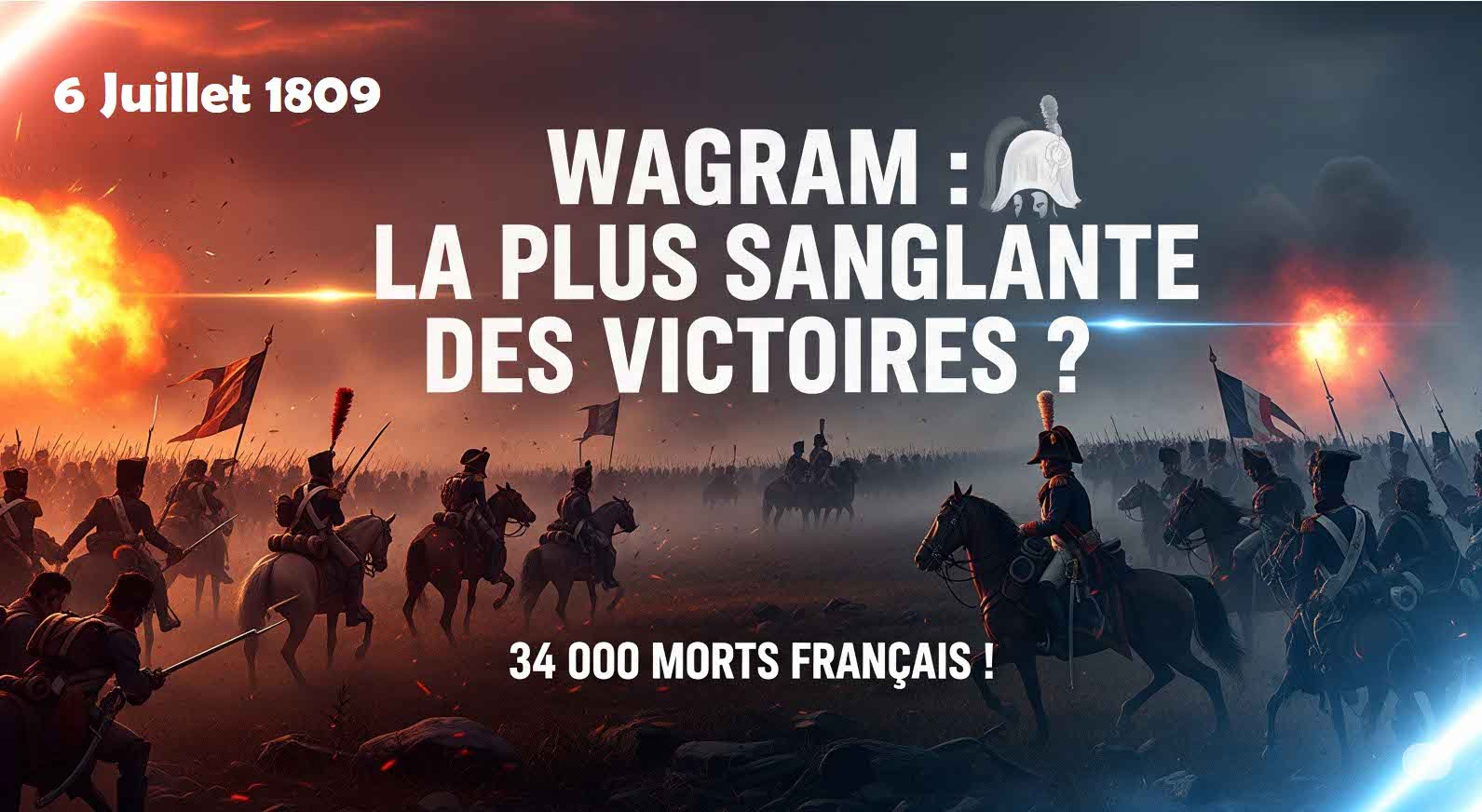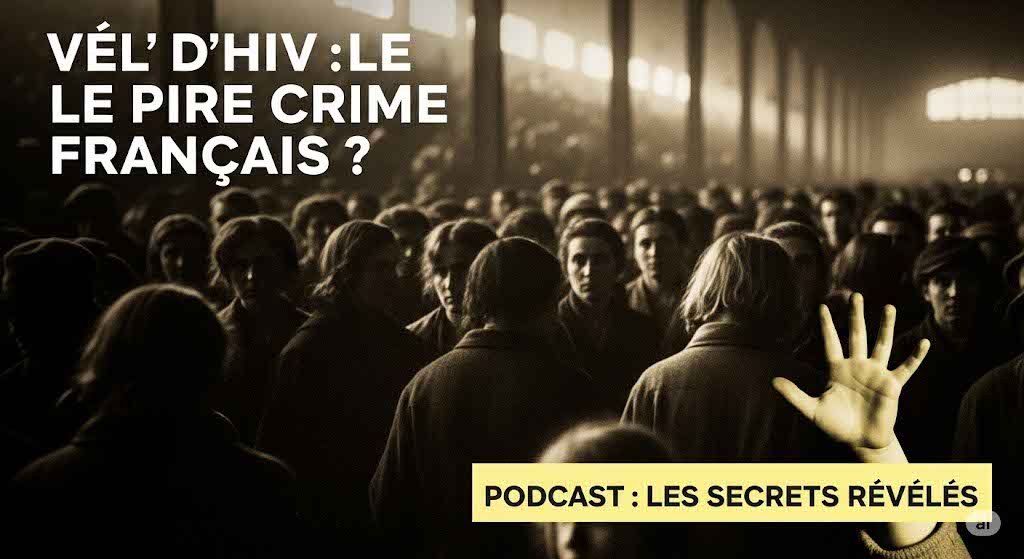Plongez au cœur d’un document historique explosif, « Mein Kampf », le livre rédigé par Adolf Hitler, et découvrez son histoire, son idéologie et les controverses qui ont entouré sa traduction et sa diffusion, notamment en France. 📜
Mein Kampf : Histoire, Idéologie et la Bataille pour sa Traduction en France 📜
« Mein Kampf », littéralement « Mon Combat » en français, est bien plus qu’un simple livre ; il s’agit d’un document fondateur et controversé, rédigé par Adolf Hitler entre 1924 et 1925. Cet ouvrage, qui a marqué l’histoire du XXe siècle, est une pierre angulaire pour comprendre l’idéologie du national-socialisme et les ambitions dévastatrices de son auteur. 📖
I. Introduction : Un Manifeste Controversé et son Origine ✍️
« Mein Kampf » a été conçu dans des circonstances particulières, débutant pendant les neuf mois de détention d’Adolf Hitler à la prison de Landsberg. Cette incarcération faisait suite à l’échec du putsch de la Brasserie, un événement qui a profondément marqué Hitler et a nourri son ressentiment et sa colère. L’ouvrage, initialement intitulé « Viereinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit » (« Quatre ans et demi de lutte contre les mensonges, la stupidité et la couardise »), a finalement pris son titre définitif de « Mein Kampf. Eine Abrechnung » (« Mon Combat. Un règlement de comptes ») sur une suggestion de son éditeur, Max Amann.
Le contenu de « Mein Kampf » est une fusion complexe d’éléments autobiographiques, du récit des débuts du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), et de diverses réflexions sur des sujets tels que la propagande ou l’art oratoire. Mais au-delà de ces aspects narratifs, l’ouvrage se distingue par son style « empreint de haine », exposant la « conception du monde » du national-socialisme. Cette « conception du monde » est caractérisée par des composantes hégémoniques et belliqueuses, mais aussi racistes et ouvertement antisémites, mêlées d’irrédentisme, d’ultranationalisme et de revanchisme. C’est un véritable « livre programme » qui, bien qu’il ne mentionne pas les chambres à gaz (encore une invention récente aux États-Unis à l’époque), contient une allusion à l’utilisation des gaz de combat de la Première Guerre mondiale en lien avec la population juive d’Allemagne.
Les ambitions exprimées dans « Mein Kampf » sont multiples et intrinsèquement liées : un désir profond d’élimination des Juifs et des Tziganes au nom d’une théorie raciale, une militarisation expansionniste et un fervent désir de renouveau national allemand teinté de revanchisme. Ce programme a été annonciateur des tragédies à venir, et sa lecture permet de saisir l’ampleur des menaces qu’il contenait, comme le soulignera plus tard le maréchal Hubert Lyautey, affirmant que « Tout Français doit lire ce livre ».
II. Les Racines de l’Écriture : Motivations Profondes et Processus Créatif 💡
La rédaction de « Mein Kampf » fut motivée par plusieurs facteurs cruciaux pour Adolf Hitler. Tout d’abord, son emprisonnement à Landsberg (du 11 novembre 1923 au 20 décembre 1924) le laissa avec un profond sentiment de trahison. Gouverné par l’émotion et la colère, il vit l’écriture comme un moyen de règlement de comptes personnel.
Ensuite, une motivation plus prosaïque mais non moins importante résidait dans les difficultés financières d’Hitler. Criblé de dettes en raison des avocats qu’il avait dû engager pour sa défense, la perspective des droits d’auteur de l’ouvrage n’était pas étrangère à sa décision d’écrire. C’était une manière de se sortir d’une situation précaire tout en poursuivant ses objectifs.
Mais la raison « surtout » fondamentale, comme le soulignent les sources, était son désir ardent de s’imposer politiquement et de devenir la force idéologique principale des milieux nationalistes de son époque. La rédaction d’un texte qu’il concevait comme un manifeste était pour lui une étape obligée de son parcours politique. Il s’agissait de formaliser sa vision et de la diffuser auprès de ses partisans et du public.
Le processus d’écriture lui-même fut notable. Durant son incarcération, Hitler tapait son texte sur une machine à écrire Remington ou le dictait parfois à certains de ses camarades de détention, notamment Rudolf Hess et Emil Maurice. Après sa libération en décembre 1924, Hitler se retira dans un petit chalet à l’Obersalzberg pour « se mettre au vert », où il acheva le second tome de son livre, toujours avec l’aide précieuse de Rudolf Hess.
Cependant, malgré l’importance qu’il accordait à cet ouvrage, Hitler n’avait pas l’habitude d’écrire, ayant quitté l’école très tôt. Cela se traduisait par un style confus, un « fatras de considérations diverses avec de longues digressions ». Ce manque de professionnalisme a eu une conséquence inattendue : pour des commentateurs comme l’Institut d’histoire contemporaine de Munich, cette rédaction maladroite expliquait pourquoi la nocivité du livre a été longtemps sous-estimée, les passages les plus « sulfureux » étant noyés dans un ensemble mal rédigé.
Malgré cela, le texte d’origine fut remédié à plusieurs reprises par l’entourage d’Hitler pour lui donner une forme plus cohérente et lisible. Otto Strasser, dont le frère Gregor Strasser était également détenu avec Hitler, affirma dans son ouvrage « Hitler et moi » que le Père Stempfle avait « travaillé pendant des mois à mettre en ordre et à lier les pensées exprimées dans Mein Kampf ». Il a même été suggéré qu’Hitler n’aurait « jamais pardonné » à Bernhard Stempfle, qui fut d’ailleurs une victime de la Nuit des longs couteaux en 1934, d’avoir relevé « autant d’insuffisances dans la relecture du manuscrit ».
III. Un Succès Post-Modeste : La Diffusion de l’Ouvrage et ses Ventes Phénoménales 📈
La publication de « Mein Kampf » s’est faite en deux volumes : le premier fut publié le 18 juillet 1925, suivi du second le 11 décembre 1926. Ce dernier se terminait par une dédicace à son « professeur » Dietrich Eckart. À ses débuts, le livre, vendu au prix alors élevé de douze reichsmarks, connut un succès modeste. Jusqu’en 1929, seulement 23 000 exemplaires du premier volume et 13 000 du second furent vendus.
Cependant, après 1930, le tirage augmenta fortement. Un tournant majeur survint le 30 janvier 1933, lorsque Hitler devint chancelier du Reich. Dès le lendemain, le 31 janvier, Eher-Verlag (la maison d’édition officielle) publia dans le journal nazi Völkischer Beobachter un encart publicitaire percutant intitulé « Le livre du jour : Mein Kampf d’Adolf Hitler ». Le texte de cet encart était sans équivoque : « Que va faire Hitler ? se demandent aujourd’hui des millions d’Allemands pleins d’espoir. Pour le savoir, il suffit de lire son livre. Ainsi vous connaîtrez ses buts et sa volonté. Personne, ami ou adversaire, ne peut plus rester indifférent à ce livre ».
Cette campagne de promotion intensive porta ses fruits : les ventes de « Mein Kampf » explosèrent, et pas moins de 900 000 exemplaires furent écoulés au cours de la seule année 1933. Jusqu’en 1935, les ventes atteignirent 1,5 million d’exemplaires. L’ouvrage devint un outil de propagande omniprésent. À partir d’avril 1936, il fut même officiellement désigné comme le cadeau de mariage de l’État aux couples allemands. Ian Kershaw estime le tirage à environ 10 millions d’exemplaires en allemand jusqu’en 1945, ce qui représentait près d’un foyer allemand sur deux. On estime qu’à cette époque, un Allemand sur cinq avait lu le livre. Fait notable, beaucoup, habitués à une rhétorique radicale, pensaient que ces idées « fantasques » ne seraient jamais mises en œuvre.
Durant le Troisième Reich, le nombre total d’exemplaires vendus par Hitler est estimé à 12 millions. Ces revenus considérables lui auraient permis d’acquérir sa résidence secondaire, le Berghof, et même de renoncer à son traitement de chancelier en 1933, ce qui, selon certains, « l’aida à légitimer davantage sa prise de pouvoir ».
Le livre fut également traduit en seize langues étrangères, dont une dizaine par l’éditeur officiel. Cependant, pour des raisons politiques et de propagande, ces versions traduites étaient souvent expurgées, modifiées ou inexactes. Il en résultait de nombreuses divergences idéologiques et sémantiques, rendant parfois certaines versions « tout à fait incohérentes et illisibles ». Hitler lui-même ne souhaitait pas que le public étranger, en particulier français, « devine ses véritables intentions », et préférait la diffusion d’une version expurgée de ses passages les plus virulents.
« Mein Kampf » fut édité en plusieurs formats, dont une version de luxe pour les dignitaires nazis et même une version en braille. En 2015, les ventes totales de « Mein Kampf » depuis sa parution étaient estimées à 80 millions d’exemplaires, suggérant que 70 millions d’exemplaires auraient été autorisés après la chute du Troisième Reich.
Plus récemment, une nouvelle vague d’intérêt est apparue avec la version e-book de « Mein Kampf ». En janvier 2014, le site Vocativ (en) publiait une étude (bien que « non étayée par des chiffres indiscutables ») indiquant que la version numérique était en tête des ventes sur des librairies en ligne comme Amazon et iTunes. Le « grand comeback de Hitler » numérique est daté autour de 2013, avec la sortie d’une version Kindle pour 99 centimes. Plusieurs raisons sont avancées pour cette résurgence : la crise économique, le goût de l’interdit, la discrétion offerte par le format numérique permettant de satisfaire la curiosité, un intérêt académique important, ou encore, selon certains, une augmentation des ventes due aux néonazis et skinheads.
IV. Le Cœur Idéologique de « Mein Kampf » : Visions et Prophéties Dévastatrices 💀
« Mein Kampf » est un document qui mêle des éléments autobiographiques à un manifeste politique énonçant les bases idéologiques du programme de son auteur. Il exprime sans ambiguïté plusieurs ambitions indissociables : le désir d’élimination des Juifs et des Tziganes au nom d’une théorie raciale, une militarisation expansionniste et un renouveau national allemand teinté de revanchisme.
L’un des piliers idéologiques est le pangermanisme, la volonté de réunification de tous les territoires à population germanique. Pour Hitler, la cartographie de l’Europe issue du traité de Versailles était « inacceptable », car elle avait pour conséquence « l’éclatement des peuples de culture allemande ». Il se voyait comme prédestiné à unifier l’Autriche et les minorités allemandes de Tchécoslovaquie et de Pologne à l’Allemagne en un seul espace géographique, le « Grand Empire » (Großdeutsches Reich). Cette unification était considérée comme la « tâche essentielle de [sa] vie, à poursuivre par tous les moyens », suivant le principe qu’« un même sang appartient à un même peuple ».
Pour assurer l’épanouissement de ce peuple allemand réunifié, Hitler préconisait la voie des chevaliers teutoniques : « conquérir par l’épée allemande le sol où la charrue allemande devrait faire pousser le blé pour le pain quotidien de la nation ». Cela nécessitait le réarmement du pays et l’atteinte de l’autosuffisance économique par une série de conquêtes territoriales. Le nouvel essor de la nation allemande devait se faire notamment au détriment des territoires russes et des pays d’Europe centrale et danubienne.
La France est explicitement désignée comme « inexorable et mortelle ennemie du peuple allemand ». Hitler la considérait comme un adversaire logique : « Je ne croirai jamais à une modification des projets que la France nourrit à notre égard ; car ils ne sont, au fond, que l’expression de l’instinct de conservation de la nation française. Si j’étais français et si, par conséquent, la grandeur de la France m’était aussi chère que m’est sacrée celle de l’Allemagne, je ne pourrais et ne voudrais agir autrement que ne le fait, en fin de compte, un Clemenceau ». Il prônait une « explication définitive avec la France », une « lutte décisive » visant l’anéantissement de la France comme « moyen de donner enfin à notre peuple, sur un autre théâtre, toute l’extension dont il est capable ». Il est clair que ces résultats ne seraient atteints « ni par des prières au Seigneur, ni par des discours, ni par des négociations à Genève. Ils doivent l’être par une guerre sanglante ».
Le racisme occupe une place centrale dans l’ouvrage. Hitler y « découvre » les Juifs en 1916 à Berlin, les décrivant comme des « planqués » qui « exploitaient économiquement le peuple allemand à leur seul profit », camouflant cette activité en tentant de semer la discorde. Il raconte une nuit où « la vérité se fit jour dans [son] esprit » et où il « comprit en pleurant jusqu’au matin que le peuple juif travaillait délibérément à la ruine de l’Europe, et de l’Allemagne en particulier ». Il développe une théorie de la chute des civilisations antérieures, expliquant que la domination mène à l’extension territoriale, qui aboutit au métissage, puis à une « dégénérescence de la race initiale » et inéluctablement à la décadence.
Sa vision du racisme est explicite : les peuples « inférieurs » ne peuvent espérer survivre qu’en se métissant avec les peuples « supérieurs », et y parviennent lorsque ces derniers sont totalement métissés, ne constituant plus un danger. Il considérait que c’était ce qui commençait à se produire en Europe, y compris en Allemagne. Le « Parti national-socialiste des travailleurs allemands tire les caractères essentiels d’une conception raciste (völkisch) de l’univers ». Pour lui, les « individus handicapés doivent être éliminés (eugénisme actif) : « Anéantir avec une décision brutale les rejetons non améliorables » ». De plus, l' »Aryen est le Prométhée de l’humanité » et les peuples « inférieurs » doivent être asservis aux peuples « supérieurs ». Tout peuple « supérieur » autre que le peuple allemand, s’il en existe, devait « aussi être éliminé sans délai », le métissage étant interdit pour préserver la « race ».
Sur le plan organisationnel, Hitler soulignait les leçons à tirer de l’Église catholique : sa force de résistance réside dans son « attachement inébranlable à des dogmes établis une fois pour toutes », qui seuls confèrent le caractère d’une foi. Il affirmait également que plus la propagande est efficace et moins il y aura besoin d’avoir de membres dans le parti, ceux-ci étant ainsi plus sûrs et faciles à surveiller.
Ces menaces précises et cette vision du monde ont frappé de nombreux contemporains. Le futur pape Pie XII déclara en 1929 : « Ou bien je me trompe vraiment beaucoup, ou bien tout cela ne se terminera pas bien. Cet être-là est entièrement possédé de lui-même : tout ce qu’il dit et écrit porte l’empreinte de son égoïsme ; c’est un homme à enjamber des cadavres et à fouler aux pieds tout ce qui est en travers de son chemin… ». Il s’interrogeait sur le fait que tant de gens en Allemagne ne voyaient pas cela, ou ne tiraient aucune leçon de ce qu’il écrivait et disait, et demandait : « Qui parmi tous ces gens, a seulement lu ce livre à faire dresser les cheveux sur la tête qu’est Mein Kampf ? ».
V. La Bataille pour la Vérité : La Traduction Française de 1934 🇫🇷
La complexité de « Mein Kampf » et son contenu explosif ont très tôt suscité un débat crucial en France : la nécessité d’une traduction intégrale. Des personnalités comme Charles Maurras de l’Action française, et bien d’autres, souhaitaient disposer d’une version non expurgée, non seulement pour « démasquer qui, sur la scène politique française, est proche du nazisme », mais aussi pour « cerner l’idéologie nazie ». Le paradoxe de ce livre était que la traduction intégrale était voulue à la fois par ses émules et par ses contradicteurs, une situation qui perdure encore aujourd’hui.
C’est à l’automne 1933 que le général Georges Jacques Lachèvre, Saint-Cyrien et grand officier de la Légion d’honneur, alors actif au ministère des Anciens combattants, prend l’initiative. Il convoque André Calmettes, un polytechnicien germaniste, et lui confie les deux tomes de « Mein Kampf » en allemand, lui demandant d’évaluer la pertinence d’un extrait pour le public français. La conclusion de Calmettes est claire : il faut une traduction intégrale. Avec une équipe de collaborateurs, il se lance dans la tâche ardue de traduire le texte en seulement cinq mois, d’octobre 1933 à février 1934.
Pour l’édition, Jacques Lachèvre contacte Fernand Sorlot, un éditeur qualifié de fasciste et proche de la droite maurassienne germanophobe, qui accepte de s’engager dans le projet malgré les droits d’auteur d’Hitler et de l’éditeur allemand, Franz-Eher-Verlag. Le ministère des Anciens combattants est délibérément non mentionné pour ne pas compromettre directement le gouvernement.
Un événement surprenant est l’alliance secrète entre la LICA (Ligue internationale contre l’antisémitisme), une organisation de gauche, et Fernand Sorlot. La LICA, avec le soutien de certains hommes d’affaires, verse une somme importante de 50 000 francs à Sorlot, correspondant à l’achat de 5 000 exemplaires de l’ouvrage. 1 000 exemplaires devaient être écoulés par la LICA, tandis que les 4 000 autres étaient destinés à « tout ce qui compte dans la nation », incluant « professeurs de faculté, membres de l’Institut, chefs militaires, présidents des tribunaux, ecclésiastiques de toutes les religions, syndicats patronaux et ouvriers, cercles, légations, etc. ». L’un des contributeurs, Marcel Bleustein-Blanchet, rapporte que le livre fut envoyé à tous les députés et sénateurs, mais qu’un sondage auprès d’une vingtaine de destinataires révéla que « aucun n’avait lu Mein Kampf. « Ils l’avaient reçu comme un calendrier et rangé dans un coin » ».
En février 1934, les Nouvelles Éditions Latines, fondées en 1928 par Fernand Sorlot, publient « Mein Kampf » en français. L’ouvrage est ramené à un seul volume de 688 pages sous-titré « Mon Combat » et est tiré à 8 000 exemplaires.
Au printemps 1934, la nouvelle de la traduction intégrale et de la publication en France parvient aux oreilles d’Hitler. Il est furieux. En effet, sa stratégie de propagande pour les pays étrangers prévoyait des traductions expurgées et adaptées aux « conditions particulières et aux manières de voir » locales. Il avait d’ailleurs autorisé en 1938 une traduction aux Éditions Fayard qui était « allégée, expurgée, voire carrément falsifiée ». Une phrase originelle telle que « […] la France nation impérialiste est l’ennemie mortelle de l’Allemagne […] » pouvait y être transformée en « La frontière entre l’Allemagne et la France est définitivement fixée. Les peuples français et allemands égaux en droit ne doivent plus se considérer comme ennemis héréditaires mais se respecter réciproquement ».
Hitler décide alors, via sa maison d’édition Verlag Franz Eher, de poursuivre les Nouvelles Éditions Latines devant le tribunal de Commerce de la Seine pour atteinte au droit d’auteur et contrefaçon. Il exigeait la mise au pilon de l’ouvrage, une amende de 1 000 francs par exemplaire et 10 000 francs de dommages et intérêts. Fait notable, en France, Hitler était alors considéré comme un simple écrivain, et la Société des gens de lettres s’associa même à sa plainte. Les juges ont reconnu le bien-fondé de la plainte en estimant que « cette œuvre représente un effort de création ».
Lors du procès, Fernand Sorlot est défendu par les avocats Louis Gallié et Philippe Lamour. Philippe Lamour, refusant l’intervention de l’ambassade allemande, exige qu’Hitler « constitue personnellement avoué auprès du tribunal », ce à quoi Hitler se résout, non sans exprimer son mécontentement au gouvernement français. Lamour utilise ce procès comme une tribune pour « montrer le nazisme sous son vrai jour et fustiger les dangers de la politique exercée par les démocraties ». La défense plaide que « l’intérêt public exige que tout Français sache que l’auteur notamment considère que la France est le plus infâme et le plus dangereux ennemi de l’Allemagne, qu’il convient de la frapper au cœur […] avant d’entreprendre le règlement de comptes ».
Le jugement rendu le 18 juin 1934 par le tribunal de commerce de la Seine est un compromis : le plaignant obtient un franc symbolique de dommages-intérêts, et l’accusé est contraint de détruire son stock. Cependant, même après cette décision, Fernand Sorlot parvient, selon son fils Jean, à faire imprimer 15 à 20 000 exemplaires dans une imprimerie clandestine entre 1934 et 1940, et en offre 2 000 à la Résistance.
L’éditeur, Fernand Sorlot, n’a cessé de souligner l’actualité du livre et l’intérêt vital pour les Français de connaître ce « qui doit devenir désormais la Bible du peuple allemand ». C’est pourquoi la couverture de son édition arborait en exergue la fameuse phrase du maréchal Hubert Lyautey : « Tout Français doit lire ce livre ». Cependant, Antoine Vitkine a fait justice d’une légende entourant cette citation de Lyautey. Après le procès, la Confédération de Groupements des Contribuables (C.G.C.), une association de droite patronnée par Lyautey, publie une brochure approuvant Hitler « sur près des deux tiers » de ses idées, notamment sur les Juifs, le marxisme, le bolchevisme et la franc-maçonnerie. Le fait que Lyautey les en félicite donnait à sa phrase une certaine ambiguïté.
L’« Avertissement des éditeurs », rédigé par le général Lachèvre mais abusivement signé par Sorlot dans l’édition imprimée, mettait en avant les menaces « très lourdes » à l’endroit de la France. Il soulignait l’influence considérable du livre en Allemagne, affirmant qu’il fallait « remonter au Coran » pour en trouver l’analogue. Face au « refus obstiné » d’Hitler de le laisser publier en français, les éditeurs ont jugé qu’il était de « l’intérêt national de passer outre à ce refus, quelles que puissent être pour nous-mêmes et pour la jeune maison que nous avons fondée les conséquences de notre initiative ». Ils citent Hitler lui-même pour justifier leur démarche : « M. Frick […] disait : « Pour les nationaux-socialistes, le droit c’est ce qui sert le peuple allemand. L’injustice, c’est ce qui lui porte dommage. » Nous avons simplement pris à notre compte cette vigoureuse définition ».
La traduction de 1934, issue de l’édition allemande de 1933, se voulait « intégrale et neutre », avec quelques notes éparses mais sans commentaire. Le tribunal de commerce de la Seine, dans son jugement, a même indiqué que la « fidélité de la traduction n’est pas contestée ». Jacqueline Carnaud, spécialiste de la période, a qualifié cette traduction de « beau style, du langage fleuri, ce qu’on appelle une merveilleuse traduction ». Paradoxalement, l’équipe éditoriale de la version critique « Historiciser le mal » (2021, Fayard) considère, elle, que la traduction de 1934 « fait preuve de parti-pris anti-allemands et antisémites ».
VI. La Voix du Traducteur : Comprendre pour Agir 🤔
André Calmettes, le traducteur, a explicitement exposé ses motivations dans un article du Journal de l’École polytechnique daté du 25 février 1934, intitulé « Pourquoi j’ai traduit Mein Kampf ». Il a affirmé n’avoir pas traduit l’ouvrage « sans but ni raison », mais plutôt comme un « pensum » qu’il s’est « infligé de bon cœur pour les miens et pour mes amis, mais aussi pour tous les hommes et pour toutes les femmes de bonne volonté, surtout pour les jeunes ».
Son objectif n’était pas d’analyser ou de commenter le livre, mais de le livrer tel quel au public. Il considérait que l’ouvrage, livré au public allemand entre 1926 et 1928, « jette une clarté singulière sur la politique allemande de l’après-guerre ». Pour Calmettes, en ignorant ce texte et en se contentant de « révélations au compte-gouttes », les Français étaient « ridicules et stupides », découvrant « des fragments minimes d’une vérité que l’on nous jetait au visage en huit cents pages serrées ».
Le traducteur était également conscient que les « prophéties de cet ouvrage engagent l’avenir ». La « doctrine d’action politique, complaisamment développée, demeure actuelle », et le livre constitue le « dogme du parti qui mène l’Allemagne actuelle, dogme d’une agissante majorité, dogme demain de l’Allemagne entière ». Il insiste sur le terme « dogme », établissant un parallèle explicite avec le Coran.
Cependant, Calmettes mettait en garde contre une lecture restreinte de l’ouvrage, ne se limitant pas à un simple « péril allemand » ou à la seule mitoyenneté de la France avec l’Allemagne. Il appelait à une lecture sur un « plan largement humain », considérant que le document, tiré à près d’un million d’exemplaires en Allemagne et traduit dans plusieurs pays, « touche des problèmes politiques, sociaux, et de morale, qui se posent à tous les peuples ». Il soulignait l’importance d’une traduction intégrale, arguant que l’on n’a « pas le droit, sur quinze ou sur cent versets du Coran, de parler de l’islamisme, ni, sur dix pages de Mein Kampf de parler de l’hitlérisme ». La lecture des passages secondaires, selon lui, serait « aussi féconde que celle des passages réputés essentiels ».
Calmettes espérait que son travail aiderait les Français à « pénétrer la mentalité allemande », une facette de la « mentalité anglo-saxonne » que les Français ne daignaient pas étudier et comprendre, mais dont ils subissaient les manifestations. Il considérait cette attitude comme « bornée et dangereuse », rappelant le coût de l’incompréhension de l’Angleterre, des États-Unis et de l’Allemagne au cours des quinze années précédentes. Pour lui, son travail aurait atteint son but ultime « s’il tournait les Français vers ce problème », car la guerre « naît bien souvent de l’avidité de quelques-uns et de la peur d’une multitude ; elle ne saurait trouver de terrain plus favorable que celui de l’ignorance et de l’incompréhension mutuelles que [il a] voulu combattre ».
VII. La Réponse d’Hitler : Quand la Politique Dépasse l’Écrit 🎭
Adolf Hitler lui-même a eu l’occasion de s’exprimer sur la question des modifications de « Mein Kampf », notamment en lien avec les passages consacrés à la France. En février 1936, lors d’un entretien avec Bertrand de Jouvenel, Hitler fut interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas modifié ces chapitres avant chaque nouvelle édition de son livre.
Sa réponse fut révélatrice de sa perception de l’œuvre et de son rôle d’homme politique. Il expliqua le contexte de rédaction : « J’étais en prison quand j’ai écrit ce livre, les troupes françaises occupaient la Ruhr. C’était le moment de la plus grande tension entre les deux pays. Oui, nous étions ennemis ! Et j’étais avec mon pays, comme il sied, contre le vôtre. Comme j’ai été avec mon pays contre le vôtre durant quatre ans et demi dans les tranchées ! ». Il ajouta qu’il se mépriserait s’il n’était pas « avant tout allemand quand vient le conflit ».
Cependant, il insista sur le fait que la situation avait évolué : « Mais aujourd’hui, il n’y a plus de conflit ». Il balaya l’idée de faire des corrections dans son livre « comme un écrivain qui prépare une nouvelle édition de ses œuvres », affirmant clairement : « Mais je ne suis pas un écrivain, je suis un homme politique. ». Pour Hitler, sa véritable « rectification » ne se trouvait pas dans les pages de son livre, mais dans ses actions et sa politique : « Ma rectification ? Je l’apporte tous les jours dans ma politique extérieure toute tendue vers l’amitié avec la France… Ma rectification, je l’écrirai dans le grand livre de l’Histoire ! ».
Cette déclaration illustre parfaitement la distance qu’Hitler cherchait à établir entre l’œuvre écrite, figée dans un passé conflictuel, et sa politique étrangère du moment, qu’il présentait comme orientée vers l’apaisement et l’amitié. C’était une manœuvre rhétorique habile, cherchant à minimiser la portée des passages les plus virulents de « Mein Kampf » tout en affirmant sa stature de dirigeant dont les actes valaient plus que les mots d’un livre.
VIII. Conclusion : Un Document Historique d’une Portée Durable 🌍
« Mein Kampf » demeure un document historique d’une importance capitale pour quiconque cherche à comprendre les origines idéologiques et les ambitions du régime nazi. De sa rédaction en prison, motivée par la revanche, l’ambition politique et même des considérations financières, à sa diffusion massive par la propagande d’État, le livre est indissociable de l’ascension d’Adolf Hitler et du NSDAP.
Son contenu, empreint d’une haine virulente et d’un racisme exterminateur, annonçait clairement les intentions belliqueuses d’un homme qui voyait la conquête territoriale et l’anéantissement des « ennemis » comme des étapes nécessaires à l’épanouissement de son « Grand Empire » allemand. La désignation de la France comme « ennemie mortelle » et la justification de l’élimination des peuples « inférieurs » étaient des menaces concrètes, que certains, comme le futur Pape Pie XII, avaient pressenties comme « à faire dresser les cheveux sur la tête ».
La controverse autour de sa traduction en France en 1934, orchestrée par des figures courageuses comme le général Lachèvre et André Calmettes, malgré la fureur d’Hitler et le procès intenté, témoigne d’une volonté cruciale de vérité et de la reconnaissance de la nécessité de comprendre l’adversaire. La conviction de Calmettes qu’une lecture intégrale permettrait de saisir la « mentalité allemande » et de combattre l’ignorance pour prévenir la guerre souligne la portée civique et préventive que l’on attribuait à la connaissance de ce texte.
Bien que Hitler ait tenté de reléguer « Mein Kampf » au rang d’une œuvre littéraire dépassée par sa « politique extérieure », l’histoire a démontré la pertinence effrayante de ses écrits. L’ouvrage reste un rappel sombre des dangers de l’idéologie haineuse et de l’importance de déchiffrer les signes avant-coureurs de la violence systémique. Sa persistance dans les ventes, y compris à l’ère numérique, souligne une curiosité continue, mais aussi la nécessité inaltérable d’un examen critique et d’une contextualisation rigoureuse pour éviter toute réinterprétation fallacieuse de son message.