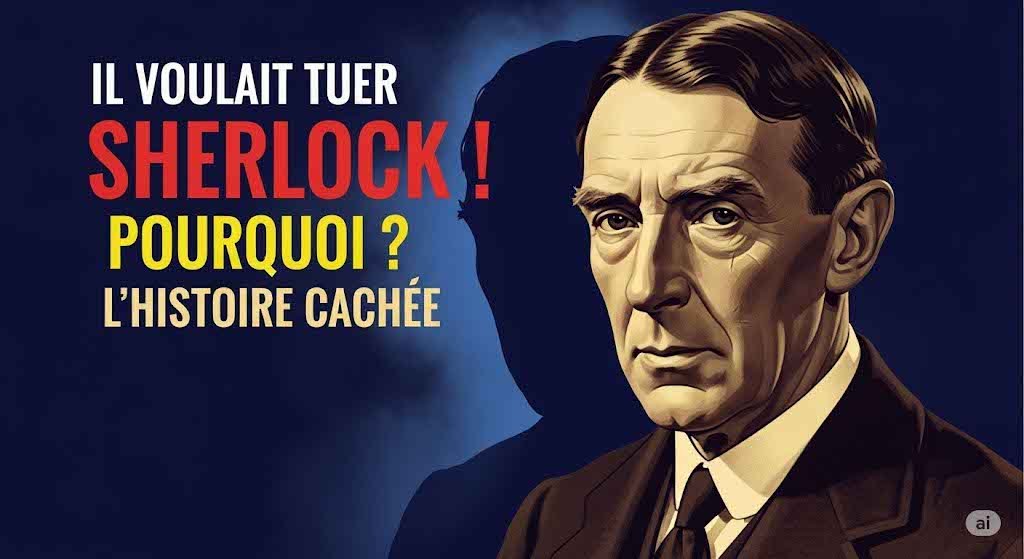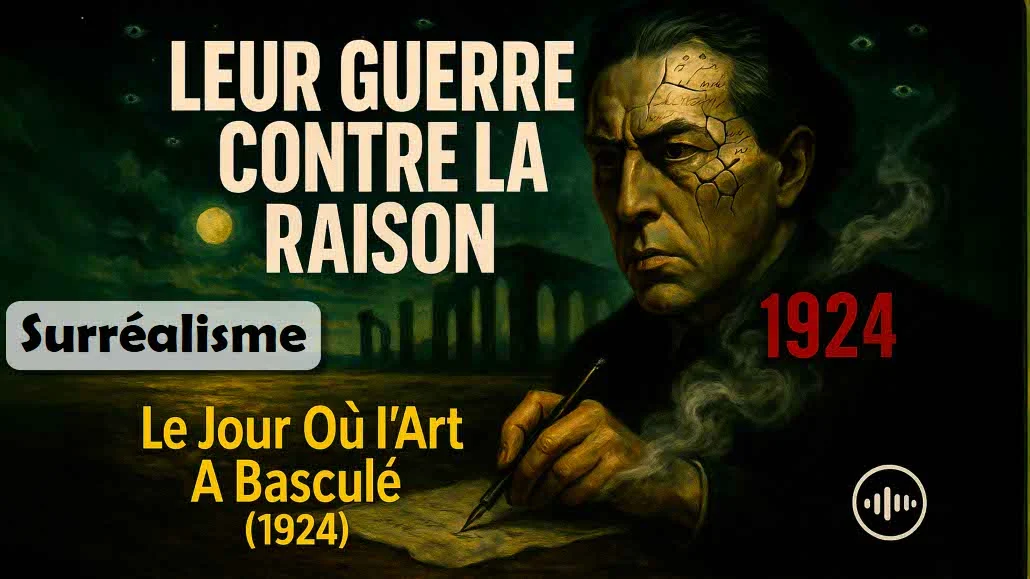Jean-Jacques Rousseau : Une Lumière Singulière dans la Pensée du XVIIIe Siècle ✨
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), figure emblématique de la littérature, de la philosophie et de la musique, a marqué son siècle par une pensée audacieuse et souvent controversée, jetant les bases de concepts qui résonnent encore aujourd’hui. Son parcours, jalonné par l’errance et un profond sentiment de persécution, a façonné une œuvre introspective et critique, défiant les conventions de son époque.
🌍 Biographie : Un Cheminement Tourmenté vers la Pensée
Né le 28 juin 1712 à Genève, Jean-Jacques Rousseau a connu une enfance marquée par le deuil précoce de sa mère, Suzanne Bernard, décédée neuf jours seulement après sa naissance, le 7 juillet 1712. Son père, Isaac Rousseau, horloger comme son grand-père et son arrière-grand-père, s’installe à Nyon en 1722 pour échapper à la justice, laissant le jeune Jean-Jacques à la garde de son oncle. La famille Rousseau, originaire de Montlhéry près d’Étampes, s’était réfugiée à Genève en 1549 pour fuir les persécutions religieuses contre les protestants, s’y établissant comme horlogers, une profession alors respectée et lucrative.
📚 Enfance et Jeunesse : Les Premières Semences d’une Sensibilité Unique
Élevé par son père et une de ses tantes dans la maison natale de la Grand-Rue, Rousseau développe très tôt une passion pour la lecture, partagée avec son père. Après le départ de son père, il est confié en pension au pasteur Lambercier à Bossey, où il passe deux ans (1722-1724). Son apprentissage chez un greffier, puis chez un maître graveur, Abel Ducommun, est difficile. Confronté à une rude discipline, il s’enfuit de Genève le 14 mars 1728, à l’âge de 15 ans, après avoir trouvé les portes de la ville fermées à son retour d’une promenade.
Cette fuite marque le début d’une vie d’errance. Il se réfugie auprès du curé de Confignon, qui l’envoie chez Madame de Warens, une Vaudoise récemment convertie au catholicisme. C’est à Turin qu’il se convertit lui-même au catholicisme, un épisode qu’il prétend avoir résisté, mais qu’il semble avoir accepté rapidement. Durant son séjour à Turin, il enchaîne de petits emplois de laquais-secrétaire et y commet l’acte regrettable du vol d’un ruban rose, dont il accuse lâchement une jeune cuisinière, Marion.
De retour auprès de Madame de Warens à Annecy en 1729, qu’il surnomme « Maman » et pour qui il développe une affection quasi filiale puis amoureuse, il s’intéresse à la musique et devient le factotum de celle qui sera aussi sa maîtresse. Ses années aux Charmettes, près de Chambéry, avec Madame de Warens, sont décrites comme idylliques. Il y dévore les livres de la bibliothèque de M. Joseph-François de Conzié, se forgeant un « magasin d’idées ». C’est aussi durant cette période qu’il développe son amour pour la nature, la flânerie et la rêverie.
✍️ Premiers Contacts avec le Monde des Lumières et l’Éveil Politique
En 1740, Rousseau entre au service de M. de Mably à Lyon comme précepteur, ce qui lui permet de fréquenter la haute société et de composer son premier écrit sur l’éducation. Il tente ensuite sa chance à Paris, où il présente un système de notation musicale à l’Académie des sciences, sans succès. C’est à cette époque qu’il noue une amitié significative avec Denis Diderot, alors tout aussi méconnu que lui.
L’année 1743 marque un tournant avec son engagement comme secrétaire de l’ambassadeur de France à Venise. Cette expérience, bien que courte (un an), éveille son intérêt pour la politique, l’amenant à concevoir le projet des Institutions politiques, qui deviendra plus tard le célèbre Du contrat social.
De retour à Paris en 1744, il s’installe avec Marie-Thérèse Levasseur, une jeune lingère qu’il épouse civilement en 1768. Un aspect controversé de sa vie est l’abandon de leurs cinq enfants à l’assistance publique des Enfants-Trouvés entre 1747 et 1751. Il justifiera cette décision par le manque de moyens et par l’idée qu’il s’agissait d’un acte de citoyen, inspiré par la République idéale de Platon, tout en cherchant à les soustraire à l’influence de sa belle-famille. Cette décision lui sera vivement reprochée plus tard par Voltaire et la « coterie holbachique ».
🌟 Célébrité et Tourments : L’Illumination de Vincennes et ses Conséquences
Le destin de Rousseau prend un tournant décisif en 1749. Alors qu’il visite Diderot emprisonné à Vincennes, il lit dans le Mercure de France la question mise au concours par l’Académie de Dijon : « le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs ? ». Cette lecture provoque ce qu’il appellera l’« illumination de Vincennes », un moment de révélation où il perçoit soudainement une « foule d’idées ».
De cette illumination naît son Discours sur les sciences et les arts (ou Premier Discours) en 1750, dans lequel il soutient que le progrès est synonyme de corruption. Cet ouvrage lui vaut une célébrité internationale et une notoriété grandissante, suscitant de nombreuses réactions et le poussant à affiner son argumentation. Fort de ce succès, il abandonne ses emplois pour vivre de ses travaux de transcription musicale, adoptant un mode de vie plus en accord avec ses idées.
Son opéra Le Devin du village rencontre un grand succès en 1752, mais Rousseau refuse de se présenter au roi, déclinant ainsi la pension qui lui aurait été offerte. Il participe également à la querelle des Bouffons, affirmant la primauté de la musique italienne sur la française.
En 1754, il répond à un nouveau concours de l’Académie de Dijon avec son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (Second Discours). Il y développe l’idée que l’homme est naturellement bon et que la société le corrompt, dénonçant l’injustice sociale. Cette œuvre, comme la première, engendre une vive polémique, notamment avec Voltaire. Durant cette période, il s’éloigne progressivement des philosophes des Lumières, notamment des Encyclopédistes athées, réintégrant le protestantisme à Genève tout en restant fondamentalement croyant.
🏡 Grandes Œuvres et Isolement : Les Chefs-d’œuvre de l’Exil
À partir de 1756, Rousseau s’installe à l’Ermitage, une maison offerte par Madame d’Épinay, et entreprend la rédaction de son roman épistolaire Julie ou la Nouvelle Héloïse et de son Dictionnaire de la musique. Sa relation avec Diderot et les autres philosophes se dégrade, notamment suite à une idylle platonique avec Mme d’Houdetot qui entraîne des rumeurs et des accusations mutuelles de complot. Il quitte l’Ermitage pour Montmorency où il achève ses grandes œuvres.
En 1761 et 1762 paraissent Julie ou la Nouvelle Héloïse (un immense succès littéraire), l’Émile ou De l’éducation, et Du contrat social. Ces deux derniers ouvrages, qui représentent le sommet de sa pensée, sont immédiatement condamnés par le Parlement de Paris et les autorités de Genève pour hétérodoxie religieuse et contenu politique. Ces condamnations le forcent à fuir la France et à errer de refuge en refuge, trouvant notamment protection auprès du roi de Prusse Frédéric II à Môtiers.
Les attaques se poursuivent, notamment de la part de Voltaire, qui révèle publiquement l’abandon de ses enfants dans un pamphlet. Rousseau se sent de plus en plus persécuté, une sensation qui s’intensifie lors de son séjour en Angleterre avec David Hume, qu’il finit par accuser d’être au centre d’un complot contre lui.
📖 Années d’Errance et Œuvres Autobiographiques
Durant cette période, Rousseau entreprend la rédaction de ses œuvres autobiographiques :
- Les Confessions (rédigées entre 1763/64 et 1770), où il se livre à une profonde observation de ses sentiments intimes, offrant un autoportrait de son âme.
- Rousseau juge de Jean-Jacques (1772-1776), dans lequel il dénonce un complot mené contre lui par ses anciens amis.
- Les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778), ouvrage inachevé où il décrit le bonheur d’être dans la nature et ses sentiments intimes, mais aussi ses persécutions secrètes. Certains commentateurs ont évoqué la paranoïa, tandis que d’autres ont défendu l’hypothèse d’un complot généralisé.
Il continue de vivre en copiant des partitions musicales à Paris. En 1778, le marquis de Girardin lui offre l’hospitalité à Ermenonville, où il meurt subitement le 2 juillet 1778, probablement d’un accident vasculaire cérébral. Son corps est inhumé dans l’île des Peupliers de la propriété, et son tombeau devient rapidement un lieu de culte. Son corps sera transféré au Panthéon de Paris le 11 octobre 1794.
🧠 L’Itinéraire Intellectuel et la Philosophie de Rousseau
La pensée de Rousseau est profondément marquée par sa grande sensibilité, expliquant en partie les brouilles qui ont jalonné sa vie. David Hume le décrivait comme un homme dont la sensibilité atteignait des sommets, lui procurant un sentiment de souffrance plus aigu que celui du plaisir.
💡 Un Autodidacte Critique des Lumières
Rousseau n’a pas suivi de formation philosophique classique. Son savoir est le fruit de ses lectures, notamment Descartes, Locke, Malebranche et Leibniz. Dès son premier Discours, il se positionne comme un non-professionnel de la philosophie et exprime sa méfiance envers certains qui s’en réclament.
Sa philosophie est bâtie sur l’idée que l’Homme est naturellement bon et que la société le corrompt. Par « naturellement bon », il entend un être humain à l’état de nature ayant peu de désirs, plus farouche que méchant. C’est l’interaction sociale qui le rend « méchant » et engendre les inégalités. Pour retrouver une « bonté naturelle », l’homme doit recourir à l’artifice du contrat social et se soumettre à des lois issues de la volonté générale.
Rousseau est un critique majeur de la pensée politique et philosophique de son temps. Contrairement à Bacon, Descartes, Locke et Newton, il soutient que ce qu’ils appellent « progrès » est en réalité un déclin de la vertu et du bonheur. Il dénonce les systèmes politiques et sociaux fondés sur l’interdépendance économique et l’intérêt, qu’il voit comme menant à l’inégalité, à l’égoïsme et à l’émergence de la « société bourgeoise » (un terme qu’il est l’un des premiers à employer).
Cependant, sa critique de la philosophie des Lumières est une « critique interne ». Il ne souhaite pas revenir à Aristote, à l’ancien républicanisme ou à la moralité chrétienne. Il accepte certains préceptes des traditions individualistes et empiristes de son temps, mais en tire des conclusions différentes, se posant des questions telles que l’origine de l’état de guerre ou la possibilité de modeler la nature humaine pour un État démocratique. Rousseau est le premier à conférer la souveraineté au peuple et à penser que la démocratie est la seule forme légitime d’État.
🏞️ Nature Humaine et Histoire Conjecturale : Une Genèse Philosophique
Rousseau aborde l’histoire sous un angle moral, la voyant comme un recueil d’exemples et une succession d’états des facultés humaines évoluant en fonction des défis du temps. Pour lui, l’histoire n’est pas un point de départ objectif, mais un moyen d’étendre ses propres convictions à l’humanité. Il défend l’idée que les impressions du passé doivent servir à des fins éducatives, non à un savoir théorique, se démarquant de l’objectivité de D’Alembert.
Dans le Second Discours, Rousseau propose une « genèse philosophique » alternative au récit chrétien, avec un « état de nature » qui n’a peut-être jamais existé, mais qu’il imagine comme l’humanité « avant la Chute ». La Chute n’est pas due à Dieu ou à la nature humaine, mais au processus historique et aux institutions politiques et économiques. Le « mal » chez Rousseau désigne les tourments de l’esprit et l’aliénation causée par l’extrême attention portée au regard des autres, détournant l’homme de son moi profond.
🚶♂️ De l’État de Nature à la Société Civile
Comme Hobbes et Locke, Rousseau prend l’état de nature comme point de départ de sa philosophie. Cependant, il va plus loin, imaginant un être humain « tel qu’il a dû sortir des mains de la Nature », moins fort et agile que d’autres animaux, mais avant tout avantagé dans son organisation.
Le passage à la société civile se fait en plusieurs phases :
- L’homme oisif et dispersé s’associe progressivement en horde.
- La première révolution voit l’humanité entrer dans l’ordre patriarcal et la formation des familles, considérée comme l’âge d’or.
- L’ordre patriarcal cède la place à un monde marqué par la division des tâches, la perte de l’unité humaine, et l’émergence des riches et des pauvres.
- La guerre de tous contre tous émerge, entendue dans le sens de Hobbes.
Le premier contrat social qui en résulte est inégalitaire, consolidant les avantages des riches. C’est dans Du contrat social que Rousseau cherche à dépasser ce contrat inégalitaire par le concept de la volonté générale, permettant à chacun de bénéficier de la force commune tout en restant libre.
💖 Amour-propre et Pitié : Les Moteurs des Passions
La question cruciale pour Rousseau est de comprendre comment le mal a pu surgir dans une société d’hommes naturellement bons. Le terme « bon » ne signifie pas vertueux, mais plutôt un équilibre entre les besoins et la capacité à les satisfaire, rendant l’homme « bon pour lui-même et non dépendant des autres ».
Rousseau identifie deux instincts fondamentaux pour la conservation de l’espèce : l’amour de soi (conservation individuelle) et la pitié (prendre soin d’autrui). La « chute » ou le « mal » apparaît avec l’amour-propre, un sentiment relatif et factice né dans la société, qui pousse l’individu à se comparer, à se vouloir supérieur aux autres, générant ainsi les conflits. L’amour-propre est dangereux, mais peut être contenu par l’éducation (dans l’Émile) et une bonne organisation sociale (dans le Contrat social). Ce danger s’accroît avec l’interdépendance économique, où les hommes cherchent biens matériels et reconnaissance, menaçant ainsi leur liberté et leur estime de soi.
🧠 Passions, Raison et Perfectibilité
Pour Rousseau, la raison est subordonnée aux passions, notamment à l’amour-propre. Les passions et la raison ont une dynamique évolutive : à l’état de nature, l’homme a peu de passions et de raison, et « n’est point méchant précisément parce qu’il ne sait ce que c’est que d’être bon ». Les passions stimulent l’entendement humain, conduisant au perfectionnement de la raison, tandis que les connaissances nourrissent les passions.
Le trait distinctif de l’homme n’est pas la raison, mais la perfectibilité, la « faculté de se perfectionner ». Cependant, pour Rousseau, ce terme n’est pas toujours positif ; il désigne surtout une capacité de changer, qui conduit le plus souvent à la corruption.
🌟 Vertu et Conscience
La « sagesse » chez Rousseau est le siège de la vertu, une conscience qui n’éclaire pas, mais active le sens des proportions cosmiques chez l’homme. La vérité morale est l’élément unificateur de la réalité. Les connaissances sont de « fausses lumières » si elles ne sont pas enracinées dans une certitude intérieure, car la raison peut être corrompue par les passions. Seule la conscience, par son amour pour la justice et la moralité, peut faire aimer la vérité, bien que cela soit rare dans un monde dominé par l’amour-propre.
⚖️ La Philosophie Politique de Rousseau : Le Contrat Social et la Volonté Générale
La doctrine politique de Rousseau est principalement exposée dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, le Discours sur l’économie politique, Du contrat social et les Considérations sur le gouvernement de la Pologne. Il s’inscrit dans la tradition contractualiste, avec son Discours sur l’inégalité parfois vu comme un dialogue avec l’œuvre de Thomas Hobbes. Pour Rousseau, un État n’est légitime que s’il est guidé par la volonté générale de ses concitoyens.
🔑 Concepts Clés de la Philosophie Politique
- Amour de la patrie : Un sentiment puissant qui unit l’amour-propre à la vertu, aidant à se conformer à la volonté générale.
- Corps politique : Un être moral doté d’une volonté générale, tendant à la conservation et au bien-être de l’ensemble.
- Corruption du peuple et des chefs : Survient lorsque les intérêts particuliers l’emportent sur l’intérêt général, et que les vices répriment les lois.
- Gouvernement : Non pas maître de la loi, mais son garant, cherchant à la faire aimer.
- Législateur : Doit se conformer à la volonté générale.
- Loi : Synonyme de raison publique, s’opposant à la raison privée orientée vers les intérêts particuliers.
- Souveraineté : L’autorité suprême et législative. Rousseau transfère la « puissance absolue et perpétuelle » du monarque au peuple.
- Vertu : La « science sublime des âmes simples », dont les principes sont gravés dans les cœurs. Elle est la conformité de la volonté particulière à la volonté générale.
- Volonté générale : Tends à la conservation du corps politique et au bien commun. C’est la voix du peuple lorsque les intérêts particuliers ne le séduisent pas.
🎯 La Volonté Générale : Un Concept Central et Complexe
La volonté générale est le concept clé de la philosophie politique de Rousseau. Chez lui, la volonté doit être libre pour avoir une valeur morale, s’entendant d’abord comme la non-soumission à l’autorité d’autres hommes. Cependant, il doute que la seule volonté suffise à guider les hommes vers la morale, insistant sur le rôle des grands législateurs (Moïse, Numa Pompilius, Lycurgue) ou des éducateurs.
La « généralité » de la volonté se situe entre le particulier et l’universel. Rousseau s’oppose à Diderot, qui conçoit une volonté générale du genre humain et une morale universelle. Rousseau, s’inspirant de Rome, Sparte ou Genève, insiste sur l’importance des particularismes nationaux. Il laïcise et démocratise l’expression « volonté générale », qui, avant lui, désignait la volonté de Dieu chez d’autres philosophes.
La notion de volonté générale est ambiguë, pouvant être interprétée démocratiquement (ce que les citoyens décident) ou de manière transcendante (l’intérêt général abstrait des intérêts particuliers). Rousseau estime que, dans de bonnes conditions de délibération, la volonté générale issue des citoyens doit correspondre à la volonté générale transcendante, mais cette identité n’est pas garantie. Il craint que la rhétorique et la communication directe entre citoyens ne compromettent la qualité de la délibération, critiquant ainsi la démocratie athénienne comme étant une « aristocratie très tyrannique ».
📜 Droit et Loi : Une Distinction Fondamentale
Rousseau distingue le droit naturel et le droit politique. Le droit naturel, bien que poussant les êtres humains à suivre l’amour de soi et la pitié, ne peut plus assurer son respect à l’échelle mondiale une fois l’interdépendance économique développée et l’amour de soi transformé en amour-propre.
Le droit politique, quant à lui, vise à établir positivement une société qui permette aux hommes de bien vivre, non pas en revenant à l’état de nature, mais en menant une « vie bonne ». Il distingue trois types de justice : divine, universelle (celle de Diderot, purement rationnelle), et humaine (celle de Rousseau, liée à un corps politique spécifique et non au monde entier). Pour Rousseau, la justice humaine nécessite des conventions et des lois pour unir droits et devoirs et ramener la justice à son objet.
🧑🤝🧑 Corps Politique et Citoyenneté
Le corps politique n’est pas naturel pour Rousseau, contrairement à Aristote pour qui l’homme est un animal politique. Il naît de la convention et du consentement, permettant l’agrégation des ressources et la mise en commun des forces. Ses termes pour le désigner incluent « société bien constituée », « peuple », « République », « État » ou « Souverain ». Son but est de transformer le contrat social inégalitaire en une association qui protège la personne et les biens de chacun, tout en permettant à chacun de n’obéir qu’à lui-même et de rester aussi libre qu’auparavant.
Le vrai contrat social provoque un changement de perspective : l’homme devient citoyen, apprenant à se considérer comme partie d’un tout, à écouter le devoir et la raison. Le patriotisme est essentiel pour souder les citoyens et faciliter leur adhésion à la volonté générale. La pitié, chez le citoyen, doit céder la place à la réciprocité, car les engagements sociaux sont obligatoires parce qu’ils sont mutuels.
L’égalité n’est pas une fin en soi, mais un moyen de sécuriser la liberté politique, qui ne peut exister qu’entre égaux. Rousseau ne s’oppose pas aux inégalités justifiées par les efforts, mais à celles qui ne le sont pas par la nature. Il cherche à allier « ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit », afin que « justice et utilité ne se trouvent point divisées ».
👑 La Souveraineté du Peuple et le Gouvernement
Chez Rousseau, le peuple, en tant qu’ensemble des citoyens, est souverain ; c’est de lui que vient la volonté générale et le droit législatif. Toutefois, le peuple souverain ne gouverne pas.
Rousseau n’est pas très favorable à la démocratie représentative, lui préférant une forme de démocratie directe inspirée des modèles antiques. Voter seulement, c’est disposer d’une souveraineté intermittente. Il critique le système anglais où le peuple n’est libre que le jour des élections, redevenant esclave une fois ses représentants élus. Il affirme que « la souveraineté ne peut être représentée » et que « toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ». Malgré cela, certains interprètes estiment que son rejet de toute représentation n’est pas aussi absolu qu’il le laisse entendre.
Comme chez Hobbes, les citoyens, en s’associant, perdent tous leurs droits naturels, y compris le contrôle du pouvoir souverain.
Rousseau insiste sur la nécessaire séparation du gouvernement (exécutif) et du législatif (le souverain). Le gouvernement administre l’État en appliquant les lois, tandis que le souverain promulgue des lois générales. Il craint que le gouvernement n’usurpe le pouvoir souverain, ce qui rend sa pensée quelque chose de tragique.
Il distingue trois formes de gouvernement :
- La démocratie pure ou directe : adaptée aux petits États vertueux et égalitaires.
- La monarchie : peu prisée par Rousseau, qui la voit favoriser les courtisans au détriment de la compétence et convenir aux nations opulentes.
- L’aristocratie :
- Héréditaire : à proscrire.
- Naturelle : possible seulement dans les petits États.
- Élective : considérée comme le meilleur mode de gouvernement ou « gouvernement tempéré ». Elle exige modération des riches et contentement des pauvres, l’égalité rigoureuse n’y étant pas nécessaire.
⛪ Religion Civile et Droit International
Rousseau aborde la question de la religion civile dans Du contrat social. Pour lui, les premiers corps politiques étaient fondés par de grands législateurs et validés par des dieux, conférant au contrat social une dimension transcendante. Le christianisme, en se souciant des hommes plutôt que des citoyens, a brisé le lien entre la religion et le corps politique, divisant la souveraineté des États. Pour restaurer cette unité, Rousseau propose une religion civile avec des dogmes positifs, tels que l’existence d’une divinité bienveillante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, et la sainteté du contrat social et des lois.
Concernant le droit international (qu’il nomme « droit des nations »), Rousseau le considère comme une chimère, car il est difficile de « punir » un État souverain. Il ne voit pas la guerre comme un conflit d’individus, mais comme une lutte entre entités morales, visant à briser la volonté générale de l’État ennemi.
影響 Impact et Postérité : Un Héritage Complexe et Discuté
La pensée de Rousseau a exercé une influence considérable, notamment sur la Révolution française et le républicanisme français, mais a aussi été l’objet de vives controverses.
🇫🇷 Rousseau et la Révolution Française
Des royalistes comme Charles Maurras voient en Rousseau l’inspirateur de la Révolution et la source de tous les maux de la France, reprenant une tradition contre-révolutionnaire initiée par Edmund Burke et Joseph de Maistre.
Les universitaires adoptent une approche plus nuancée. Avant la Révolution, Rousseau est surtout connu pour l’Émile et ses Discours. Ce n’est qu’après 1789 que ses écrits politiques sont « redécouverts » et marquent les révolutionnaires, notamment les Montagnards comme Robespierre. L’idée rousseauiste que l’homme s’est éloigné de la nature et que les peuples peuvent connaître une « seconde naissance » a profondément marqué.
Cependant, Rousseau lui-même exprimait un certain conservatisme politique, craignant de « troubler l’ordre établi » et de « secouer les masses » de la monarchie française. Pour Jean Starobinski, Rousseau était « certainement sincère » quand il se défendait d’avoir voulu « renverser les institutions de la France monarchique », présentant le Contrat social comme une œuvre de « réflexion abstraite ». Sa pensée révolutionnaire s’appuie sur une « nature humaine éternelle », non sur un progrès historique.
🤔 La Critique de Hannah Arendt
Hannah Arendt critique Rousseau sur deux points majeurs : son identification de la souveraineté au pouvoir et le rôle politique qu’il accorde à la pitié. Pour Arendt, la primauté de la question sociale, influencée par Rousseau, aurait empêché la Révolution d’instaurer la liberté. Elle estime que la pitié, en tant qu’émotion, n’est pas un sentiment politique constructif, et lui préfère la solidarité, qui relève de la raison.
🏛️ Rousseau et la Tradition Républicaine en France
Claude Nicolet soutient que Rousseau a fourni le socle théorique de la notion de république en France, notamment à travers ses concepts de souveraineté et de théorie de la loi. Rousseau est considéré comme l’une des trois « sources » de la doctrine républicaine française, aux côtés de Kant et du positivisme, offrant une légitimité historique face aux monarchistes et aux catholiques.
L’héritage de Rousseau pour la république française serait triple : la souveraineté populaire, la définition de la loi comme expression de la volonté générale, et une théorie de la vertu comme visée d’intérêt général. Cependant, Rousseau est absent du renouveau de la pensée républicaine contemporaine, qui s’inscrit davantage dans la tradition de Cicéron et Machiavel.
💬 Le Concept de Souveraineté et ses Dénonciations
La notion rousseauiste de souveraineté a été la cible de nombreuses critiques. Jacques Maritain y voit un « mythe de la Volonté générale », un moyen de transférer au peuple le pouvoir absolu du roi, mais qui est « destructrice de la démocratie » et tend vers l’État totalitaire. Il compare l’État de Rousseau au « Léviathan de Hobbes couronné par la Volonté générale ».
Alain de Benoist observe que, contrairement aux philosophes des Lumières qui voulaient limiter les prérogatives du pouvoir, Rousseau fait de la souveraineté la « pierre angulaire de tout son système politique ». Pour lui, la souveraineté est indivisible, et Rousseau rejette toute séparation des pouvoirs. Son objectif est de remplacer le roi de droit divin par le peuple souverain, sans abandonner l’idée d’une souveraineté absolue. Il se montre indifférent à la forme du gouvernement tant que le peuple détient la puissance législative, l’exécutif pouvant être aristocratique.
📉 Influence sur les Libéralismes
Dès 1788, Madame de Staël critique Rousseau, et Benjamin Constant le tient pour responsable de la Terreur, reprochant au philosophe de ne pas avoir posé de limite à la souveraineté populaire. Constant lui reproche aussi d’être resté attaché à la « liberté des anciens » (politique) sans envisager la « liberté des modernes » (individuelle et économique).
Au tournant du XIXe et XXe siècles, des libéraux comme Émile Faguet et Léon Duguit accuseront Rousseau d’avoir sacrifié l’individu à l’État, Duguit le qualifiant même d’initiateur de « toutes les doctrines de dictature et de tyrannie, depuis les doctrines jacobines de 1793 jusqu’aux doctrines bolcheviques de 1920 ». Cette accusation est reprise pendant la Guerre Froide, où Rousseau est vu comme un des pères du totalitarisme par des libéraux comme Jacob Leib Talmon. Friedrich Hayek l’associe au constructivisme, voyant en lui une nostalgie d’une société guidée par des émotions « naturelles » qui mènerait au socialisme.
Paradoxalement, Christopher Bertram note des proximités entre la philosophie politique libérale de John Rawls et la pensée de Rousseau, notamment dans l’introduction de la « position originelle » pour servir la justice, rappelant l’impartialité rousseauiste des lois.
🇩🇪 Influence sur la Philosophie Allemande
Rousseau a profondément influencé Emmanuel Kant, qui possédait son portrait et fut absorbé par la lecture de l’Émile. La notion rousseauiste de volonté générale imprègne l’impératif catégorique de Kant. Cependant, Rousseau s’oppose à l’idée kantienne d’une législation universelle, car pour lui, la volonté générale n’apparaît que dans le cadre de l’État.
La relation avec Hegel est complexe : s’il salue la volonté comme base de l’État, Hegel semble mal comprendre la notion de volonté générale chez Rousseau. Il reprend néanmoins les concepts d’amour-propre et la dynamique de la reconnaissance.
Schopenhauer considérait Rousseau comme le « plus grand des moralistes modernes », capable de « moraliser sans ennuyer » car il puisait sa sagesse dans la vie et la vérité.
☭ Rousseau, le Socialisme et le Marxisme
La pensée de Rousseau a influencé divers mouvements révolutionnaires et socialistes, des révolutionnaires de 1830 et 1848 aux Communards de 1871, en passant par les anarchistes. Des économistes libéraux comme Frédéric Bastiat voient en Saint-Simon et Fourier les « fils de Rousseau », tandis que des socialistes comme Jean Jaurès le considèrent comme un précurseur du socialisme. Célestin Bouglé estime même que sa théorie des lois « ouvre directement la voie au socialisme ».
Sa place donnée aux antagonismes sociaux issus de la division des tâches et de la propriété privée fait de lui un précurseur du marxisme. Toutefois, Marx le cite rarement et de manière négative, lui reprochant de ne pas assez prendre en compte les rapports sociaux. La lecture marxiste des années 1960 critique la notion de volonté générale comme s’opposant aux luttes de classes. Au XXIe siècle, le marxisme contemporain, notamment autour de Toni Negri, est très critique envers Rousseau, le voyant comme un penseur de la souveraineté (concept jugé réactionnaire) et un promoteur d’une vision juridique qui encourage une bureaucratisation du pouvoir.
🌳 Rousseau et le Courant « Urbaphobe »
Rousseau est considéré comme l’un des fondateurs du courant « urbaphobe » qui critique la grande ville. Son idéal, exprimé dans l’Émile, est celui de la ferme isolée, vivant en autarcie sous un régime patriarcal, où le monde est délimité par les activités familiales et les besoins essentiels.
🤝 Rousseau comme Fondateur de l’Anthropologie
Claude Lévi-Strauss a affirmé que Rousseau « ne s’est pas borné à prévoir l’ethnologie : il l’a fondée ». Lévi-Strauss souligne son projet anthropologique de distinguer la nature de la culture dans les sociétés humaines, ainsi que son injonction à voyager pour « étudier l’homme » en observant les « différences pour découvrir les propriétés ». Il déplorait le peu d’intérêt de ses contemporains pour l’étude des cultures et des mœurs.
L’introspection, caractéristique de la pensée de Rousseau, est également une de ses influences sur l’anthropologie. Pour Lévi-Strauss, l’observateur ethnographique, étant son propre instrument, doit faire preuve d’introspection pour écarter ses biais, contrairement à Descartes qui ne voyait pas les sociétés entre l’intériorité de l’homme et l’extériorité du monde.
En somme, Jean-Jacques Rousseau demeure une figure complexe et fondamentale, dont la pensée, bien que source de divisions, continue d’enrichir les débats sur la nature humaine, la société et le pouvoir.