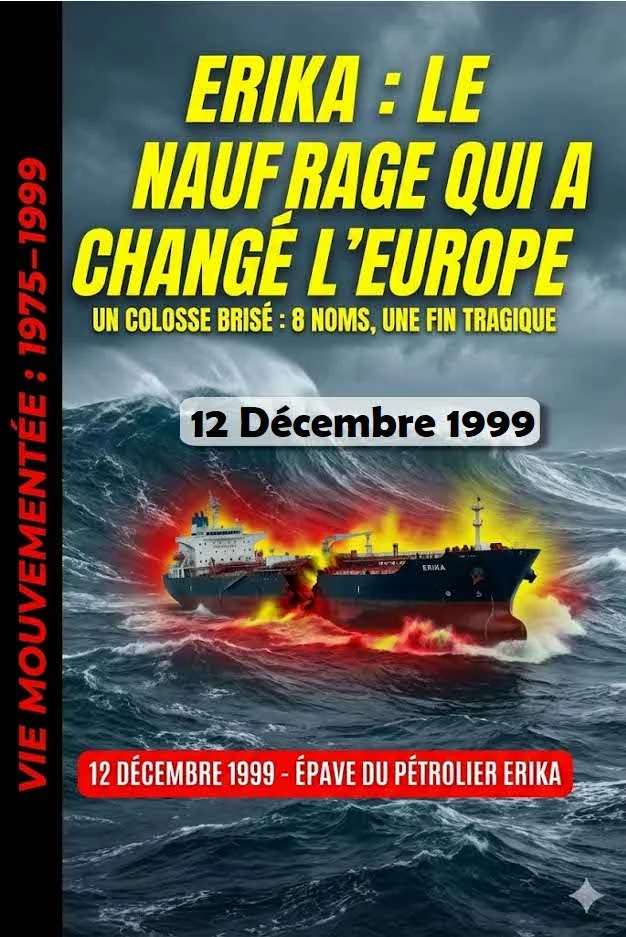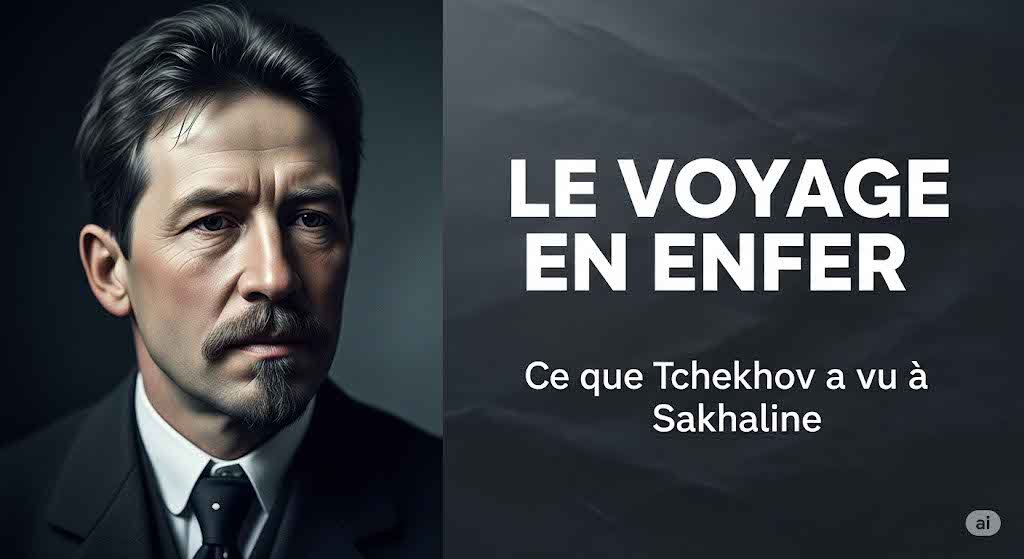Les liens pour vous procurer les différentes versions
Le Grand Incendie de Londres. Récits, avec incises et bifurcations
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/4mHWYPf
Le Grand Incendie de Londres de 1666 : Une Cité Dévastée, une Nation Transformée 🔥🏙️
Le Grand Incendie de Londres, un événement cataclysmique qui a ravagé la capitale anglaise en 1666, demeure l’une des catastrophes urbaines les plus marquantes de l’histoire. Du dimanche 2 septembre au mercredi 5 septembre, les flammes ont consumé le cœur de la Cité, laissant derrière elles un paysage de désolation, mais ouvrant aussi la voie à une reconstruction ambitieuse et à des changements profonds. Cet article explore les origines de ce sinistre, son déroulement dramatique, ses conséquences dévastatrices et l’héritage durable qu’il a laissé.
Contexte Londonien : Une Poudrière Urbaine au XVIIe Siècle 🔥🏘️
Pour comprendre l’ampleur du Grand Incendie, il est essentiel de se plonger dans le Londres du milieu du XVIIe siècle. La ville était alors une métropole en pleine effervescence, mais aussi un agrégat de vulnérabilités.
Une Mégalopole Anarchique et Dangereuse 🏚️🚧
En 1660, Londres était de loin la plus grande ville de Grande-Bretagne, avec une population estimée à un demi-million d’habitants. Cependant, loin de la magnificence baroque de Paris, elle était décrite en 1659 par John Evelyn comme un « agrégat anarchique, nordique, de maisons de bois » [Trad 1, 4]. Le terme « anarchique » (« inartificial ») soulignait son développement non planifié et improvisé, résultat d’une croissance démographique rapide et d’un étalement urbain non régulé.
La Cité, enserrée dans son mur romain, était devenue trop étroite. Des faubourgs pauvres comme Shoreditch, Holborn ou Southwark s’étaient étendus au-delà des murs, englobant même Westminster, la cité indépendante à l’ouest. La Cité proprement dite, entre le mur et la Tamise, couvrait seulement 2,8 km² et comptait environ 80 000 habitants, soit un sixième de la population londonienne. Malgré sa taille réduite, elle était le centre économique de la capitale, le plus grand marché et port d’Angleterre, dominé par les classes marchande et industrielle. L’aristocratie, quant à elle, préférait la campagne ou le quartier de Westminster, loin d’une Cité encombrée, polluée et insalubre, surtout après la Grande Peste de 1665.
Le plan des rues de la Cité était un héritage médiéval : un réseau de voies pavées étroites, tortueuses et surpeuplées. Le bois et le chaume, bien qu’interdits depuis des siècles en tant que matériaux de construction, persistaient en raison de leur faible coût. Les constructions en pierre ne dominaient que dans le cœur de la Cité, où les demeures des marchands et des courtisans étaient plus espacées. Autour, dans les paroisses plus pauvres, chaque pouce de terrain était exploité pour répondre à la croissance démographique rapide.
Ces paroisses abritaient également de nombreuses activités présentant des risques élevés d’incendie : fonderies, forges, vitreries, souvent tolérées malgré les interdictions. Les immeubles d’habitation eux-mêmes, fréquemment hauts de six ou sept étages et construits en bois, augmentaient le danger. Leurs encorbellements, augmentant progressivement la taille des étages supérieurs, empiétaient sur la rue au point que les maisons opposées se touchaient presque. Ce risque était connu : « il facilite la conflagration tout en entravant son remède » [Trad 2, 6], mais « l’avarice des citoyens et la connivence [la corruption] des magistrats » [Trad 3, 6] empêchaient leur disparition. Des proclamations royales en 1661 et 1665, interdisant les fenêtres en saillie et les encorbellements, et autorisant l’emprisonnement des bâtisseurs récalcitrants, n’eurent que peu d’incidence.
Les berges de la Tamise, bien qu’offrant un moyen de fuite et d’approvisionnement en eau, étaient également des zones à très haut risque d’incendie. Elles regorgeaient d’entrepôts et de magasins de combustibles, avec des « bâtiments de vieux papiers et les matières les plus combustibles, goudron, bitume, chanvre, résine et lin, accumulées alentour » [Trad 4, 7]. De grandes quantités de poudre noire étaient également entreposées en ville, y compris chez d’anciens soldats et, de manière massive, dans la Tour de Londres.
Tensions entre la Cité et la Couronne 👑⚔️
Les relations entre la Cité et la Couronne étaient tendues. Durant la Première Guerre civile (1642-1651), la Cité de Londres avait été un bastion républicain. Les soulèvements républicains du début des années 1660 rappelaient à Charles II que cette capitale riche et dynamique pouvait encore être une menace. Les magistrats de la Cité, marqués par le traumatisme des prétentions absolutistes de Charles Ier, le père de Charles II, refusaient l’assistance du roi lorsque l’incendie menaçait la ville, trouvant l’idée de troupes royales inconcevable. Cette méfiance allait avoir des conséquences dramatiques sur la gestion initiale de la catastrophe.
L’Embrasement : Origine et Propagation Infernale 🍞💨
Le Grand Incendie de Londres a débuté de manière anodine, mais sa propagation rapide a été le fruit d’une combinaison fatale de facteurs.
Le Dimanche 2 Septembre : L’Étincelle à Pudding Lane 🕯️🔥
Après deux étés pluvieux en 1664 et 1665, Londres subissait une sécheresse exceptionnelle depuis novembre 1665, rendant le bois des bâtiments extrêmement sec. C’est dans ce contexte propice qu’un incendie se déclare peu après minuit le dimanche 2 septembre dans la boulangerie de Thomas Farriner (ou Farynor) sur Pudding Lane. La famille Farriner parvient à s’échapper par une fenêtre vers une maison voisine, à l’exception d’une servante, trop terrifiée pour sauter, qui devient la première victime enregistrée. Les tentatives des voisins pour éteindre le feu sont vaines.
L’Incompétence du Lord-Maire et la Rage du Vent 💨🤦♂️
Arrivé sur les lieux une heure plus tard, le parish constable juge nécessaire de détruire les maisons adjacentes pour prévenir la propagation. Cependant, face aux protestations des propriétaires, il faut l’autorisation du lord-maire, Thomas Bloodworth, pour imposer cette décision. Le temps qu’il arrive, les demeures voisines ont déjà pris feu et les flammes se dirigent vers les entrepôts des quais. Les pompiers expérimentés réclament la démolition, mais Bloodworth refuse, arguant que la plupart des demeures sont louées et que les propriétaires sont introuvables. Élu davantage pour ses capacités de sycophante que pour ses compétences, le lord-maire cède à la panique et quitte les lieux en déclarant, de façon tristement célèbre : « Fi ! Une femme pourrait l’éteindre en pissant dessus » [Trad 6, 17]. Samuel Pepys, diariste célèbre, écrira plus tard que le peuple tenait Bloodworth « entièrement responsable » de la catastrophe [Trad 7, 17].
L’incendie de la boulangerie de Pudding Lane s’étend d’abord plein ouest, attisé par un fort vent d’est. Vers 7 heures du matin, Pepys observe depuis la Tour de Londres un déluge de flammes qui a incendié plusieurs églises et environ 300 maisons, atteignant la rive du fleuve et les maisons sur le pont de Londres. Une inspection plus rapprochée révèle un spectacle « lamentable », avec des gens s’enfuyant avec leurs biens ou les jetant dans le fleuve [Trad 8, 18].
La Réaction Royale, Tardive et Chaotique 👑📢
Pepys se rend ensuite à Whitehall pour informer le roi Charles II et le duc d’York de la gravité de la situation. Il leur explique que seule la destruction des maisons pourrait arrêter l’incendie. Fort troublés, le Roi ordonne à Pepys de transmettre au lord-maire l’ordre de « n’épargner aucune maison » [Trad 9, 19]. Le duc d’York offre également les services des Royal Life Guards.
Cependant, les efforts sont entravés par la panique généralisée. Les tarifs des barges et des chariots s’envolent, rendant la fuite coûteuse. La masse humaine, les ballots et les carrioles bloquent les rues, empêchant les pompiers d’avancer. Lorsque Pepys retourne en ville, il doit abandonner son fiacre et continuer à pied, tant les rues sont engorgées. Les églises, loin des flammes, se remplissent de biens précieux.
Le lord-maire Bloodworth, au bord de l’effondrement, gémit au message du roi qu’il démolit bien des maisons, mais que « le feu nous rattrape plus rapidement que nous ne pouvons le faire » [Trad 11, 21]. Il refuse l’aide des soldats du duc d’York et se retire. Charles II doit finalement outrepasser l’autorité de Bloodworth et ordonner lui-même des destructions massives, mais le retard pris rend ces manœuvres largement inutiles, l’incendie étant déjà hors de contrôle.
Dans la soirée, 18 heures après le début de l’alarme, l’incendie est devenu une tempête de feu, générant et perpétuant son propre système de vents. L’effet de cheminée provoque une gigantesque remontée d’air chaud, créant des turbulences qui alimentent les flammes et les propagent de manière chaotique. Pepys observe depuis la Tamise, sentant une « pluie de braises » et décrivant une « seule arche de flammes de ce côté-ci du pont à l’autre » [Trad 12, Trad 13, 23].
La Lutte Désespérée : Moyens et Obstacles Face au Brasier 🔥🚒
Au XVIIe siècle, les incendies étaient monnaie courante à Londres, mais les moyens de lutte étaient rudimentaires et souvent inadaptés à une catastrophe d’une telle ampleur.
Des Méthodes Traditionnelles Inefficaces 🧯❌
Londres, ville surpeuplée et majoritairement construite en bois, avec ses foyers ouverts et ses bougies, était constamment sous la menace du feu. Il n’existait pas de corps de sapeurs-pompiers professionnels. La milice locale, les Trained Bands, et le guet de la ville étaient censés intervenir. Les procédures communautaires impliquaient la sonnerie des cloches et la réunion des citoyens pour combattre le feu. Chaque église paroissiale devait disposer d’échelles, de seaux en cuir, de haches et de « crochets à incendie » pour abattre les bâtiments, la technique principale de lutte. Pour les constructions plus imposantes, on utilisait parfois de la poudre à canon pour créer des coupe-feu, une méthode qui s’avérera cruciale à la fin du Grand Incendie.
Les Défis de l’Eau et de l’Urbanisme 💧🚫
La lutte contre le Grand Incendie a souffert de multiples problèmes.
- L’étroitesse des rues de la Cité, déjà encombrées en temps normal, est devenue impraticable avec les sinistrés fuyant le feu, gênant les équipes de démolition.
- Le lord-maire Thomas Bloodworth a retardé les ordres de démolition nécessaires, malgré les demandes. Quand le roi a finalement ordonné de « n’épargner aucune maison », il était déjà trop tard et les rues bondées empêchaient les démolisseurs d’agir efficacement.
- L’emploi de l’eau a également rencontré des difficultés. Londres bénéficiait d’un système de tuyaux en orme desservant 30 000 maisons, alimenté par la Tamise et un réservoir d’eau de source. En théorie, il était possible d’utiliser ce système pour les lances à incendie ou les seaux. De plus, Pudding Lane, le point de départ du feu, était proche du fleuve. Cependant, les gens, terrifiés, s’enfuyaient plutôt que d’éteindre le feu [Trad 5, 11]. L’incendie s’est propagé jusqu’aux quais, coupant l’accès au fleuve et aux norias alimentant le château d’eau de Cornhill, privant simultanément la ville d’accès direct à l’eau et de l’approvisionnement en eau courante.
L’Échec des Pompes et des Démolitions 🚒💔
Londres possédait des fourgons d’incendie montés sur roues ou patins, une technologie avancée pour l’époque. Cependant, ils s’étaient rarement avérés efficaces lors d’incendies précédents, manquant de maniabilité, de portée (faute de tuyaux assez longs) et arrivant souvent trop tard. En 1666, ces fourgons se sont avérés inefficaces, n’ayant plus accès à l’eau courante et étant incapables d’approcher de Pudding Lane en raison de l’intense chaleur. Plusieurs sont même tombés dans la Tamise lors des opérations de remplissage.
Le pont de Londres, couvert de maisons, était un piège mortel, comme l’incendie de 1632 l’avait montré. En 1666, les maisons du pont ont brûlé dès le dimanche matin. On craignait que les flammes ne traversent le pont pour menacer Southwark, mais un espace vide entre les bâtiments a agi comme un coupe-feu, épargnant la rive sud.
Le mur romain de 5,5 mètres de haut, bien que protégeant la Cité, menaçait de piéger les habitants. Lorsque l’accès à la Tamise fut coupé, les huit portes du Mur devinrent le seul moyen de fuir. Pendant les deux premiers jours, de nombreux sinistrés se contentaient de déplacer leurs biens d’un lieu sûr à un autre, souvent des églises ou les abords de la cathédrale Saint-Paul. Ce n’est que tard le lundi que la fuite hors des murs s’est imposée, créant des scènes de panique aux portes, trop étroites pour le flot de personnes, de biens et de véhicules.
Chronique d’une Cité en Cendres : Jour Après Jour 🗓️💥
Les témoignages des diaristes célèbres, Samuel Pepys et John Evelyn, ainsi que de William Taswell, un écolier, sont cruciaux pour comprendre l’évolution du sinistre.
Le Lundi 3 Septembre : La Panique et les Rumeurs 😱🗣️
À l’aube du lundi, le feu s’étend principalement vers le nord et l’ouest, avec des turbulences qui le poussent également au sud. Si la Tamise contient l’incendie au sud, le quartier de Southwark est sauvé grâce à la large brèche coupe-feu sur le pont de Londres. Un départ de feu à Southwark dû à des braises volantes est rapidement maîtrisé.
La poussée de l’incendie vers le nord atteint le cœur de la Cité. L’après-midi, les maisons des banquiers de Lombard Street sont menacées, entraînant une ruée pour sauver les réserves de pièces d’or. Le désespoir et le sentiment d’impuissance saisissent les Londoniens ; il y a un manque d’efforts concertés pour sauver des quartiers riches comme le Royal Exchange (bourse et centre commercial) ou les boutiques de Cheapside. Le Royal Exchange s’embrase en début de soirée et est réduit en carcasse fumante. John Evelyn, qui observe l’incendie depuis Southwark, note le « désespoir » et la « consternation » des gens qui « luttèrent à peine pour l’éteindre » [Trad 14, 26]. Il décrit le fleuve couvert de barges surchargées et l’exode chaotique par les portes de la Cité vers les terrains non bâtis au nord et à l’est, où des tentes sont érigées.
C’est à ce moment que les rumeurs d’un incendie non accidentel commencent à circuler, alimentées par de nouveaux départs de feu (en réalité dus à des braises volantes). L’Angleterre étant en guerre contre les Provinces-Unies, les étrangers deviennent la cible de tous les soupçons. Des rumeurs d’invasion imminente et d’agents étrangers lançant des « boules de feu » donnent lieu à des lynchages. William Taswell assiste au pillage d’une boutique française et à une agression violente.
La destruction des infrastructures de communication, comme le General Letter Office et l’imprimerie de la London Gazette, renforce la terreur et permet aux rumeurs de conspiration de prospérer. Les Trained Bands et les Coldstream Guards passent alors plus de temps à gérer les étrangers et les catholiques qu’à lutter contre le feu.
Le coût de la vie augmente drastiquement ; la location d’une charrette, qui coûtait quelques shillings le samedi, monte à quarante livres sterling le lundi. Cela attire même des habitants des environs cherchant à profiter de la situation. Les magistrats ordonnent de fermer les portes de la ville pour forcer les citadins à combattre l’incendie, une mesure infructueuse rapidement annulée.
L’Intervention du Duc d’York et les Actes de Violence 👑👮♂️
Face à l’absence du lord-maire Bloodworth, Charles II passe outre les autorités de la Cité et charge son frère, le duc d’York (futur Jacques II), de diriger les opérations. Le duc installe des postes de commandement autour du périmètre de l’incendie et enrôle de force les citoyens des classes inférieures dans des équipes de pompiers bien payées et nourries. Trois courtisans sont placés à la tête de chaque poste, avec l’autorité d’ordonner les destructions nécessaires, et la garantie que les citoyens ne seraient pas tenus financièrement responsables. Le duc patrouille lui-même avec ses gardes pour maintenir l’ordre et protéger les étrangers de la foule. Un témoin écrit que le duc d’York « a conquis le cœur du peuple avec ses efforts continuels et infatigables jour et nuit pour aider à éteindre le feu » [Trad 16, 33]. En soirée, le château de Baynard, un ancien palais royal, brûle.
Le Mardi 4 Septembre : Le Paroxysme de la Destruction 🌋⛪
Le mardi 4 septembre est la journée où les dégâts sont les plus importants. Le poste de commande du duc d’York à Temple Bar tente d’arrêter l’avance de l’incendie vers l’ouest et Whitehall. On espère que la Fleet (une rivière) formera un coupe-feu naturel, mais tôt le matin, les flammes bondissent par-dessus la Fleet, débordant les hommes du duc et provoquant la consternation à la cour.
Les pompiers du duc d’York pratiquent un large coupe-feu au nord de l’incendie, le contenant jusqu’à la fin de l’après-midi, avant que les flammes ne le franchissent pour attaquer Cheapside. À l’ouest de Cheapside, la cathédrale Saint-Paul semble un refuge inviolable avec ses murs de pierre et sa place environnante. C’est là que les citadins ont entassé leurs biens et que les imprimeurs ont entreposé leurs réserves dans les cryptes.
Cependant, la cathédrale était alors en pleine restauration, entourée d’échafaudages en bois. Ces échafaudages prennent feu dans la nuit du mardi au mercredi. Le jeune William Taswell observe les flammes encercler la cathédrale et se propager au toit. En une demi-heure, le plafond en plomb fond, les livres et papiers s’enflamment dans les cryptes. Evelyn décrit des « pierres de Saint-Paul volaient comme des grenades, le plomb fondu coulait en ruisseaux dans les rues, et les pavés même luisaient d’un rougeoiement féroce » [Trad 18, 36]. La cathédrale est rapidement réduite en ruines.
Pendant la journée, les flammes commencent à se diriger vers l’est, face au vent d’est, en direction de la Tour de Londres et de ses réserves de poudre. La garnison de la Tour, après avoir attendu en vain l’aide des pompiers, décide de prendre les choses en main et de créer des coupe-feu en faisant exploser de nombreuses maisons du voisinage, ralentissant l’avancée des flammes.
Le Mercredi 5 Septembre : L’Espoir et la Détresse des Sinistrés 🌤️⛺
Le vent tombe dans la soirée du mardi, permettant aux coupe-feu pratiqués par la garnison de la Tour de faire effet le lendemain. Pepys traverse la cité fumante, se brûlant les pieds, et contemple les ruines depuis la flèche de Barking Church, décrivant la « plus triste vision de désolation que j’aie jamais vue » [Trad 19, 38]. Les grands incendies sont terminés, même si de nombreux feux mineurs persistent.
Pepys et Evelyn se rendent ensuite aux Moorfields, un vaste terrain vague au nord de la Cité, devenu un immense campement de sinistrés. Pepys note que le prix du pain a doublé. Evelyn est horrifié par le nombre de personnes et leurs conditions de vie : « beaucoup [étaient] sans le moindre haillon ou ustensile indispensable, sans lit ni planche […] réduits à la plus extrême misère et pauvreté » [Trad 20, 38]. Il est néanmoins impressionné par leur fierté, ne demandant « pas le moindre penny pour les soulager » [Trad 21, 38].
La peur des terroristes étrangers est plus forte que jamais. Dans la nuit du mercredi au jeudi, une panique généralisée éclate dans les camps des Moorfields et d’Islington. Une lumière dans le ciel est interprétée comme le soulèvement de 50 000 immigrants français et hollandais. La foule terrifiée s’en prend aux étrangers, difficilement calmée par les Trained Bands, les Life Guards et des membres de la cour. La situation est si tendue que le roi craint une révolte. Charles II annonce un approvisionnement quotidien en pain et l’établissement de marchés, mais sans distribution gratuite de nourriture.
Bilan Dévastateur : Entre Pertes Humaines et Matérielles 💔🏗️
Le Grand Incendie a laissé une cicatrice indélébile sur Londres, tant sur le plan humain que matériel.
Un Nombre de Victimes Controversé 👥❓
Le nombre officiel de victimes directes de l’incendie est étonnamment faible : huit morts selon Porter, moins de dix selon Tinniswood. Cependant, Tinniswood admet que des victimes ont pu passer inaperçues et qu’il y a eu des morts dans les campements provisoires. Hanson rejette ce bilan, soulignant que des personnes, comme le dramaturge James Shirley et son épouse, sont mortes de faim et de froid l’hiver suivant. Il estime « crédulité de croire que tous les seuls papistes ou étrangers battus à mort ou lynchés ont été sauvés par le duc d’York ».
Hanson met en lumière plusieurs facteurs qui expliquent un bilan humain officiellement sous-estimé :
- Les chiffres officiels ne tiennent pas compte des pauvres non recensés.
- La chaleur au centre du brasier, alimentée non seulement par le bois et le chaume, mais aussi par de l’huile, du bitume, du charbon, du suif, de la graisse, du sucre, de l’alcool, de la térébenthine et de la poudre à canon, était colossale. Elle était suffisante pour faire fondre l’acier (1 250-1 480 °C) et le fer (1 100-1 650 °C). Une telle chaleur aurait pu consumer entièrement les corps, ne laissant que des fragments d’os.
- Les fragments d’os anonymes n’auraient eu aucun intérêt pour les affamés cherchant des biens de valeur ou pour les travailleurs déblayant les décombres.
- L’incendie a ravagé très rapidement les demeures délabrées des pauvres, piégeant sans doute « les vieux, les très jeunes, les lents et les infirmes ».
Ainsi, le bilan réel des victimes pourrait être de « plusieurs centaines et assez vraisemblablement de plusieurs milliers ».
L’Ampleur Sans Précédent des Dégâts Matériels 💔🏢
Les dégâts matériels furent immenses. L’incendie a ravagé :
- 13 200 maisons
- 87 églises paroissiales
- La cathédrale Saint-Paul
- La majorité des bâtiments publics de la Cité
- 44 maisons de guilde
- Le Royal Exchange
- La Custom House
- Plusieurs prisons, dont Bridewell Palace
- Le General Letter Office
- Les trois portes occidentales de la Cité : Ludgate, Newgate et Aldersgate
On estime que le désastre a coûté leur domicile à environ 70 000 des 80 000 Londoniens. Le coût total, d’abord estimé à 100 millions de livres de l’époque, fut ramené à un chiffre incertain de 10 millions de livres. Evelyn estima avoir vu plus de « 200 000 personnes de tous rangs et statuts dispersés, installés près de piles de ce qu’ils avaient pu sauver » dans les champs d’Islington et de Highgate. Les flammes ont ravagé la Cité à l’intérieur du mur romain, menaçant le quartier aristocratique de Westminster et le palais de Whitehall sans toutefois les atteindre.
La Reconstruction : Une Nouvelle Londres Émerge des Cendres ✨🏙️
Le Grand Incendie, malgré sa dévastation, a offert une opportunité unique de repenser et de reconstruire la capitale.
La Quête d’un Bouc Émissaire scapegoat 🕵️♂️
Un bouc émissaire fut rapidement trouvé en la personne de Robert Hubert, un horloger français simple d’esprit de Rouen. Dans sa confession, il déclara être un agent du pape et avoir allumé l’incendie à Westminster, avant de se contredire et de mentionner la boulangerie de Pudding Lane. Malgré les doutes sur sa santé mentale, Hubert fut reconnu coupable et pendu à Tyburn le 28 septembre 1666. Après son exécution, il fut découvert qu’il n’était arrivé à Londres que deux jours après le début de l’incendie. Le parti opposé à la cour pro-catholique de Charles II n’hésita pas à reprendre les rumeurs accusant les catholiques d’avoir allumé l’incendie, notamment lors du complot papiste de 1678. Le boulanger Thomas Farriner fut brièvement inquiété, mais la confession de Hubert leva les soupçons pesant sur lui.
Les Défis de la Planification Urbaine 📐🚧
Craignant une rébellion des sinistrés, Charles II les encouragea à quitter Londres, proclamant que toutes les villes devaient les accueillir et leur permettre d’exercer leur commerce. Un tribunal spécial, la Fire Court, fut créé (février 1667 – septembre 1672) pour régler les litiges entre locataires et propriétaires, permettant une reconstruction rapide en évitant de longues procédures.
Plusieurs lois, le Rebuilding of London Act 1666 et le Rebuilding of London Act 1670, furent adoptées par le Parlement pour encadrer la reconstruction. Des projets urbanistiques novateurs furent proposés, notamment par John Evelyn et Sir Christopher Wren, pour une ville radicalement différente, avec de grandes places et de larges avenues, qui aurait rivalisé avec Paris. Cependant, des problèmes pratiques ont entraîné leur abandon. La Couronne et la Cité eurent des difficultés à identifier les propriétaires pour négocier les compensations, les citoyens étant préoccupés par leur survie ou ayant quitté la capitale. La pénurie de main-d’œuvre rendit l’arpentage impossible.
En conséquence, le plan des anciennes rues fut largement suivi pour la reconstruction, avec quelques améliorations en matière d’hygiène et de prévention des incendies. Les rues furent élargies, les quais rendus plus accessibles (sans maisons), et surtout, les nouvelles maisons furent construites en brique et en pierre, non plus en bois. De nouveaux bâtiments publics furent édifiés, les plus célèbres étant la cathédrale Saint-Paul et les cinquante nouvelles églises de Christopher Wren.
Un monument commémoratif, conçu par Charles II et dessiné par Christopher Wren et Robert Hooke, fut érigé près de Pudding Lane. Haut de 61 mètres, « le Monument » devint un célèbre point de repère. En 1668, des accusations anti-catholiques furent gravées sur le Monument, affirmant que l’incendie fut « allumé et perpétué par la traîtrise et la malveillance de la faction papiste » [Trad 22, 46]. Cette inscription, brièvement effacée sous Jacques II, ne disparut définitivement qu’en 1830. Un autre monument, le Golden Boy de Pye Corner, marque l’endroit où l’incendie s’est arrêté, avec une inscription attribuant l’événement à un châtiment divin pour le péché de gourmandise (Pudding Lane au départ, Pye Corner à l’arrivée).
L’Héritage Paradoxal de la Peste 🦠➡️🩹
L’épidémie de peste de 1665 avait tué 80 000 personnes, un sixième de la population de Londres. Pour certains historiens, l’absence d’épidémies récurrentes de peste après l’incendie suggère que les flammes ont paradoxalement sauvé des vies à long terme, en réduisant en cendres des logements insalubres ainsi que les rats et les puces vecteurs de la maladie. Cependant, d’autres rappellent que l’incendie n’a pas touché les faubourgs, alors les zones les plus insalubres de la ville.
Le Grand Incendie dans la Culture Populaire 🎬📚
Le caractère spectaculaire et tragique du Grand Incendie de Londres a inspiré de nombreuses œuvres à travers les siècles :
- Littérature : Jacques Roubaud a écrit Le Grand Incendie de Londres.
- Séries littéraires : Il est mentionné dans Les Secrets de l’immortel Nicolas Flamel de Michael Scott, où il est attribué à Nicolas Flamel fuyant John Dee. Dans Héros de l’Olympe, il est une allusion à un fils d’Héphaïstos. Le tome 7 de Time Riders d’Alex Scarrow se déroule en partie durant l’incendie. Contes des particuliers de la série Miss Peregrine évoque des pigeons de Saint-Paul comme déclencheurs.
- Manga : Dans Black Butler, il est présenté comme l’œuvre de forces occultes.
- Télévision : L’épisode The Visitation de Doctor Who (1982) met en scène le Docteur mettant le feu à la boulangerie de Pudding Lane pour empêcher une invasion extraterrestre.
- Bandes dessinées : Le personnage de Marvel Comics, l’Ancien, affronte le démon Dormammu durant l’incendie.
- Comptines : London’s Burning est une comptine populaire associée à l’événement.
En conclusion, le Grand Incendie de Londres de 1666 fut bien plus qu’une simple catastrophe. Il fut un tournant majeur dans l’histoire de la ville, forçant une refonte urbaine, révélant les failles des autorités et illustrant la résilience d’une population face à l’adversité. De ses cendres, une nouvelle Londres, plus solide et mieux planifiée, allait voir le jour, marquant à jamais l’imaginaire collectif.