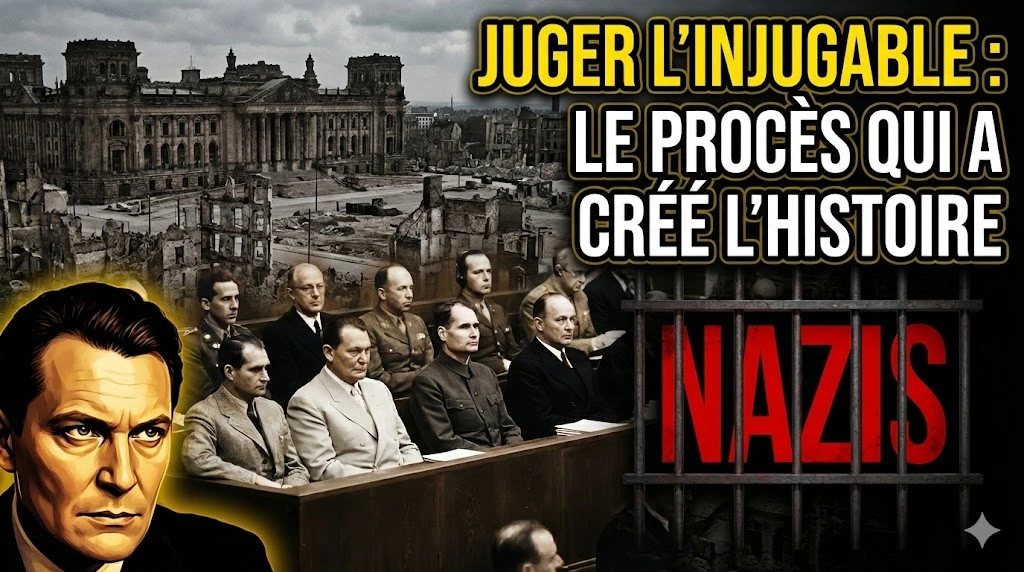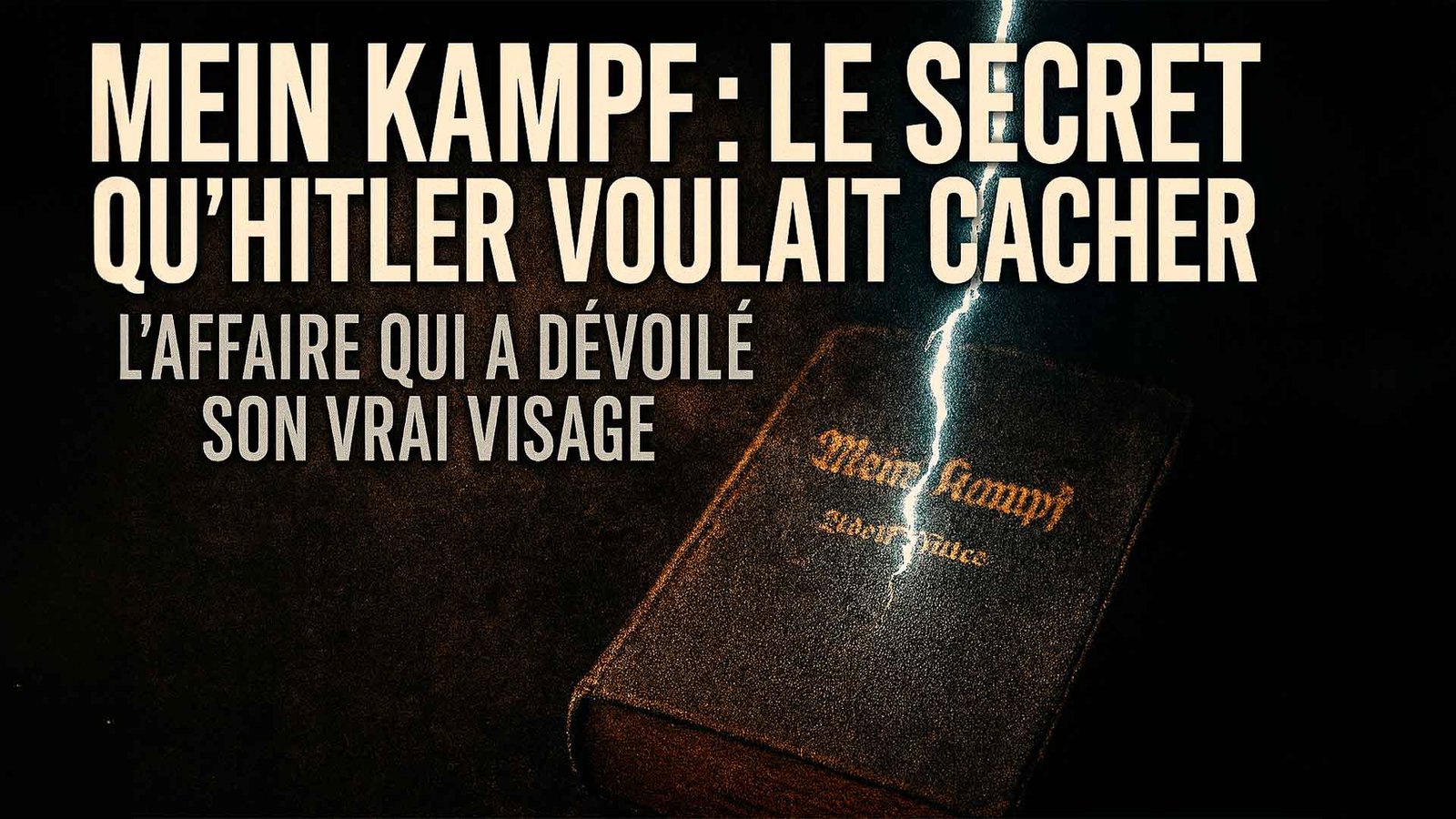Le Procès du Maréchal Pétain : Un Jugement Historique au Cœur de la Libération ⚖️
Le procès du Maréchal Philippe Pétain, figure emblématique de la Première Guerre mondiale et Chef de l’État français sous l’Occupation, demeure un événement capital de l’histoire de France. Tenu à l’été 1945, ce procès, lourd de sens et de conséquences, a cherché à juger non seulement un homme, mais aussi une période sombre de la nation. Il s’inscrit comme un prélude indispensable aux vastes procès de l’Épuration qui suivront.
Le Contexte : Une Nation en Reconstruction et un Accusé de Retour 🇫🇷
Au printemps 1945, l’Europe panse encore ses plaies de la Seconde Guerre mondiale. La France, libérée, est en pleine période de reconstruction et d’épuration. Dans ce climat tendu, le retour du Maréchal Pétain sur le sol français devient un événement majeur. Trois mois avant l’ouverture de son procès, Pétain, renvoyé par Hitler, se livre aux autorités françaises à la frontière suisse. Bien que la Suisse lui ait proposé l’asile politique, Pétain manifeste son désir de rentrer en France, où il est accueilli par les autorités militaires, qui lui notifient son inculpation et son arrestation.
Initialement, un procès par contumace avait été envisagé et son instruction était déjà presque achevée en son absence. Le Général de Gaulle lui-même aurait souhaité un procès par contumace pour marquer la culpabilité de Pétain, sans nécessairement s’intéresser aux conséquences pratiques d’une éventuelle condamnation. Il avait même fait savoir à la Suisse qu’il ne s’opposerait pas à ce que Pétain y reste. Cependant, le retour inattendu de Pétain force la prolongation de l’instruction et l’organisation d’un « vrai » procès. Celui-ci s’ouvre seulement trois mois après son retour, un délai étonnamment court, mais jugé nécessaire pour l’ensemble des procès de l’épuration à venir : si Pétain était condamné, les autres accusés ne pourraient plus invoquer son autorité ou l’obéissance à ses ordres pour se dédouaner de leurs responsabilités.
À son arrivée en France, Pétain est incarcéré avec sa femme au Fort de Montrouge, puis est logé directement sur place, dans une petite pièce spécialement aménagée pour lui au Palais de Justice, au cœur de Paris, pendant la durée du procès. Il s’agit là du « dernier chapitre d’une longue vie ».
La Haute Cour de Justice : Une Institution Nouvelle pour un Procès Hors Norme 🏛️
Le procès de Philippe Pétain se déroule devant la Haute Cour de Justice, une juridiction créée spécifiquement à la fin de l’année 1944 pour juger l’ancien chef de l’État, les ministres et les très hauts fonctionnaires du régime de Vichy. Cette Cour est mise en place en vertu d’une ordonnance prise à Alger, encore pendant l’Occupation, visant à mettre en accusation tous les membres des gouvernements de Vichy.
L’incrimination principale retenue contre Pétain est l' »intelligence avec l’ennemi« , en vertu de l’article 75 du Code Pénal. Cet article était également utilisé pour l’immense majorité des justiciables de l’épuration. D’autres chefs d’inculpation, comme l’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État (articles 83 et 86), sont également évoqués, mais la notion de trahison est celle autour de laquelle le procès tourne le plus fréquemment. L’utilisation du Code Pénal d’avant-guerre vise à inscrire cette justice d’exception dans la continuité de l’État de droit, montrant que l’on n’invente pas de nouvelles incriminations.
La Haute Cour de Justice, entièrement nouvelle, se distingue de l’ancienne cour de la IIIe République. Ses membres, qu’il s’agisse de la commission d’instruction ou des jurés potentiels, sont pour moitié issus du Sénat et de la Chambre des députés (parlementaires n’ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940) et pour moitié des groupes de résistants ou des victimes de l’Occupation et de Vichy. Cette composition en fait un jury particulièrement politique et, par définition, potentiellement hostile à l’accusé, même si cela ne se vérifie pas systématiquement dans la pratique.
Le Déroulement du Procès : Entre Attente et Déception ⏳
Le procès s’ouvre au Palais de Justice de Paris. La salle, trop petite, est rapidement saturée par la foule, la presse et les caméras, rendant les conditions matérielles difficiles et renforçant la tension ambiante.
L’Accusé : Philippe Pétain et le Choix du Silence 🤫
Au début de son procès, lorsque le premier président Mongibeaux ouvre les débats par les questions rituelles, Pétain répond simplement : « Pétain, Philippe, Maréchal de France« . Puis, après la lecture de l’acte d’accusation, il lit un texte, un « dernier message », par lequel il déclare qu’il ne répondra à aucune question.
Cette tactique du silence, préconisée par son avocat Jacques Isorni, s’explique par plusieurs raisons. D’une part, l’âge avancé de Pétain (89 ans) et sa mémoire défaillante le rendaient incapable de répondre précisément aux questions, surtout les plus complexes. D’autre part, Isorni souhaitait que Pétain assume ses responsabilités tout en montrant le « bien » qu’il aurait fait, et le silence permettait de limiter les réponses désordonnées et parfois incriminantes de Pétain. Pétain lui-même, bien que ne percevant pas la plupart des incriminations, était profondément obsédé par l’idée d’être accusé de trahison.
Malgré son silence, Pétain lit une déclaration préliminaire et une finale, toutes deux rédigées par Isorni. Il invoque également sa surdité pour ne pas répondre aux questions, et ses rares prises de parole sont souvent « malencontreuses ». L’apparence physique de Pétain lors du procès est étonnamment bonne pour son âge, ce qui est un soulagement général, car personne ne souhaitait juger un homme trop diminué.
Les Acteurs Clés : Procureur et Avocats 👨⚖️👩⚖️
- Le Procureur : André Mornet Le procureur général Mornet, remplaçant face à l’accusé, est décrit comme menant une tâche acharnée. Mornet avait déjà la réputation d’avoir été un opportuniste, ayant été procureur contre des espions et des hommes politiques durant la Première Guerre mondiale. Son réquisitoire final, très complet, aborde toutes les questions et périodes, se montrant très clair sur la qualification du crime et la peine encourue. Mornet est souvent critiqué pour s’être concentré excessivement sur le « complot contre la République » et les événements de 1940, au détriment des questions de collaboration et de persécution.
- La Défense : Une Équipe en Désaccord 🧑🤝🧑 La défense de Pétain est assurée par une équipe d’avocats désignés d’office, une pratique courante durant l’Épuration pour garantir leur liberté d’action.
- Maître Fernand Payen : Bâtonnier et civiliste, il est désigné comme défenseur principal. Sa stratégie vise à dédouaner son client en raison de son âge et de son état de santé, et à montrer qu’il avait été contraint de céder aux pressions allemandes. Payen souhaitait demander une libération pour raisons de santé après la condamnation. Il se charge de la partie « politique étrangère » et des relations avec l’Allemagne. Sa plaidoirie est parfois décousue, et il ne tient pas compte des interventions de ses confrères.
- Maître Jacques Isorni : Plus célèbre et passionné par le cas de Pétain, Isorni développe une toute autre stratégie. Il préconise que Pétain assume ses responsabilités tout en mettant en avant le « bien » qu’il aurait fait. C’est lui qui écrit les déclarations lues par Pétain. Isorni se concentre sur les questions dérangeantes de persécution et de répression, faisant preuve d’un grand talent oratoire et d’une capacité à créer l’empathie, même s’il plaide davantage pour l’opinion et la postérité que pour son client.
- Maître Jean Lemaire : Moins connu, Lemaire a préparé une plaidoirie contre le complot contre la République, une accusation qui avait pourtant été abandonnée en cours de route. Il semblait être le seul des trois à s’être préparé à un « procès de rupture », mais n’a pas pu le faire seul.
Les Témoins : La Mémoire d’une France Brisée 💔
Le procès est marqué par la déposition de nombreux témoins, dont des figures majeures de la IIIe République et des hommes de la Résistance.
- Témoins à charge :
- Paul Reynaud (ancien président du Conseil) : Il explique comment il a lui-même appelé Pétain au pouvoir. Ses souvenirs cruels de 1940, de la débâcle et de l’Armistice sont évoqués.
- Albert Lebrun (ancien président de la République) : Il rappelle les journées tragiques de Bordeaux, où s’affrontaient les thèses de l’espoir à tout prix et de l’abandon.
- Louis Marin : Il affirme que l’Armistice est un « déshonorant manquement à la parole donnée ».
- Léon Blum : Il évoque la « grande peur de Vichy qui ajoutait la honte à la défaite ».
- Michel Clemenceau, le Général de Lattre de Tassigny, Édouard Daladier, et le Général Gamelin apportent également leurs témoignages.
- Marcel Paul (résistant et déporté) : Il affirme, au nom de ses camarades, la responsabilité de Pétain dans la répression du patriotisme français.
- Témoins à décharge :
- Maxime Weygand (général d’armée) : Il attaque les assertions de Paul Reynaud concernant l’Armistice, provoquant une confrontation directe entre les deux hommes.
- Le Général Georges (commandant du Front Nord-Est en 1940) : Il dresse un tableau de la campagne de France.
- Pierre Laval : Remis par les Américains aux mains de la France, Laval est une « vraie vedette » du procès. Il plaide le dossier Pétain, déclarant que « le procès Pétain, c’est un peu le mien ». Les deux noms sont liés par l’assassinat de la République, Toulon, la déportation, et les mots célèbres de Laval « Je souhaite la victoire de l’Allemagne ».
- Peyrouton (ancien ministre de l’Intérieur) et Darnand (chef de la Milice) sont également des témoins à décharge.
Le défilé des témoins est long et les débats sont souvent houleux. Une particularité du procès est la place disproportionnée accordée à la question de l’Armistice et de l’abolition de la République à l’été 1940, au détriment des rapports avec l’occupant allemand, de la collaboration et des persécutions. Les hommes politiques de la IIIe République utilisent cette tribune pour présenter leur propre défense ou leurs arguments sur leur attitude en 1940. La question des persécutions antisémites, bien que présente, n’est pas traitée comme un sujet central, mais intégrée dans l’ensemble des persécutions de la répression. Il n’y a pas de parties civiles, et les victimes témoignent à titre d’illustration ou d’anecdote, beaucoup plus brièvement que les hommes politiques.
Le Verdict : Culpable et Condamné à Mort 💀
Après de longues audiences, les jurés se retirent pour délibérer. La question est claire : Pétain est-il coupable ? Quel sera son sort ?.
Les délibérations sont intenses et révèlent des divisions. Les trois magistrats professionnels sont initialement favorables à une forme de bannissement, une peine jugée « d’Ancien Régime ». Cette proposition suscite l’indignation des jurés issus de la Résistance, qui exigent une condamnation à mort pour sa forte charge symbolique. Finalement, les jurés issus de la Résistance l’emportent, et la condamnation à mort est votée à une voix de majorité, en vertu de l’article 75 du Code Pénal.
Le verdict est prononcé très tard dans la soirée du 14 au 15 août 1945. Pétain, ne comprenant pas bien, perçoit qu’il est condamné à mort, mais ne saisit pas la raison exacte ni s’il est toujours Maréchal de France. En effet, il est également condamné à l’indignité nationale, une sanction de l’Épuration qui implique la perte des grades et des titres, y compris celui de maréchal.
Les Conséquences et l’Héritage du Procès Pétain 📝
La condamnation à mort de Pétain est un acte symbolique fort, jugé nécessaire pour marquer sa culpabilité et servir de base aux autres procès de l’Épuration. Cependant, sa mise en œuvre est complexe.
La Grâce de De Gaulle et la Détention 🕊️
Avant même la fin du procès, le Général de Gaulle fait savoir qu’il accordera la grâce si la condamnation à mort est prononcée. Cette décision est motivée par le fait que de Gaulle n’a pas oublié le passé de Pétain, « commandant à Verdun » et vainqueur de la Première Guerre mondiale. Pour de Gaulle, le symbole prime, et l’exécution d’un homme de 89 ans et ancien héros de guerre posait un dilemme moral et pratique. Cette assurance préalable a d’ailleurs facilité la décision des jurés de prononcer la peine capitale, sachant qu’elle ne serait pas appliquée.
Immédiatement après le verdict, Pétain est transporté au Fort du Portalet dans les Pyrénées. Le choix de ce lieu de détention est hautement symbolique, car des hommes de la IIIe République y avaient été internés sur décision de Pétain lui-même. La détention de Pétain devait être une manifestation symbolique et transitoire, avec une résidence surveillée ou une libération envisagée, d’autant plus qu’à 89 ans, on pensait qu’il n’en avait plus pour longtemps.
Cependant, le départ brutal du Général de Gaulle du pouvoir en janvier 1946 empêche toute décision rapide sur le sort de Pétain. Sa détention se prolonge alors, contre toute attente, jusqu’en 1951, faisant de lui « le plus vieux, mais aussi le plus encombrant prisonnier du monde ». De Gaulle, bien que toujours favorable à une mesure d’élargissement, ne peut plus prendre de décision.
La Mémoire et les Enjeux Symboliques 🤔
Le procès Pétain est un événement très attendu, non seulement pour des raisons utilitaires liées à l’épuration judiciaire, mais aussi pour son immense importance symbolique. Les Français attendent des réponses, et il y a une nécessité de donner un certain apparat à ce procès.
La presse couvre largement le procès, malgré les contraintes de papier et de place. Les journalistes sont nombreux dans la salle, mais les comptes-rendus sont souvent « impressionnistes » faute de détails. Les films et les photos sont rares, limités par les règles judiciaires et le fait que Pétain lui-même n’appréciait pas d’être filmé.
L’intérêt du public, très vif au début, s’épuise au fil des semaines, pour être relancé au moment du verdict. L’opinion publique, interrogée par les premiers sondages d’opinion, montre une sévérité plus grande pendant l’hiver 1944-1945, mais une indulgence accrue au printemps et à l’été 1945, reconnaissant la culpabilité de Pétain tout en lui accordant des circonstances atténuantes en raison de son âge et de son passé de vainqueur de la Première Guerre mondiale.
Le procès du Maréchal Pétain reste un événement complexe et controversé. Il a tenté de juger un homme dont la carrière est passée de Verdun à Montoire, dont le principal témoin est la « France entière, vaincue, trompée et trahie ». Il a mis en lumière les divisions profondes de la société française et les défis de juger des figures historiques dans des moments de transition. Il a marqué, pour beaucoup, la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère pour la France.