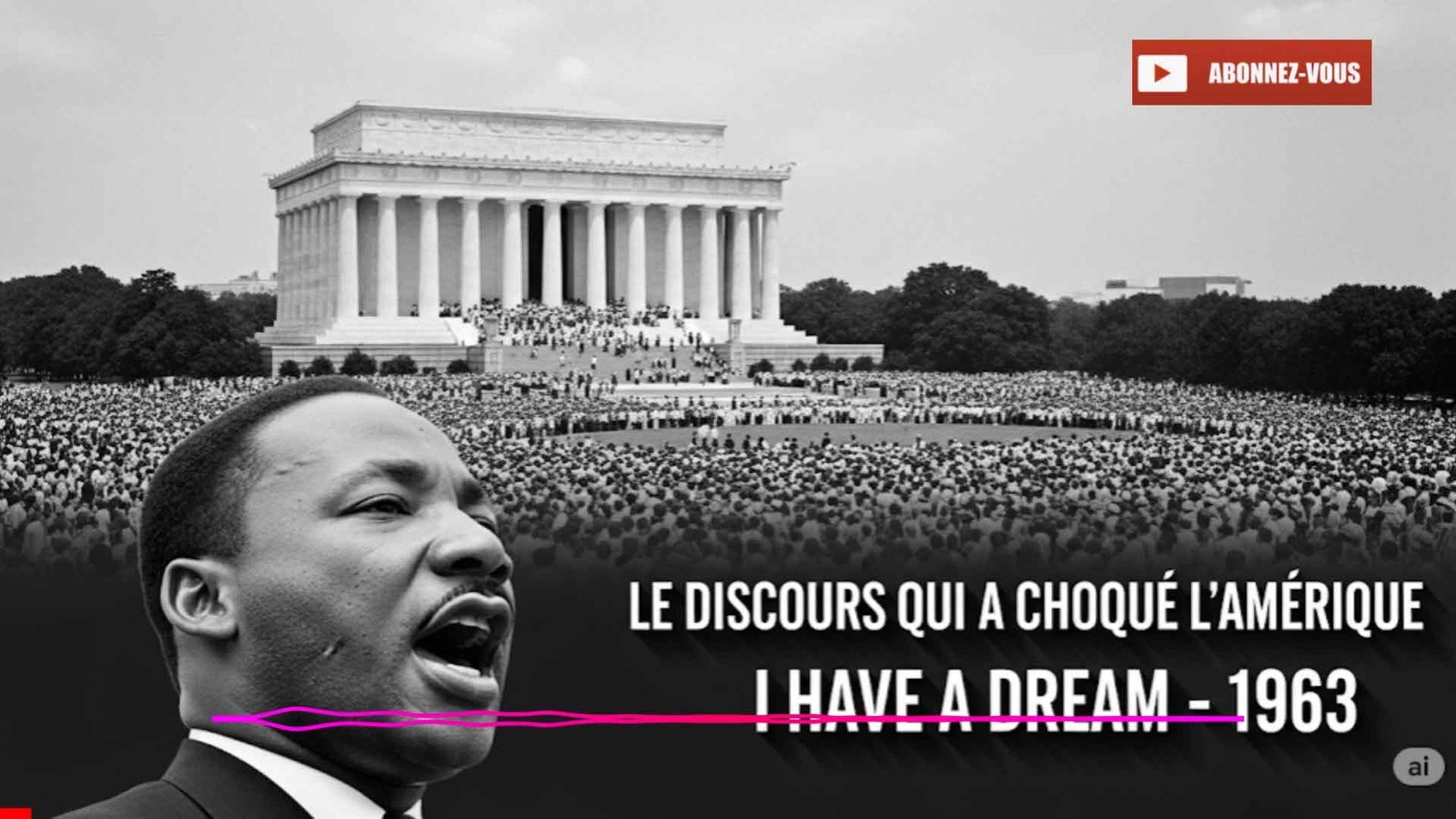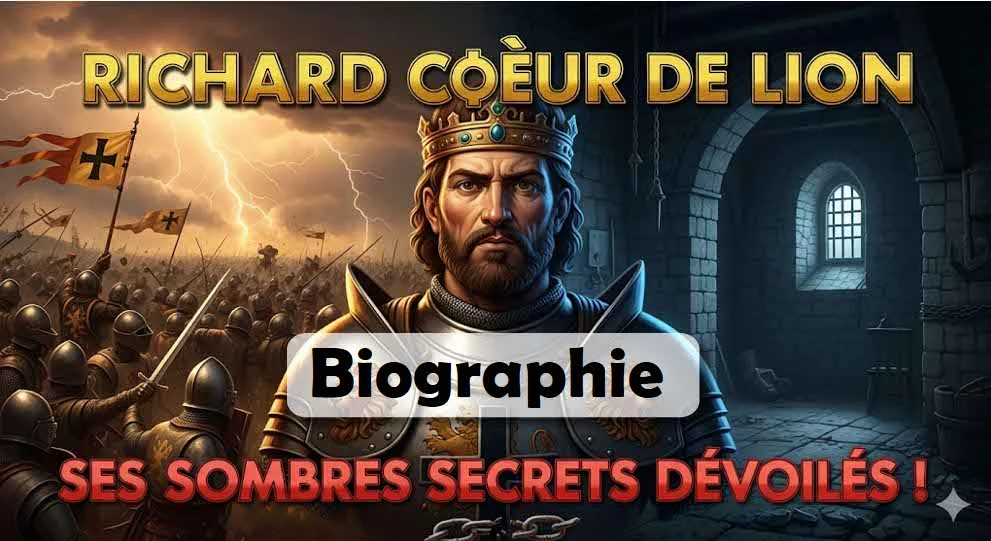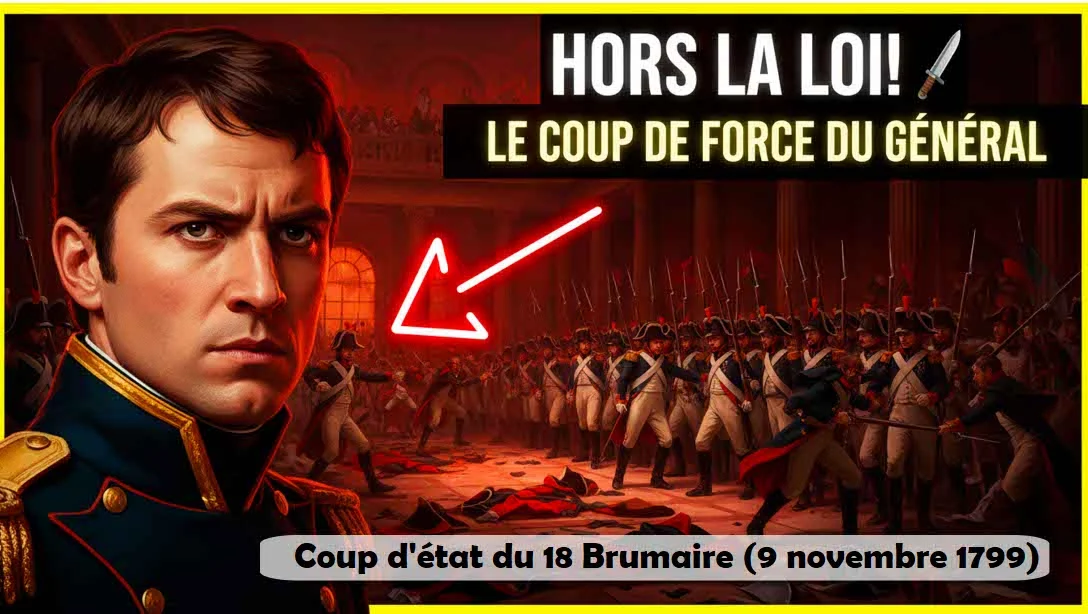Liens vers des sources complémentaires pour approfondir la réflexion :
La Fronde de Michel Pernot : https://amzn.to/4fOZJeM
La Fronde de Pierre-Georges Lorris (Kindle) : https://amzn.to/4fOZJeM
La Fronde (1648-1653) : Une Crise Majeure pour la Monarchie Française 👑
La Fronde, un nom évocateur d’une période de troubles profonds, marque une page sombre mais décisive de l’histoire de France. Entre 1648 et 1653, le royaume est secoué par une série de révoltes qui menacent l’autorité monarchique alors que le jeune Louis XIV n’est encore qu’un enfant. Cette période complexe, riche en rebondissements et en retournements d’alliances, est bien plus qu’une simple agitation ; elle représente une réaction brutale contre la montée de l’autorité royale commencée sous Henri IV et Louis XIII, et renforcée par l’inflexibilité de Richelieu. Elle préfigure l’apogée de l’absolutisme sous Louis XIV lui-même, en l’ayant paradoxalement forgé dans les flammes de la rébellion.
Cet événement historique est d’autant plus fascinant qu’il se déroule dans un contexte international et national de grande instabilité, où la France, affaiblie par une régence et une situation financière délicate, doit également faire face à une guerre continue avec l’Espagne. La Fronde est une convergence explosive d’oppositions parlementaires, aristocratiques et populaires, chacune avec ses propres revendications et ambitions. Elle se distingue comme la dernière grande révolte nobiliaire du XVIIe siècle, et son étude est essentielle pour comprendre la trajectoire vers la monarchie absolue de droit divin.
1. Qu’est-ce que la Fronde ? Définition et Chronologie 📅
La Fronde est donc une période de troubles graves qui affecte le royaume de France de 1648 à 1653. Elle survient alors que la France est déjà engagée dans un conflit prolongé contre l’Espagne (1635-1659). Au cœur de cette tempête se trouve la minorité du roi Louis XIV, qui règne théoriquement de 1643 à 1651. Le pouvoir est exercé par la régence de sa mère, Anne d’Autriche, qui s’appuie sur son principal ministre, le cardinal Mazarin.
La chronologie précise de la Fronde est un sujet de débat parmi les historiens, tant les événements sont multiples et les alliances mouvantes. Cependant, il est courant de situer le début de cette période le 15 juin 1648, date marquée par la déclaration des vingt-sept articles au Parlement de Paris, qui visait à limiter les pouvoirs du souverain. La fin des troubles est généralement associée à la soumission de la ville de Bordeaux le 3 août 1653.
L’historiographie a l’habitude de diviser la Fronde en plusieurs phases distinctes, bien que souvent entrelacées:
- La Fronde parlementaire (1648-1649) : axée sur l’opposition des cours souveraines.
- La Fronde des princes (1651-1653) : caractérisée par l’opposition de la haute noblesse ou des Grands du royaume.
Ces révoltes, mêlant revendications fiscales, sociales et politiques, ont profondément marqué le règne naissant de Louis XIV et la consolidation du pouvoir royal.
2. Le Contexte National et International de la Révolte 🌍
Pour comprendre l’ampleur et les mécanismes de la Fronde, il est impératif d’analyser le climat politique, social et économique dans lequel elle a pris racine, ainsi que les influences extérieures.
2.1. Un Pouvoir Royal Affaibli et une Régence Contestée 📉
La mort du puissant cardinal Richelieu en 1642, suivie un an plus tard par celle de Louis XIII en 1643, laisse un vide de pouvoir. Louis XIV n’étant qu’un enfant, la régence est confiée à sa mère, Anne d’Autriche. Inexpérimentée dans les affaires politiques, la reine-mère s’appuie sur le cardinal Mazarin, dont la nomination, bien que stratégique, suscite de nombreuses jalousies parmi les princes du royaume. Cette période de régence est intrinsèquement plus fragile qu’un règne de plein droit, offrant une brèche aux mécontents pour exploiter la délicatesse de la situation.
Plusieurs facteurs internes contribuent à fragiliser le royaume et à alimenter l’esprit de révolte:
- Situation financière et fiscale difficile : La France est épuisée par les prélèvements nécessaires à la longue et coûteuse guerre de Trente Ans.
- L’esprit de revanche des Grands du royaume : Sous la main de fer de Richelieu, la haute noblesse avait été soumise et muselée. La période de régence est perçue comme une opportunité de retrouver leur influence et de jouer un rôle politique plus important.
- L’aspiration du Parlement et de la noblesse : Ces corps constitués, encouragés par la régente qui doit initialement passer par eux pour casser le testament de Louis XIII et obtenir la pleine régence, aspirent à davantage de participation au gouvernement.
Cette conjonction de faiblesses royales et d’ambitions frustrées crée un terrain fertile pour des oppositions multiples, émanant des parlementaires, de l’aristocratie et du peuple.
2.2. Les Pressions Internationales et les Modèles Étrangers 🇪🇸🇬🇧
La Fronde ne peut être isolée de son contexte international. La France est en guerre avec l’Espagne depuis 1635, une politique traditionnelle visant à affaiblir la Maison d’Autriche, dont les possessions encerclent le royaume.
- Les traités de Westphalie, signés en 1648 juste avant le début de la Fronde, mettent fin à la guerre de Trente Ans pour la France, mais la guerre franco-espagnole se poursuit jusqu’en 1659.
- Ce début de siècle voit l’abaissement des Habsbourg, confrontés à des révoltes en Hollande, Catalogne, Naples et Portugal. Pendant ce temps, Richelieu et Louis XIII ont commencé en France à renforcer un État centralisé et absolutiste.
Un parallèle saisissant avec l’Angleterre voisine a également influencé les acteurs de la Fronde. De l’autre côté de la Manche, l’absolutisme de Charles Ier se heurte à la révolte du Parlement, menant à une guerre civile et, fait d’une portée immense, à l’exécution du roi le 30 janvier 1649. Cet événement est particulièrement présent à l’esprit des acteurs français, d’autant plus que la reine Henriette, sœur de Louis XIII, s’est réfugiée en France dès 1644. Cette situation explique en partie la résistance opiniâtre d’Anne d’Autriche à toute forme de remise en cause de l’autorité royale.
3. Les Multiples Facteurs Explicatifs des Troubles 📈⚖️🏛️
Les sources identifient clairement trois facteurs interdépendants qui expliquent l’éclatement de la Fronde : une pression fiscale croissante, une remise en cause des privilèges des parlementaires, et la volonté du pouvoir royal de gouverner seul dans le cadre d’une monarchie absolue.
3.1. Une Pression Fiscale Intenable 💰
Le premier facteur et le plus fondamental de la Fronde est un mécontentement généralisé lié à la crise économique et à l’augmentation incessante de la pression fiscale. Les dépenses de l’État avaient déjà doublé entre 1515 et 1600, et elles ont quintuplé entre 1600 et 1650. Cette augmentation colossale visait à financer la guerre de Trente Ans.
L’espoir d’un allègement des impôts, suscité par Anne d’Autriche après la mort de Louis XIII, est rapidement déçu. Le cardinal Mazarin, via le surintendant des finances Particelli d’Émery, cherche par tous les moyens à augmenter les recettes de l’État. Ces tentatives incluent :
- L’édit du Toisé (1644).
- La taxe des Aisés.
- L’édit du Tarif (1646).
L’objectif était d’étendre l’assiette fiscale parisienne pour compenser le manque à gagner de la taille (dont les villes étaient exemptées) et la promesse d’une remise du quart de la taille due depuis 1647. L’opposition du Parlement contraint cependant le ministre à réduire ou annuler ces réformes.
En janvier 1648, sept nouveaux édits fiscaux sont soumis à l’enregistrement du Parlement de Paris, sous la forme d’un lit de justice tenu le 15 janvier. Malgré les protestations, notamment de l’avocat général Omer Talon, le Parlement doit initialement s’incliner. Toutefois, ces mesures touchent directement les parlementaires eux-mêmes, qui, jusqu’alors, payaient peu ou pas d’impôts. En ce sens, la Fronde parlementaire est d’abord un soulèvement des « gens de biens » qui refusent l’augmentation de leurs charges fiscales. Les Parisiens, également écrasés par la fiscalité, apportent un soutien massif aux parlementaires.
3.2. L’Atteinte aux Privilèges des Officiers de Robe 🧑⚖️
Au-delà de l’aspect purement fiscal, la monarchie s’attaque également aux privilèges des parlementaires et des officiers de robe. Dans sa quête désespérée de fonds, le pouvoir royal multiplie la création d’offices. Or, la plupart des membres du Parlement avaient acheté leurs offices, et l’augmentation de l’offre entraînait une dépréciation du prix de ces charges.
De surcroît, le pouvoir royal décide en avril 1648 de supprimer pour quatre années tous les gages des officiers parlementaires. Ces « gages » constituaient une part importante de leurs revenus. Face à cette menace directe sur leur patrimoine et leur statut, tous les officiers de robe des quatre cours souveraines de Paris (Parlement, Chambre des comptes, Cour des Aides et Cour des Monnaies) se montrent solidaires pour défendre leurs privilèges, créant un front uni contre la régente et Mazarin.
3.3. La Volonté d’Abaisser l’Influence Politique des Ordres du Royaume 👑
Le troisième facteur est de nature politique et idéologique : la volonté du pouvoir royal d’instaurer une monarchie absolue où le roi gouverne seul, sans l’assistance de corps constitués comme les États généraux. Au XVIIe siècle, le roi a progressivement cessé de convoquer de telles assemblées. Le pouvoir monarchique s’est concentré dans une structure « bicéphale », où le roi s’appuie sur une seule personne de confiance (Richelieu pour Louis XIII, Mazarin pour Anne d’Autriche). Cependant, l’absolutisme n’est pas sans limites, le roi étant théoriquement tenu de prendre conseil et de respecter les lois du royaume et les droits de ses sujets.
Pendant la minorité de Louis XIV, la noblesse et les élites de robe refusent que le pouvoir réside entièrement entre les mains du cardinal Mazarin, jugé trop puissant et, pour certains, étranger.
- Dès la première année de la régence, Mazarin doit faire face à la « cabale des Importants », ce qui le pousse à emprisonner le duc de Beaufort, cousin germain du roi.
- L’aversion du peuple parisien envers le cardinal s’exprime dans des pamphlets virulents, les fameuses « mazarinades ».
- Sur le plan politique, le Parlement ambitionne de participer au gouvernement du royaume, bien qu’il ne soit à l’origine qu’une institution judiciaire.
- Plusieurs princes du sang expriment également leurs prétentions à diriger les affaires du royaume : Gaston de France (l’oncle du roi), Anne-Marie-Louise d’Orléans (la Grande Mademoiselle), le prince de Condé, la duchesse de Longueville, et Jean-François Paul de Gondi (futur cardinal de Retz), coadjuteur de Paris, qui nourrissait de grandes ambitions politiques.
Ces facteurs conjugués de mécontentement fiscal, de défense des privilèges et d’aspirations politiques ont créé un climat de tension extrême, propice à l’éclatement de la Fronde.
4. La Fronde Parlementaire : Paris en Révolte (1648-1649) 🏛️🔥
La première phase de la Fronde, dite parlementaire, est déclenchée par les initiatives du Parlement de Paris et des autres cours souveraines face à la politique fiscale de Mazarin et à l’atteinte à leurs privilèges.
4.1. La Chambre Saint-Louis et l’Arrêt d’Union (janvier-décembre 1648) 🤝
Le bras de fer commence réellement lorsque la régente tient un lit de justice le 15 janvier 1648 pour forcer l’enregistrement des sept édits fiscaux. Les parlementaires réagissent d’abord par un discours virulent d’Omer Talon, puis par des remontrances incessantes.
La tension monte en avril 1648 autour du droit annuel, ou paulette. Mazarin tente de diviser les cours souveraines en offrant au seul Parlement l’exemption d’un rachat de quatre années de gages pour le renouvellement de leurs offices. Cette manœuvre échoue et renforce la solidarité de la Robe parisienne. La protestation se matérialise par l’arrêt d’Union du 13 mai 1648, qui propose aux quatre cours souveraines (Parlement, Chambre des comptes, Cour des Aides, Grand Conseil) de délibérer en commun. Il s’agit d’un défi institutionnel majeur à l’autorité royale.
L’arrêt d’Union est cassé par le Conseil d’État le 7 juin, mais le Parlement passe outre et convoque les autres cours à le rejoindre le lendemain à la Chambre Saint-Louis du Palais de justice. Le 27 juin, Mathieu Molé, le premier président du Parlement de Paris, prononce un discours ferme à la reine, justifiant l’union des compagnies et exigeant la suppression des arrêts du Conseil. Mazarin, pragmatique, conseille de négocier. Anne d’Autriche capitule le 30 juin, autorisant les chambres à siéger ensemble.
Les magistrats réunis à la Chambre Saint-Louis rédigent alors une charte contenant vingt-sept articles de réformes. Parmi les demandes clés figurent :
- La suppression des traitants.
- La réduction des tailles.
- La répartition et la levée des impôts par les seuls officiers.
- Le rappel des intendants.
- L’absence de création de nouveaux offices.
- Le renoncement aux réductions de rentes et de gages.
- Un habeas corpus pour les seuls officiers, garantissant les libertés individuelles.
Par la déclaration royale du 31 juillet, la Chambre Saint-Louis obtient gain de cause sur la quasi-totalité de ses demandes, à l’exception de l’abolition des lettres de cachet. Particelli d’Émery est renvoyé et remplacé par le duc de La Meilleraye. Pendant ce temps, l’État déclare la banqueroute, annulant tous les prêts et avances consentis.
4.2. Les Barricades de Paris et le Retour Triomphal de Broussel (août 1648) 🚧
Le mois d’août marque un tournant. La victoire de Condé sur les Espagnols à Lens le 20 août 1648 offre à Mazarin l’occasion de réagir. Le Conseil d’en haut décide, le 25 août, de profiter de la liesse parisienne pour arrêter trois parlementaires considérés comme les principaux chefs de la Fronde : Henri Charton, René Potier de Blancmesnil et, surtout, Pierre Broussel. Ce dernier, un opposant farouche aux mesures fiscales, est extrêmement populaire au sein de la capitale.
L’arrestation de Broussel met Paris en effervescence. La ville s’enflamme et voit l’érection de 1 260 barricades autour du Palais-Royal entre le 26 et le 28 août. Les milices bourgeoises, dont les chefs parlementaires semblent avoir été dépassés par l’ampleur du mouvement, sont à l’instigation de ces blocages. La violence monte, et le chancelier Séguier est poursuivi par la foule, son hôtel de Luynes étant même incendié ; il ne doit sa vie qu’à l’intervention de La Meilleraye. Face à cette insurrection massive, Mazarin est contraint de céder. Blancmesnil est libéré, puis Broussel, qui effectue un retour triomphal à Paris le 28 août. Charton, quant à lui, avait réussi à éviter l’arrestation.
4.3. Négociations et la Paix de Rueil (septembre 1648-mars 1649) 🕊️
Après ces événements, la Cour quitte Paris, s’installant temporairement à Rueil puis à Saint-Germain. Le prince de Condé se montre fidèle à Anne d’Autriche, déclarant son opposition à « l’insolence de ces bourgeois qui veulent gouverner l’État ». Des conférences sont organisées à Saint-Germain du 25 septembre au 4 octobre 1648 pour trouver une issue à la crise, avec l’intermédiaire de Condé et Gaston d’Orléans.
Anne d’Autriche et Mazarin se résignent temporairement à accepter les exigences parlementaires. Le 22 octobre, la monarchie accepte une quinzaine des articles de la Chambre Saint-Louis par une déclaration royale, confirmant celle de juillet. Le 30 octobre, la Cour rentre à Paris. Le même jour, un événement capital se produit sans être remarqué : la signature des traités de Westphalie avec l’empereur Ferdinand III, marquant la fin de la guerre de Trente Ans pour la France, bien que le conflit avec l’Espagne persiste. Malgré l’accord, le Parlement continue de protester contre les infractions à la déclaration royale, et Mazarin commence à envisager de s’éloigner de Paris et d’affamer la capitale.
4.4. Le Blocus de Paris et l’Organisation de la Résistance (janvier-mars 1649) ⚔️
La tension dégénère en guerre ouverte. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la Cour quitte précipitamment le Palais du Louvre pour le château de Saint-Germain. Mazarin fait appel à 4 000 mercenaires allemands et confie le commandement des troupes royales à Condé pour siéger Paris. L’armée royale compte alors entre 8 000 et 10 000 hommes.
Côté parisien, la résistance s’organise :
- Le 8 janvier 1649, le Parlement rend un arrêt qui condamne Mazarin au bannissement.
- Le 11 janvier 1649, le Parlement confie le commandement des troupes frondeuses au prince de Conti, frère de Condé, le désignant comme généralissime de la Fronde.
- D’autres chefs frondeurs rejoignent le mouvement : les ducs de Bouillon (qui conteste le rattachement de Sedan), de Beaufort (surnommé le « Roi des Halles »), de Noirmoutier et d’Elbeuf, ainsi que le maréchal de La Mothe et le prince de Marcillac.
- La duchesse de Longueville (sœur de Condé et Conti) et le coadjuteur de Paris, Jean-François Paul de Gondi (futur cardinal de Retz), jouent un rôle prépondérant. Gondi, proche du parti dévot, se montre à cheval dans les rues de Paris, armé de pistolets. Il est célébré par le peuple dans des chants comparant son combat à celui de David contre Goliath, avec Anne d’Autriche et Mazarin en Goliath.
- La duchesse de Longueville s’installe à l’Hôtel de Ville et y accouche d’un fils de son amant, La Rochefoucauld, qu’elle prénomme Charles-Paris, symbolisant l’engagement de la noblesse dans la révolte. Les pamphlétaires déchaînent leur fureur contre Mazarin dans une nouvelle vague de mazarinades.
Malgré quelques troubles en province (Rouen, Bordeaux, Aix-en-Provence), le siège de Paris est efficace. Les greniers à blé autour de la capitale ne l’alimentent plus, et le prix du pain quadruple en deux mois. La victoire de l’armée royale à Charenton le 8 février 1649 empêche tout ravitaillement, et les soldats du roi ravagent le sud de Paris.
Le ralliement de Turenne aux frondeurs est un espoir, mais Mazarin, grâce au banquier Barthélemy Hervart, parvient à maintenir l’armée d’Allemagne dans le devoir en déboursant 1,5 million de livres tournois. Privé de moyens, Turenne est contraint à l’exil et déclaré coupable de crime de lèse-majesté le 7 mars 1649.
Dans ces conditions, les parlementaires se divisent entre légalistes (Mathieu Molé) et ultras. Les légalistes, suppliant Anne d’Autriche de négocier, s’inquiètent des accointances de certains princes avec les Espagnols et ne veulent pas être débordés par l’agitation populaire. La Cour, elle, est hantée par l’exécution de Charles Ier en Angleterre, ce qui affaiblit la détermination de la régente. Des pourparlers débutent le 4 mars 1649. Un compromis est signé : la paix de Rueil le 11 mars 1649, suivie de la paix de Saint-Germain le 1er avril 1649. Tous les fauteurs de troubles sont pardonnés, y compris Turenne. L’invasion de la Picardie par les Espagnols pousse Mazarin à modérer ses exigences et à inclure les princes dans les négociations.
5. La Fronde des Princes : Une Lutte Aristocratique et Complexe (1650-1653) 👑🤝
La paix de Saint-Germain n’est qu’une trêve fragile. Le retour au calme est difficile, notamment en province où Bordeaux et Aix continuent de se soulever. À Paris, les pamphlets anti-Mazarin circulent toujours, et surtout, les alliances politiques se reconfigurent, menant à une nouvelle phase de la Fronde.
5.1. Les Alliances Renversées et l’Arrestation des Princes (automne 1649-janvier 1650) 🔄
Après la Fronde parlementaire, le prince de Condé, fort de son soutien à Mazarin lors du blocus de Paris, entend en tirer profit et prendre part au gouvernement. Ses prétentions deviennent si importantes que Mazarin, pour le neutraliser, se rapproche des anciens frondeurs : il promet le galero (chapeau de cardinal) au coadjuteur Gondi et marie sa nièce, Laure Mancini, au duc de Mercœur, frère de Beaufort, jouant ainsi sur la rivalité entre la maison de Condé et la branche illégitime des Vendôme.
À l’automne 1649, la situation est tendue, marquée par des incidents comme les coups de feu essuyés par le carrosse de Condé. Les relations entre Condé et Mazarin se dégradent. En janvier 1650, grâce à l’entremise de la duchesse de Chevreuse, certains chefs de la « vieille Fronde » (Gondi, Beaufort, Châteauneuf) se rallient secrètement au pouvoir royal contre le prince de Condé et sa famille, notamment sa sœur, la duchesse de Longueville, devenue une figure politique majeure.
Ce renversement d’alliances conduit à un coup de théâtre : le 18 janvier 1650, le prince de Condé, son frère Conti et leur beau-frère Longueville sont arrêtés et emprisonnés au château de Vincennes. Cet événement marque le début de la Fronde princière.
5.2. Soulèvements Provinciaux et les Déplacements de la Cour (1650) 🗺️
L’arrestation des princes provoque le soulèvement de leurs clientèles et de leurs provinces. Madame de Longueville tente sans succès de soulever la Normandie avant de rejoindre Turenne à Stenay, après un passage par Bruxelles. Turenne envisage de marcher sur Vincennes, forçant Mazarin à transférer les prisonniers au château de Marcoussis. D’autres figures, comme le prince de Marcillac (futur La Rochefoucauld) et le duc de Bouillon, agitent le Poitou et le Limousin avant de rallier Bordeaux, où la princesse de Condé pousse le Parlement de Guyenne à s’opposer de nouveau au gouverneur d’Épernon.
Toute l’année 1650 est consacrée par Mazarin à éteindre les foyers de guerre en province. La régente et le jeune roi l’accompagnent pour affirmer la légitimité royale. Paris est confiée à Gaston d’Orléans. Les troupes royales pacifient la Normandie et la Bourgogne. Mais à chaque passage par Paris, Mazarin doit céder de nouveaux avantages aux Vendôme, Beaufort et Gondi, ses nouveaux alliés.
L’affaire de Bordeaux est plus sérieuse. Le Parlement est en conflit avec d’Épernon et échange avec celui de Paris. Le 2 juin, la jurade de Bordeaux est contrainte d’accueillir la princesse de Condé, son jeune fils, et les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld. Le maréchal La Meilleraye assiège Bordeaux, mais la Cour est en position de faiblesse. À Paris, Gaston d’Orléans, sous l’influence de Gondi, retire le gouvernement de Guyenne à d’Épernon, irritant Mazarin. De plus, les Espagnols, alliés à Turenne, reprennent l’offensive en Picardie. Mazarin accepte alors un compromis pour Bordeaux, et la ville ouvre ses portes au jeune roi le 5 octobre 1650.
5.3. Mazarin Contraint à l’Exil et l’Union des Frondes (fin 1650-février 1651) 🏃♂️
À son retour à Paris (15 novembre 1650), la situation a de nouveau basculé. Des libelles anti-Mazarin circulent. Bien que Gaston d’Orléans se montre coopératif, Mazarin transfère les princes prisonniers au Havre, craignant une libération par l’avancée de Turenne. Le 15 décembre 1650, l’armée des princes est défaite à Rethel par le maréchal du Plessis.
Malgré cela, le Parlement et les anciens frondeurs se rapprochent des princes. Des remontrances sont adressées au roi pour leur libération. Le 30 janvier 1651, un traité secret est signé entre Gaston d’Orléans, les frondeurs et les partisans des princes pour obtenir leur libération et le départ de Mazarin. Gaston d’Orléans rend publique sa rupture avec Mazarin le 2 février 1651 : les deux Frondes s’unissent. Le Parlement réclame la liberté des princes et ordonne aux maréchaux de n’obéir qu’à Gaston, lieutenant-général du royaume.
Mazarin est contraint de fuir Paris le 6 février 1651 et se réfugie à Saint-Germain. Un nouvel arrêt de bannissement est promulgué par le Parlement. Le roi et la reine sont retenus prisonniers au Palais-Royal ; pour démentir les rumeurs d’une nouvelle fuite, Louis XIV, âgé de 12 ans, est exhibé en train de dormir devant la foule dans la nuit du 9 au 10 février 1651. Anne d’Autriche est forcée d’accepter la libération de Condé, Conti et Longueville, qui font un retour triomphal le 16 février 1651.
Mazarin lui-même se rend au Havre pour libérer les trois princes, espérant en tirer un bénéfice politique, avant de se réfugier chez l’archevêque-électeur de Cologne, à Brühl. De son exil, il continue d’intervenir activement par une intense correspondance avec Anne d’Autriche et ses fidèles ministres (Le Tellier, Servien, Hugues de Lionne).
5.4. La Majorité du Roi et le Retour de Mazarin (mars 1651-janvier 1652) 👑
Le 15 mars 1651, les assemblées de la noblesse et du clergé demandent la réunion des États généraux, que la reine accepte de convoquer pour le 1er octobre 1651. Cette date est choisie astucieusement, car elle est postérieure à la majorité de Louis XIV (ses 13 ans), ce qui signifierait qu’il ne serait pas lié par les décisions de la régente.
Cependant, des fissures apparaissent rapidement parmi les coalisés :
- Le Parlement de Paris s’oppose aux États généraux, y voyant une limitation de son influence.
- La duchesse de Longueville s’oppose au mariage de son frère Conti avec Mademoiselle de Chevreuse.
- Anne de Gonzague, désormais ralliée à Mazarin, tisse des intrigues.
- Surtout, une fois l’exil de Mazarin obtenu, Gondi et Condé n’ont plus d’intérêt à rester unis.
Le 3 avril 1651, le Parlement impose une déclaration royale excluant les cardinaux des conseils du roi, visant Mazarin mais aussi Gondi, qui ambitionne le chapeau cardinalice. Condé atteint le sommet de sa puissance, mais son arrogance et ses exigences excessives éloignent de lui les partisans de la vieille Fronde. Turenne et son frère, le duc de Bouillon, se rallient au roi en mai 1651. Anne d’Autriche, avec courage, navigue à travers les intrigues et les renversements d’alliances, négociant secrètement avec Gondi.
Le 7 septembre 1651, la majorité du roi est proclamée. Condé, absent de la cérémonie, quitte Paris la veille et se réfugie à Trie-Château. Le lendemain, Louis XIV appelle à son conseil des hommes opposés à Condé. Le prince part ensuite pour Bordeaux, toujours agité par le parti de l’Ormée, et y rallie la Guyenne. Il signe un accord avec les Espagnols le 6 novembre 1651, promettant un port français en échange de fonds et de troupes. Condé contrôle alors un vaste territoire allant de la Guyenne à la Provence, avec le soutien de vétérans espagnols.
Face à cette menace, la reine-mère, le roi et Turenne installent la Cour à Poitiers pour se rapprocher de Bordeaux. Paris est laissée au Parlement, à Gondi (devenu cardinal de Retz), et à Gaston d’Orléans. Le désordre est tel que les Parisiens mettent Condé au ban du royaume et mettent la tête de Mazarin à prix (150 000 livres tournois) le 29 décembre 1651.
Le 12 décembre 1651, Louis XIV ordonne formellement le rappel de Mazarin. Le cardinal rejoint la Cour à Poitiers le 30 janvier 1652, marquant le retrait volontaire de Châteauneuf.
5.5. La Fronde du Grand Condé et la Bataille de Paris (1651-1652) ⚔️🏙️
Les troupes royales, sous le commandement de Turenne, commencent par libérer la Champagne des Impériaux, puis s’occupent de Condé. Condé est battu à Cognac (15 novembre 1651) et en Guyenne (hiver 1651-1652). Ayant perdu la Guyenne au printemps, il se dirige vers Paris avec un petit groupe de fidèles, dont La Rochefoucauld, pour prendre la tête des troupes réunies par le duc de Nemours et le duc de Beaufort.
Le 27 mars 1652 est le théâtre de l’intervention pittoresque de la Grande Mademoiselle à Orléans. Elle s’introduit dans la ville, dont son père est l’apanage, et ferme les portes aux troupes royales. Cela permet aux troupes de Condé de harceler l’arrière de l’armée royale. Mais à Bléneau, le 7 avril 1652, Turenne parvient à retourner la situation en faveur du roi. Découragé, Condé se réfugie à Paris le 11 avril 1652. Le Parlement observe une stricte réserve, tandis que Gaston d’Orléans prend le parti de Condé. Gondi (le cardinal de Retz), qui n’aime pas Condé, se retire à l’archevêché.
Autour de Paris, les troupes royales et celles de Condé se livrent à une guerre d’escarmouches. Turenne harcèle l’armée de Condé en Beauce et autour d’Étampes en mai, puis occupe Villeneuve-Saint-Georges pour couper les Lorrains de Charles IV venus secourir Condé.
Le 2 juillet 1652, un combat décisif a lieu dans le faubourg Saint-Antoine. L’armée condéenne est acculée, mais la Grande Mademoiselle ordonne de faire donner le canon de la Bastille sur la cavalerie royale et les hauteurs de Charonne, où Louis XIV et Mazarin observaient l’action. Ce coup de canon permet aux dernières troupes de Condé de trouver refuge dans la ville. À l’intérieur de Paris, le prince fait régner la terreur : l’hôtel de ville est brûlé, et une trentaine d’édiles favorables au roi sont massacrés (le 4 juillet 1652, dite la Journée des pailles). Le Parlement déclare Gaston d’Orléans lieutenant général de l’État le 20 juillet 1652.
Cependant, seul le « menu peuple » reste frondeur. Les notables aspirent à un retour au calme. Le roi convoque le Parlement hors les murs, à Pontoise, où il siège d’août à octobre 1652, créant deux parlements concurrents. Pour apaiser les esprits, Mazarin feint de s’exiler à nouveau le 19 août, se retirant à Château-Thierry puis à Bouillon.
Condé est de plus en plus isolé et abandonné par ses partisans. Gondi négocie directement avec Louis XIV. La formation d’un parti pour le retour à l’ordre à Paris entraîne la démission de la municipalité rebelle de Broussel le 24 septembre 1652. Finalement, Condé quitte Paris le 13 octobre 1652 et se met au service de la Couronne d’Espagne.
6. L’Épilogue : Le Retour à l’Ordre et les Conséquences de la Fronde ✨
La fin de la Fronde marque la victoire de l’autorité monarchique et le début d’une nouvelle ère pour la France, caractérisée par l’apogée de l’absolutisme sous Louis XIV.
6.1. Le Triomphe de Louis XIV et le Retour de Mazarin 👑
Le 21 octobre 1652, Louis XIV entre triomphalement à Paris et s’installe au Louvre, signe de la restauration complète de l’ordre royal. La déclaration royale du 12 novembre 1652 déchoit le prince de Condé de ses dignités et gouvernements, et le 27 mars 1654, un arrêt du Parlement le condamne à mort. Condé passe sept ans en exil, servant la Couronne d’Espagne dans la guerre franco-espagnole, qu’il considérait comme une lutte contre Mazarin plutôt que contre son roi. Ce n’est qu’en 1659, avec le traité des Pyrénées, qu’il recouvre ses titres et ses biens, se jetant aux pieds de Louis XIV le 27 janvier 1660 à Aix.
Son frère, le prince de Conti, également déclaré coupable de lèse-majesté, baisse les armes en signant la paix de Pézenas le 20 juillet 1653, mettant un terme définitif à la Fronde des princes. Il abandonne ses bénéfices ecclésiastiques et épouse Anne-Marie Martinozzi, nièce de Mazarin. La Fronde bordelaise de l’Ormée s’achève également en juillet 1653.
Enfin, Mazarin, l’homme tant décrié par les mazarinades, rentre à son tour le 3 février 1653 sous les applaudissements des Parisiens, achevant ainsi le cycle des révoltes.
6.2. Le Sort des Principaux Acteurs 🎭
Le dénouement de la Fronde a scellé le destin de ses principaux protagonistes, chacun connaissant une issue différente :
- Le Grand Condé : Après sept ans d’exil et de service espagnol, il est pardonné et réintégré, devenant un loyal serviteur de Louis XIV.
- Le Cardinal de Retz (Gondi) : Fait cardinal en 1652, il est emprisonné peu après au château de Vincennes, puis à Nantes. Il parvient à s’évader en 1654 et se réfugie à Rome.
- Gaston d’Orléans : Oncle du roi, il est invité à se retirer au château de Blois, où il finit sa vie loin des affaires politiques.
- La Duchesse de Longueville : Étonnamment, elle ne connaît pas la disgrâce. Après être devenue veuve en 1663, elle se retire du monde et devient une figure importante du jansénisme à Port-Royal.
- La Grande Mademoiselle (Anne-Marie-Louise d’Orléans) : Elle reçoit un ordre d’exil le 21 octobre 1652 et se retire au château de Saint-Fargeau. C’est là qu’elle entreprend la rédaction de ses célèbres Mémoires, qui constituent un témoignage précieux sur la cour et la sensibilité féminine du XVIIe siècle.
- La Robe parisienne : Un lit de justice triomphal, tenu au Louvre (et non plus au Palais de justice), interdit formellement aux magistrats de « prendre aucune connaissance des affaires de l’État », réduisant drastiquement leur pouvoir politique.
6.3. Un Héritage Durable pour la Monarchie Absolue 🚀
La Fronde, bien qu’ayant secoué le royaume jusqu’à ses fondations, a paradoxalement renforcé la monarchie française. Louis XIV, marqué par ces années de troubles, et notamment par l’humiliation de devoir fuir Paris et d’être exhibé endormi devant la foule, développe une détermination inébranlable à ne plus jamais laisser de place à l’opposition aristocratique ou parlementaire.
L’expérience de la Fronde a pavé la voie à l’apogée de l’absolutisme royal sous le règne personnel de Louis XIV. Elle a démontré la nécessité d’une autorité monarchique forte et incontestée pour maintenir l’ordre et l’unité du royaume. En mettant un terme aux grandes révoltes nobiliaires, elle a permis à Louis XIV de concentrer tous les pouvoirs et de construire la splendeur de Versailles, éloignant la noblesse de toute velléité d’autonomie politique au profit d’une vie de cour régie par le roi-soleil. La France sort transformée de la Fronde, plus unie autour de son souverain, mais au prix d’une centralisation accrue et d’une suppression des contre-pouvoirs qui avaient tenté de s’affirmer.