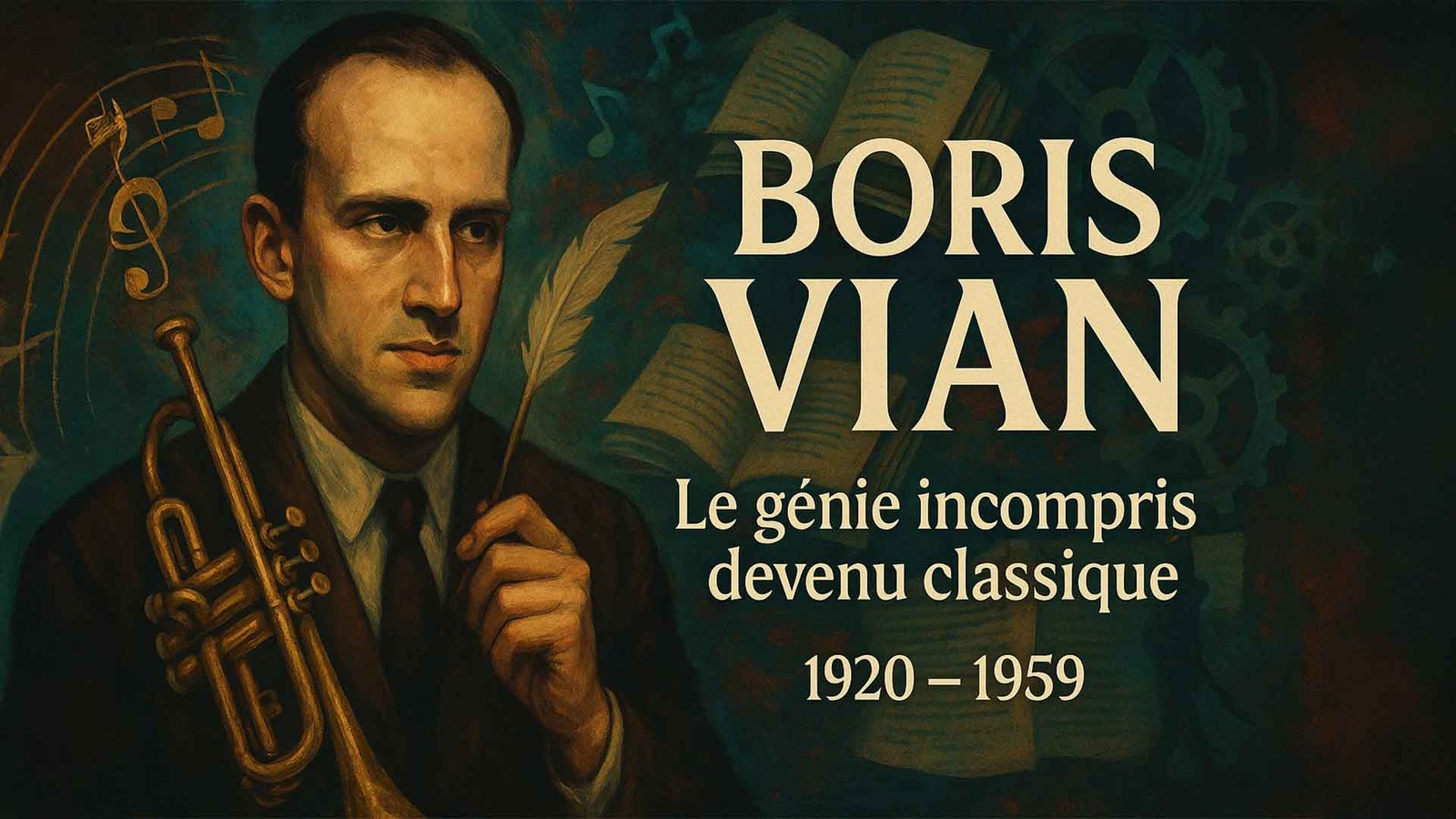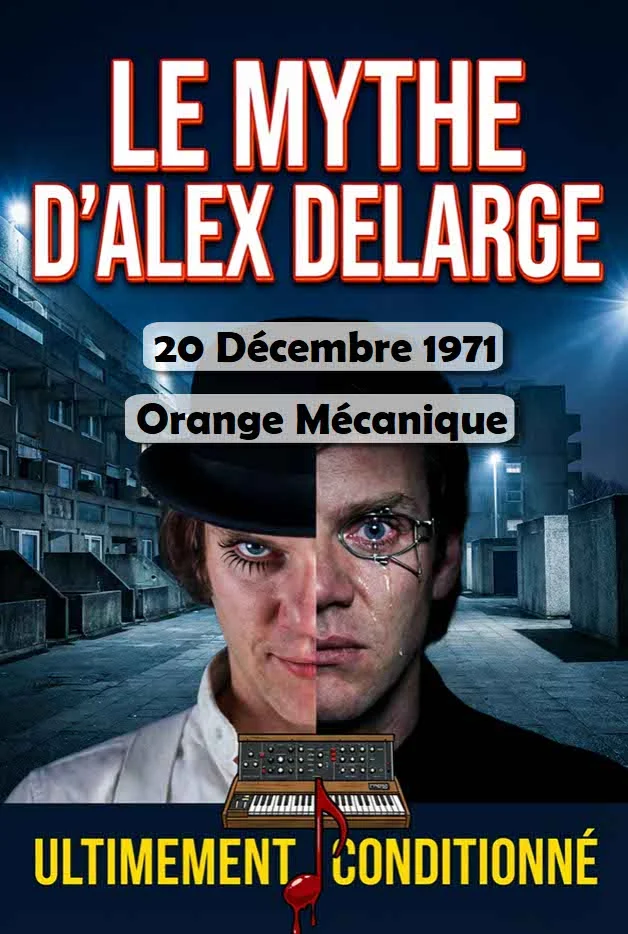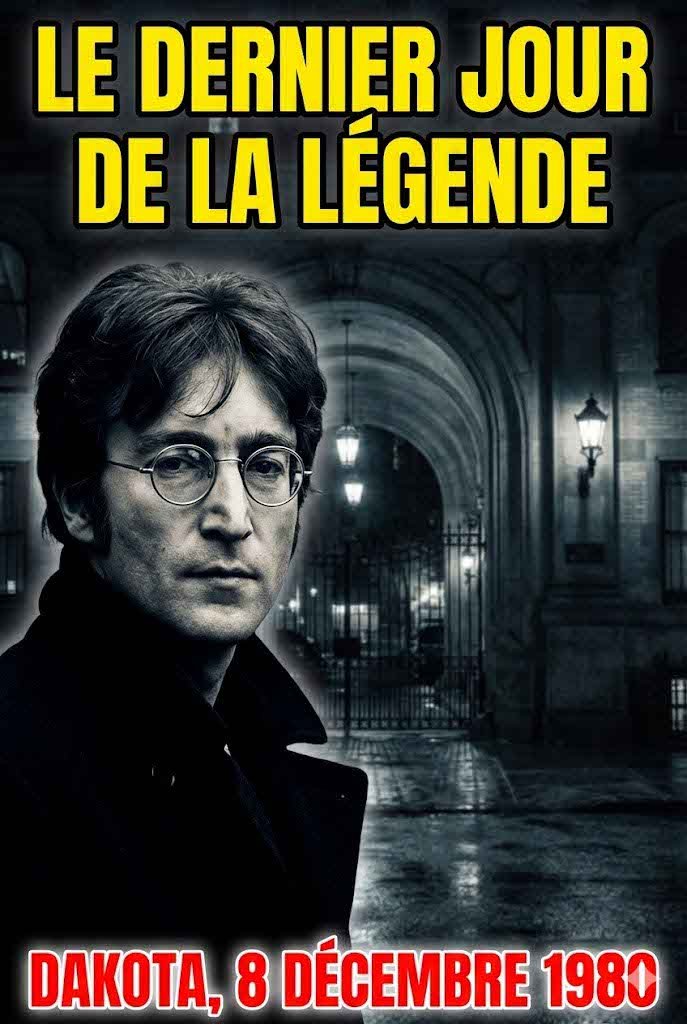Marcel Duchamp : L’Artiste Qui Redéfinit l’Art et Son Côté Obscur 💡
Introduction : Le Pionnier de l’Anti-Art 🎨
Marcel Duchamp, né le 28 juillet 1887 à Blainville-Crevon et décédé le 2 octobre 1968 à Neuilly-sur-Seine, est une figure emblématique du XXe siècle, dont l’influence continue de résonner dans l’art contemporain. Peintre, plasticien et homme de lettres français, il a été naturalisé américain en 1955. Dès les années 1960, il a été reconnu comme un artiste majeur, André Breton le qualifiant même d’« homme le plus intelligent du siècle ». Sa contribution la plus notable, l’invention des ready-mades, a exercé une influence déterminante sur divers courants artistiques.
Duchamp se distingue comme un artiste rare, n’appartenant à aucun mouvement artistique précis, possédant un style unique. En brisant les codes artistiques et esthétiques de son époque, il est perçu comme un précurseur des aspects les plus radicaux de l’évolution de l’art depuis 1945. Son œuvre et sa démarche artistique et idéologique ont inspiré des mouvements tels que l’art minimal, l’art conceptuel et l’art corporel. De nombreux essais lui attribuent également le rôle d’inspirateur du pop art, du néodadaïsme, de l’art optique et du cinétisme.
I. Biographie : Les Racines d’une Révolution Artistique 🌳
1.1. Origines et Jeunesse : L’Éveil d’un Esprit Curieux 📚
Henri Robert Marcel Duchamp est né dans une maison construite en 1827 à Blainville-Crevon, en Seine-Inférieure. Il est le fils de Justin Isidore Duchamp, notaire de Blainville-Crevon, et de Marie Caroline Lucie Nicolle, une musicienne accomplie. Marcel est le troisième des sept enfants de la famille, parmi lesquels on compte des figures artistiques notables : le sculpteur Raymond Duchamp-Villon (1876-1918) et les peintres Jacques Villon (Gaston Duchamp, 1875-1963) et Suzanne Duchamp (1889-1963). Son grand-père maternel, Émile Frédéric Nicolle (1830-1894), courtier maritime et artiste, a joué un rôle crucial en enseignant l’art à ses petits-enfants.
Duchamp a entrepris son apprentissage de la peinture auprès de son grand-père, puis de ses frères, de sa sœur et de leurs amis. En 1900, sa marraine, Julia Pillore, a épousé le peintre Paulin Bertrand. Cette même année, au collège, en classe de 4e, Marcel a remporté un prix de mathématiques et a réalisé son premier dessin connu, intitulé Magdeleine au piano. Durant l’été 1902, il a commencé ses premières toiles, s’inspirant des paysages de Blainville et vouant une admiration particulière à Monet. Le soir, il a appris à jouer aux échecs en observant ses deux frères, qui étaient particulièrement doués dans ce domaine.
Il a poursuivi brillamment ses études à l’école Bossuet de Rouen, obtenant à quinze ans la première partie de son baccalauréat avec un 1er prix de dessin. L’année suivante, il a décroché la deuxième partie du baccalauréat (Lettres-Philosophie) et la médaille d’excellence des « Amis des Arts ». En octobre 1904, avec l’accord de son père, il s’est installé à Montmartre, au 71, rue Caulaincourt, chez son frère Jacques Villon, déjà peintre. Il s’est inscrit à l’académie Julian, mais n’y est resté qu’une année, abandonnant en raison des cours théoriques. Il n’a cependant jamais cessé de dessiner, de jouer au billard et d’assister à des numéros de cabaret humoristiques. Marcel Duchamp est considéré comme un autodidacte, n’ayant jamais fréquenté d’école d’art au sens classique du terme.
1.2. Premiers Pas Artistiques à Paris : Entre Caricature et Salons 🎨
Après avoir échoué au concours d’entrée des Beaux-Arts de Paris, Marcel a été appelé à faire son service militaire le 30 octobre 1905. Son livret militaire de l’époque le décrit mesurant 1,68 m, avec des cheveux blonds et des yeux gris. En tant qu’ouvrier d’art, son temps de service a été réduit à une année au lieu de trois. Employé chez un imprimeur de Rouen, il avait obtenu quelques semaines auparavant un diplôme d’imprimeur de gravures, dans le but explicite de minimiser son passage sous les drapeaux. Par ailleurs, son père a pris sa retraite, quittant Blainville pour Rouen et emmenant toute la famille au 71, rue Jeanne-d’Arc. Nommé caporal le 11 avril 1906, Marcel a été libéré le 3 octobre et a emménagé au 65, rue Caulaincourt à Paris. C’est à cette période qu’il rencontre Juan Gris, son meilleur partenaire de billard.
Pour compléter ses revenus, Marcel, à l’instar de Villon, a tenté de proposer des caricatures satiriques à des journaux tels que Le Rire et Le Courrier français. Après plusieurs refus, dix-huit de ses dessins ont été publiés entre novembre 1908 et octobre 1910. Il signait ses œuvres du nom de « Duchamp » et pratiquait un humour parfois qualifié de gaudriolesque. Pour la première fois, Marcel a hésité entre deux carrières : humoriste ou peintre. Il a présenté ses dessins au Salon des Humoristes (Palais des Glaces, Paris) en mai et juin 1907, mais sans grand succès. Ce fut son premier contact avec le public. Entre Noël 1907 et la rentrée 1908, Marcel a mené une vie mondaine : fêtes mémorables rue Caulaincourt, exposition de quatre nouveaux dessins au 2e salon des artistes humoristes (mai-juin) puis de longues vacances à Veules-les-Roses. Il a déménagé à Neuilly-sur-Seine et y est resté jusqu’en 1913.
Il a commencé à exposer des tableaux au Salon d’Automne (Grand Palais, octobre-novembre 1908), notamment Portrait, Cerisier en fleurs, et Vieux cimetière, des œuvres très marquées par les impressionnistes. Au printemps 1909, il a exposé au Salon des indépendants (Orangerie des Tuileries) deux paysages, dont l’un a été acheté pour 100 francs, une première pour Marcel. De nouveau à Veules-les-Roses, il a peint les environs et a exposé ses paysages au Salon d’Automne pour la seconde fois, une toile ayant été achetée par Isadora Duncan. À la fin de l’année, il a exposé à la Société normande de peinture moderne, organisée à Rouen par son ami d’enfance, Pierre Dumont, qui lui a présenté Francis Picabia, également exposant. Ses deux frères, Jacques et Raymond, l’invitaient souvent à les rejoindre à Puteaux, au 7, rue Lemaître, où ils vivaient dans une sorte de communauté d’artistes. Ce lieu était un carrefour pour des cubistes comme Albert Gleizes, Fernand Léger, Jean Metzinger, Roger de La Fresnaye, ainsi que des poètes tels que Guillaume Apollinaire (qui n’appréciait pas ses nus, les décrivant comme « les nus très vilains de Duchamp »), Henri-Martin Barzun, Maurice Princet et le jeune Georges Ribemont-Dessaignes.
II. Les Années de Transition : De la Peinture Rétinienne à l’Innovation Conceptuelle 💡
2.1. L’Évolution Stylistique (1910-1915) : La Quête d’une Nouvelle Expression 🚀
Les années 1902-1910, qualifiées par Duchamp de « huit années de leçons de mutation », ont été une période d’exploration de divers styles artistiques, dont l’impressionnisme, le fauvisme et le cubisme. Cette phase a ouvert la voie à une période de recherches intenses. Entre 1910 et 1912, la manière de s’exprimer de Duchamp a évolué considérablement, passant par différentes phases. Il a d’abord été très marqué par Cézanne, comme en témoigne sa toile La Partie d’échecs, mais aussi par le fauvisme avec, par exemple, Le Portrait du docteur Dumouchel, tout en refusant de se conformer strictement aux modèles. Une amie de sa sœur Suzanne, puis une certaine Jeanne Marguerite Chastagnier, ont posé pour lui, et Duchamp a exécuté des études de nus avant de nouer une relation amoureuse avec cette dernière. Au cours de cette période, il est également devenu sociétaire du Salon d’Automne, ce qui lui permettait de ne plus passer par le jury de sélection, bien que, ironiquement, il n’y ait plus exposé. En 1911, il a réalisé une fusion entre le symbolisme et le cubisme, entreprenant des recherches picturales sur le mouvement, très influencées par les travaux de Kupka, son voisin de Puteaux. Dans la foulée, il a exécuté Moulin à café pour ses frères, sa première représentation de machine et de rouages.
C’est au début de 1911 qu’il a peint une toile intitulée Le Printemps (ou Jeune homme et jeune fille dans le printemps). Rétrospectivement, Arturo Schwarz y a vu « la première œuvre de Duchamp qui lui soit vraiment personnelle ». Dans cette œuvre notamment, la figure de l’androgyne est devenue un thème hautement symbolique pour ses futures grandes réalisations.
De 1911 à 1912, Duchamp a élaboré des dessins énigmatiques, tels que la série des Roi et reine traversés par des nus en vitesse et Joueurs d’échecs, ainsi que des tableaux minutieusement travaillés à l’ancienne, comme les deux versions de Nu descendant un escalier, Les Joueurs d’échecs, Le Roi et la Reine entourés de nus vites, Le Passage de la Vierge à la Mariée, et Mariée. Il a alors composé une iconographie hermétique, d’une complexité déconcertante, relevant d’une forme de maniérisme arcimboldesque. Les peintures de cette période, à l’interprétation si problématique et se démarquant manifestement du cubisme ou du fauvisme alors en vogue, pourraient être le produit d’un intérêt persistant et paradoxal pour un artiste considéré comme l’apôtre de l’anti-art, pour certains maîtres du passé tels que Bosch, Lucas Cranach l’Ancien, Léonard de Vinci, Bellange, Hogarth, Goya, ou des anonymes de la Renaissance française, et surtout pour Vélasquez. Les « figures » de ces compositions, puisées dans le répertoire de la peinture ancienne, sont devenues des agencements intriqués d’objets divers, un processus qui trouvera son aboutissement dans Le Grand Verre (1915-1923), dont le nom original est La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, et qui pourrait être interprété comme une version mécaniste des Ménines de Vélasquez.
2.2. Nu descendant un escalier : Scandale et Révélation 💥
Outre son regard incisif sur la peinture ancienne, Duchamp revendiquait un grand intérêt pour des auteurs tels que Jules Laforgue, Villiers de l’Isle-Adam et Alfred Jarry, dont les écrits ont nourri ses productions de cette période. C’est de cette époque, en novembre 1911, que date Jeune homme triste dans un train, œuvre dans laquelle il a déjà expérimenté les effets de la chronophotographie. Un poème de Laforgue lui aurait inspiré une composition, le Nu descendant un escalier, qu’il a également commencée fin 1911. La seconde version de cette toile a été proposée au Salon des indépendants le 20 mars 1912, mais elle a été refusée par ses amis du jury, ce qui a profondément blessé Duchamp. Il a déclaré bien plus tard : « Je reconnais que l’incident du Nu descendant un escalier aux Indépendants a déterminé en moi, sans même que je m’en rende compte, une complète révision de mes valeurs ».
Fin juin 1912, il a entrepris un voyage à Munich, où il a retrouvé son ami le peintre allemand Max Bergmann (1884-1955), à qui il avait offert un bilboquet dédicacé en 1910. Ce voyage a mis Duchamp en contact avec l’avant-garde munichoise. Il a visité les musées et les expositions temporaires, a été pris en photo par Heinrich Hoffmann et a acheté Über das Geistige in der Kunst (Du spirituel dans l’art), un essai signé Vassily Kandinsky. Il est ensuite passé par Bâle, Dresde et Berlin. Ce nouveau contexte intellectuel, artistique et scientifique l’a sans doute conduit à concevoir le plan du Grand Verre.
Il était présent aux côtés du groupe de la Section d’or en octobre 1912 à Paris, pour une exposition à la galerie La Boétie. Cette année, capitale pour son développement, lui a fait découvrir Voyage au pays de la quatrième dimension de Gaston de Pawlowski, alors directeur du magazine Le Vélo, mais aussi Impressions d’Afrique de Raymond Roussel et les calembours étymologico-fantaisistes de Jean-Pierre Brisset. Duchamp doit beaucoup à ces auteurs pour cette période de transition. Outre l’influence du mathématicien Maurice Princet, qui fréquentait les cubistes du groupe de Puteaux, Duchamp a reconnu plus tard sa dette envers ces penseurs singuliers, qui lui ont permis d’interpréter à sa manière certains aspects théoriques de la géométrie non euclidienne, bien qu’il ait déclaré ne pas être doué sur le plan scientifique.
2.3. L’Armory Show et la Reconnaissance Américaine 🗽
En octobre 1912, Walter Pach a mis en relation Duchamp et les autres membres du Groupe de Puteaux avec Walt Kuhn et Arthur Bowen Davies, respectivement directeur et président de l’Association des peintres et sculpteurs américains. Ces derniers préparaient une exposition majeure visant à établir un lien entre les modernistes de la fin du XIXe siècle, la peinture américaine et l’avant-garde européenne.
De février à mai 1913, les nouvelles recherches européennes ont été présentées aux États-Unis lors de l’International Exhibition of Modern Art : l’Armory Show. Cette exposition a eu lieu à New York, puis à l’Art Institute of Chicago et enfin à Boston à la Copley Society. Durant les deux premières expositions, le Nu descendant un escalier (N°2) a provoqué hilarité et scandale dans certains journaux. Cette œuvre, tout comme le futurisme, était influencée par la chronophotographie. Duchamp y a également présenté Le Roi et la Reine entourés de nus vites, Portrait de joueur d’échecs et une esquisse, Jeune homme triste dans un train. Il a vendu les trois dernières œuvres. L’Armory Show a fermé ses portes le 15 mars. Deux jours plus tard, Alfred Stieglitz a invité Marcel Duchamp et Francis Picabia à exposer dans sa galerie appelée « 291 », un événement qui est resté plus confidentiel en comparaison.
III. L’Invention du Ready-made et l’Anti-Art 🔄
3.1. Une Rupture Radicale : L’Objet Quotidien Élevé au Rang d’Œuvre 🛠️
En 1913, Duchamp a commencé à travailler à la bibliothèque Sainte-Geneviève dans le Quartier latin, ce qui lui a permis d’accéder à une nouvelle documentation et de se « dégager de toute obligation matérielle ». Duchamp a expliqué : « J’ai commencé une carrière de bibliothécaire qui était une sorte d’excuse sociale. C’était vraiment une décision, à ce point de vue, très nette. Je ne cherchais pas à faire des tableaux ni à les vendre, j’avais d’ailleurs un travail devant moi qui me demandait plusieurs années, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même ». Afin de se perfectionner, il a suivi en auditeur libre les cours de l’École des chartes dès novembre 1912, où il s’est particulièrement intéressé aux cours de bibliographie de Charles Mortet. Ce dernier, avec Maurice Davanne (oncle de Francis Picabia), fut l’un des deux conservateurs qui le soutinrent et lui permirent d’être officiellement embauché pendant les deux mois d’absence de Charles Kohler, alors malade (novembre-décembre 1913). Duchamp a ensuite continué à travailler comme bénévole (surnuméraire) de janvier 1914 à mai 1915.
Vers 1913-1915, il s’est écarté de la peinture avec l’apparition des premiers ready-mades. Il s’agit d’objets « tout faits » qu’il choisissait pour leur neutralité esthétique. Parmi ses exemples notables figurent Roue de bicyclette (1913) et Porte-bouteilles (1914). Le principe du ready-made consiste à prendre des articles ordinaires et prosaïques, et à les placer dans un contexte où leur signification d’usage disparaît sous un nouveau titre et un nouveau point de vue. En arrachant un objet manufacturé à son contexte habituel et en le plaçant dans un lieu inhabituel, Duchamp a élevé ces objets au rang d’œuvres d’art par son simple choix en tant qu’artiste. Cette démarche a marqué une rupture profonde avec toute la tradition artistique qui l’avait précédé. L’attribution de son ready-made le plus célèbre, Fontaine (1917), un urinoir renversé sur lequel il aurait apposé la signature « R. Mutt », est parfois attribuée à Elsa von Freytag-Loringhoven. Cet objet a été refusé par les organisateurs de l’exposition de la Société des artistes indépendants de New York.
Réformé en 1914 pour insuffisance cardiaque, conséquence de son service militaire en 1906, Duchamp a quitté la France, invité par Walter Pach, et a débarqué à New York le 15 juin 1915. Il y a noué des liens avec Man Ray, Arthur Cravan, Alfred Stieglitz et Francis Picabia, avec qui il a fondé la revue 391. Hébergé, grâce à Pach, par les époux et mécènes Arensberg, qui lui ont également fourni un atelier, Duchamp donnait des cours de français pour subvenir à ses besoins, tout en travaillant sur Le Grand Verre et en créant de nouveaux ready-mades. Parmi ceux-ci, on compte la pelle (En prévision du bras cassé), le peigne (Comb) sur lequel il avait tracé la phrase « Trois ou quatre gouttes de hauteur n’ont rien à faire avec la sauvagerie », ou encore With Hidden Noise, une pelote de ficelle comprimée entre deux plaques de métal. Ces propositions de Duchamp n’étaient pas destinées à être vendues, mais elles ont fortement influencé ses amis comme Picabia ou Man Ray.
3.2. Duchamp et Dada : L’Esprit Iconoclaste 🤪
Par ses objets trouvés et ses ready-mades, ainsi que par son attitude iconoclaste, Duchamp était très proche de l’esprit Dada. À ce titre, il a eu un impact non négligeable sur le mouvement dadaïste, courant auquel on peut aussi rattacher La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (1912-1923). Il est important de noter que si Duchamp a commencé les recherches pour Le Grand Verre dès 1912, il ne l’a réalisé qu’à partir de 1915, d’où les dates énoncées précédemment. À Paris et à New York, il a côtoyé d’autres protagonistes du mouvement, comme Francis Picabia et Man Ray. Cependant, il a refusé de s’associer au Salon Dada organisé par Tristan Tzara à Paris en 1922, souhaitant garder son indépendance et ne pas être étiqueté à un mouvement spécifique.
Duchamp se réclamait de « l’anti-art », étant ainsi inspiré par les artistes Dada rejetant les institutions artistiques dominantes telles que les musées ou les galeries. À travers ses œuvres, Duchamp a mené une réflexion profonde sur la notion d’Art et d’esthétique. Il s’est notamment opposé à une approche de la peinture qu’il qualifiait de « rétinienne », qu’il considérait comme dominante depuis l’époque de Gustave Courbet. Il a ainsi ouvert la voie à l’art conceptuel. Le Pop Art, Fluxus et le Happening ont également fait de fréquents emprunts aux pratiques et démarches artistiques de Duchamp. Ses rotoreliefs, notamment, ont influencé les tenants de l’art optique.
IV. Les Expérimentations Cinétiques et l’Ouverture de Nouvelles Voies 🎬
4.1. Mouvement et Cinéma : La Dynamique en Question 🎥
Duchamp était profondément préoccupé par le temps, la vitesse et la décomposition des mouvements. C’est ce qui l’a conduit, en 1925-1926, à expérimenter une nouvelle forme d’expression cinématographique, l’« Optical cinema », avec son unique film intitulé Anémic Cinéma. Ce film présente des plaques rotatives qui deviendront plus tard, en 1935, les « rotoreliefs » (ou « machines optiques »). Proposés sous la forme de plaques tournantes sur un axe grâce à un moteur, ils associaient jeux optiques, jeux de mots et géométrie. En 1963, Yannick Bellon a filmé la machine optique dans le cadre d’un projet de film sur l’Œil avec Georges Bernier.
Au moment où il travaillait sur les esquisses du Nu descendant l’escalier (1911-1912), il a découvert, entre autres, les expériences protocinématographiques d’Étienne-Jules Marey. Sa Roue de bicyclette (1913) peut également s’inscrire dans les prémices de ses travaux sur le mouvement poético-sculptural ; ce ready-made est en effet considéré comme à l’origine de l’art cinétique. La phase suivante a établi un rapport entre les moteurs électriques, les disques transparents ou recouverts de motifs géométriques (1920-1924), une invention pour laquelle il a sollicité l’aide de Jacques Doucet, et qui a culminé avec les « rotoreliefs », dont il a déposé le brevet en 1935. Intrigué par un effet optique de deux spirales tournant sur un axe commun, l’une semblant avancer et l’autre reculer, Duchamp a fabriqué un appareil pour démontrer ce principe, la Rotative plaques de verre. En 1924, il a construit la Rotative demi-sphère, optique de précision, un assemblage d’un disque de tôle et d’un demi-globe de verre animé par un moteur, ainsi qu’un anneau de cuivre sur lequel était gravée la phrase : « Rrose Sélavy et moi esquivons les ecchymoses des esquimaux aux mots exquis ». La première « machine optique » a été gravée sur disque rouge et reproduite en encart dans la revue 391, n° 18, en juillet 1924.
4.2. Anémic Cinéma et Participations Cinématographiques 🎞️
En 1926, il a réalisé un court-métrage expérimental intitulé Anémic Cinéma (35 mm, noir et blanc, d’une durée de 7 minutes), signé Rrose Sélavy, avec la complicité de Man Ray et du réalisateur Marc Allégret. Le film présente des disques en mouvement, sur lesquels sont parfois inscrites des phrases, telles que « L’enfant qui tète est un souffleur de chair chaude et n’aime pas le chou-fleur de serre-chaude », où l’absurde, l’humour noir et l’allitération sont de mise. Le film a été projeté en août 1926, lors d’une séance privée.
Il n’est pas certain que le court-métrage qu’il a réalisé avec Man Ray, Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven shaving her pubic hair (La baronne rase ses poils pubiens), avec la sculptrice Elsa von Freytag-Loringhoven comme interprète, soit retrouvé un jour. Ce film aurait été tourné à New York en 1921 et projeté dans le cercle des amis du mécène Walter Arensberg, mais les négatifs auraient été détruits.
Par ailleurs, Duchamp a entretenu un rapport complice avec le cinématographe. En 1918, il est apparu comme figurant dans Lafayette, We Come! de Léonce Perret. En 1924, il a participé au tournage d’Entr’acte de René Clair, un court-métrage expérimental et comique, où Duchamp apparaît en joueur d’échecs face à Man Ray. En 1944, il a été l’« artiste » dans le film expérimental de Maya Deren, Witch’s Cradle. En 1947, il a participé à la direction artistique du film Rêves à vendre (Dreams That Money Can Buy) d’Hans Richter, pour un épisode sur une musique de John Cage. Par la suite, il est apparu dans quelques films d’artistes et des documentaires, et ce, jusqu’à la veille de sa mort, notamment 8 X 8: A Chess Sonata in 8 Movements (1957), Jeux d’échecs (1963), La verifica incerta (1965), Dada (1967), Grimaces (1967), et Marcel Duchamp: In His Own Words (1969).
V. Œuvres Majeures et Réflexions Esthétiques 🖼️
5.1. Tu m’ : Synthèse et Adieu à la Peinture 🎨
Tu m’, une huile sur toile au format panorama, a été exécutée en 1918, quatre ans après sa dernière peinture. C’est la première œuvre de Duchamp à intégrer des objets dans sa peinture. Le tableau a été conçu pour s’insérer dans l’espace au-dessus de la bibliothèque de Katherine Dreier, sa mécène de l’époque qui lui avait commandé l’œuvre. Peinte peu avant le départ de Duchamp pour Buenos Aires, elle est souvent considérée comme « le dernier tableau de Marcel Duchamp », ou plus précisément comme un abandon de l’huile sur toile par l’artiste.
Sorte de synthèse des idées de Duchamp, on y retrouve trois représentations de ready-mades – une roue de bicyclette, un tire-bouchon et un porte-chapeau – peints comme des ombrages. Des lignes sont créées par la chute d’un mètre de fils d’un mètre de long. Une succession de carrés de couleur, suggérant des échantillons de peinture, traverse la toile jusqu’à une fissure. Un goupillon est enfoncé dans cette fissure réelle dans la toile du tableau, qui en rejoint une seconde, peinte celle-là en trompe-l’œil et retenue avec trois vraies épingles de sûreté. Sous la fissure peinte, on retrouve une main pointant un index, exécutée par un peintre d’enseignes que Duchamp avait embauché. Le titre lui-même pourrait être une abréviation homophonique de Tu aimes, ou de Tu m’ennuies, voire de Tu m’emmerdes, bien que Duchamp ne se soit jamais exprimé clairement sur le sujet.
5.2. Le Grand Verre : L’Œuvre Inachevée et Symbolique ✨
La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, communément appelée Le Grand Verre, a été réalisée aux États-Unis, enchâssée entre deux panneaux de verre montés sur cadre et trépieds (1915-1923), et est conservée au musée de Philadelphie. Elle est l’aboutissement de plusieurs études préliminaires, constituées de notes, d’esquisses et de « peintures », remontant au début des années 1910, comme la Boîte de 1914 ou les Neuf moules mâliques (1913-1914). Chez l’artiste, cette recherche correspond à l’obsession d’une « vraie forme » invisible, obtenue par contact et transparence, afin de synthétiser toutes ses théories, notamment l’art comme « fait mental ». Réalisée à l’huile, feuille et fil de plomb, cette étude, considérée par l’artiste comme inachevée, a été brisée lors de son transport en 1916. Marcel Duchamp a refusé de la faire restaurer. Les critiques d’art qui ont découvert cette œuvre ont intégré les brisures, les considérant comme partie intégrante de l’œuvre jusqu’en 1959.
5.3. Étant donnés : Le Mystère Final 🤫
Dans les dernières années de sa vie, Duchamp a exécuté une œuvre majeure pour le Philadelphia Museum of Art, intitulée Étant donnés : 1) La chute d’eau 2) le gaz d’éclairage… (1946-1966). Il s’agit d’un environnement sculptural érotique, dont la volonté de l’artiste a été qu’il ne soit pas visible du public avant l’année 1969, soit un an après sa mort.
5.4. Réflexion sur l’Art et l’Esthétique : Au-delà du « Rétinien » 🤔
Marcel Duchamp a révolutionné la conception académique de l’art qui, jusqu’alors, ne jugeait la valeur d’une œuvre qu’à l’aune des efforts et du travail dispensés pour une finalité édifiante. L’hétérogénéité de ses moyens d’expression et la complexité de ses œuvres, allant de la peinture (Nu descendant un escalier en 1912) à l’installation plastique la plus hermétique (Étant donnés…, « inachevée » en 1966), en passant par les détournements d’objets « tout faits » (un urinoir, un sèche-bouteilles, un peigne…), décrétés œuvres d’art par sa seule volonté et associés à sa constante revendication du « droit à la paresse », ne permettent de le classer dans aucun des mouvements artistiques du XXe siècle. Duchamp a traversé le cubisme, le futurisme, dada et le surréalisme en s’excluant lui-même de tout courant.
Il s’est opposé notamment à une approche de la peinture qu’il qualifiait de « rétinienne » et qu’il considérait comme dominante depuis l’époque de Gustave Courbet. Il a ainsi ouvert la voie à l’art conceptuel. Ses écrits ont été publiés sous les titres Duchamp du signe (1958) et Marchand du sel (1958).
VI. Intérêts et Pseudonymes Divers 🎭
6.1. Le Joueur d’Échecs : Art et Stratégie ♟️
Ayant appris le jeu dès son jeune âge, Duchamp s’y est consacré de plus en plus à partir de son séjour à Buenos Aires. Il est ainsi devenu un excellent joueur d’échecs. Champion de Haute-Normandie en 1924, il a participé plusieurs fois au championnat de France et a fait partie de l’équipe de France à l’Olympiade d’échecs de La Haye (1928), Hambourg (1930), Prague (1931) et Folkestone (1933). Il a affirmé : « Si tous les artistes ne sont pas des joueurs d’échecs, tous les joueurs d’échecs sont des artistes ».
En 1918-1919, il a sculpté un jeu de pièces complet lors de son séjour à Buenos Aires. En 1924, il a disputé une partie d’échecs avec Man Ray dans le film Entr’acte de René Clair, scène durant laquelle des trombes d’eau s’abattent sur les joueurs et dispersent les pièces du jeu. En 1925, il a conçu l’affiche du championnat de France d’échecs qui s’est déroulé à Nice. En 1932, il a publié, en collaboration avec Vitaly Halberstadt, L’opposition et les cases conjuguées sont réconciliées, un manuel qui traite des finales de rois et de pions, dont il a conçu la présentation et la couverture.
6.2. Pataphysicien et Oulipien : Les Jeux de l’Esprit et du Langage 🧠
Marcel Duchamp a également été satrape du Collège de Pataphysique en 1953 et est devenu membre de l’Oulipo en 1962. Connaissant déjà Raymond Queneau et François Le Lionnais, avec qui il partageait la passion des échecs, il a été recommandé par Simon Watson-Taylor, surréaliste et pataphysicien anglais, et a été aussitôt coopté avec enthousiasme. Il était considéré comme une sorte d’« oulipien par anticipation » en raison de son abolition des frontières entre les disciplines, sa vision de la solidarité entre le poétique et le scientifique, son audace sans frein dans l’expérimentation, sa distance ironique à l’égard des arts constitués, ses jeux verbaux et ses recherches linguistiques, comme en témoigne le personnage de Rrose Sélavy. Cependant, ses relations avec l’Oulipo furent épisodiques, et il aura plus marqué les oulipiens que l’Oulipo ne l’aura marqué.
6.3. Les Pseudonymes : Multiplicité des Identités 🎭
Duchamp a également été le créateur d’un personnage fictif, Rrose Sélavy, sculpteur et auteur d’aphorismes maniant la fausse contrepèterie et l’allitération. Concernant ce pseudonyme, Duchamp a expliqué : « J’ai voulu changer d’identité et la première idée qui m’est venue c’est de prendre un nom juif. J’étais catholique et c’était déjà un changement que de passer d’une religion à une autre ! Je n’ai pas trouvé de nom juif qui me plaise ou qui me tente et tout d’un coup j’ai eu une idée : pourquoi ne pas changer de sexe ! Alors de là est venu le nom de Rrose Sélavy ». Pour Duchamp, il s’agissait d’une manière de créer un ready-made. La redondance de la lettre « r » provient d’un jeu de mots avec « arrose » et Sélavy (arroser la vie) ou avec Éros et Sélavy, une transposition phonétique de « Éros, c’est la vie ». Duchamp est allé jusqu’à se faire photographier en vêtements féminins et a signé de ce pseudonyme quelques œuvres, dont Belle Haleine – Eau de Voilette, Fresh Widow et Pourquoi ne pas éternuer ? (Why not Sneeze?).
Un autre pseudonyme notable est R. Mutt, lié à l’œuvre Fontaine. Enfin, Marchand du sel est un autre nom utilisé par Duchamp, notamment dans le cadre de ses entretiens avec M. Sanouillet.
VII. Vie Privée et Dernières Années 🕊️
7.1. Relations Personnelles : Entre Indépendance et Engagement ❤️
Marcel Duchamp est le père d’une enfant naturelle, Yvonne Duchamp, née le 6 février 1911, de Marguerite Chastagnier, son modèle. L’artiste n’a découvert l’existence de cette enfant qu’en 1922 et l’a rencontrée plusieurs fois entre 1966 et 1968.
En 1924, Duchamp a entamé une liaison avec Mary Reynolds (née Hubachek, 1891-1950), qui exerçait le métier de relieuse d’art. Cette liaison a duré plus de vingt ans. Le 8 juin 1927, Duchamp a épousé Lydie Sarazin-Levassor (1903-1988). Ils ont divorcé six mois plus tard, le 25 janvier 1928. La rumeur colporte alors qu’il s’agissait pour Duchamp d’un mariage de convenance, Lydie Sarazin-Levassor étant la petite-fille d’un riche constructeur automobile, Émile Levassor. Le père était ravi qu’un mariage rapide arrange la situation de sa fille. Début janvier 1928, Duchamp a confié à sa femme qu’il ne pouvait plus supporter les devoirs du mariage et son sentiment d’enfermement. Moins de trois semaines plus tard, ils ont divorcé. Peu après son divorce, Duchamp s’est affiché publiquement avec Mary Reynolds jusqu’à la mort de celle-ci en 1950.
Entre 1940 et 1944, il était à New York, dans son atelier situé à Greenwich Village, vivant avec Mary Reynolds et entouré d’intellectuels français en exil, dont André Breton et Robert Lebel, avec lesquels il est resté très proche. En 1942, selon Serge Bramly, Duchamp s’est retrouvé bloqué dans un camp de transit à Casablanca, en attendant son bateau pour les États-Unis. En 1946, il a donné son atelier parisien situé au 11, rue Larrey, qu’il occupait depuis 1927, à Isabelle Waldberg. Entre 1947 et 1951, il a entretenu une liaison avec la sculptrice brésilienne Maria Martins. En 1954, il a épousé en secondes noces Alexina Sattler, surnommée Teeny. Il est devenu citoyen américain en 1955.
7.2. Héritage et Départ : L’Immortalité d’un Esprit Libre 🌟
Une grande rétrospective tenue à Pasadena en 1963 a consacré le rôle de Marcel Duchamp dans l’art contemporain. L’exposition a également donné lieu à des rééditions de ses ready-mades les plus célèbres, signées par Duchamp. Le samedi 15 mai 1965, Duchamp a organisé un « dîner Rrose Sélavy » au restaurant Victoria à Paris, s’entourant d’une trentaine de convives, dont Carl Reuterswärd, Jacques Fraenkel, Gabriële Buffet-Picabia, P. R. de Zayas et Marie-Claire Dumas, tous membres de l’Association pour l’étude du mouvement Dada. Au cours du dîner, il a déposé dans un récipient les cendres d’un cigare et, à la fin, celles du procès-verbal attestant du contenu du récipient baptisé L’Urne, lequel, véritable ready-made provoqué, a ensuite été scellé et signé.
Le 5 juin 1968, il a été longuement interviewé par Joan Bakewell pour la chaîne de télévision BBC. Marcel Duchamp est décédé le 2 octobre 1968, à l’âge de 81 ans, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Ses cendres reposent dans le caveau familial au cimetière monumental de Rouen. Une épitaphe est gravée sur sa tombe : « D’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent ». En septembre 1969, le Philadelphia Museum of Art a révélé au public son ultime œuvre : Étant donnés : 1° la chute d’eau ; 2° le gaz d’éclairage….
Conclusion : L’Éternel Moderniste 🚀
Marcel Duchamp reste une figure incontournable de l’histoire de l’art du XXe siècle, dont l’impact se fait encore sentir aujourd’hui. Son génie réside dans sa capacité à casser les codes établis et à redéfinir la notion même d’œuvre d’art. De ses débuts influencés par l’impressionnisme et le cubisme, à ses expérimentations avec le mouvement et le cinéma, en passant par l’invention révolutionnaire du ready-made, Duchamp a toujours cherché à repousser les limites de la création. Son refus d’être catégorisé dans un mouvement précis et sa démarche d’« anti-art » ont ouvert la voie à l’art conceptuel et ont influencé des générations d’artistes.
À travers des œuvres énigmatiques comme Nu descendant un escalier, Le Grand Verre, et le mystérieux Étant donnés, ainsi que par ses jeux avec l’identité sous des pseudonymes tels que Rrose Sélavy, Duchamp a prouvé que l’art pouvait être une affaire d’esprit autant que de rétine. Sa passion pour les échecs et son intérêt pour la pataphysique et l’Oulipo témoignent de son approche multidisciplinaire et de sa quête intellectuelle constante. Duchamp n’a pas seulement créé des œuvres ; il a offert de nouvelles manières de penser et de percevoir l’art, laissant un héritage d’innovation et de liberté d’expression qui continue d’inspirer.