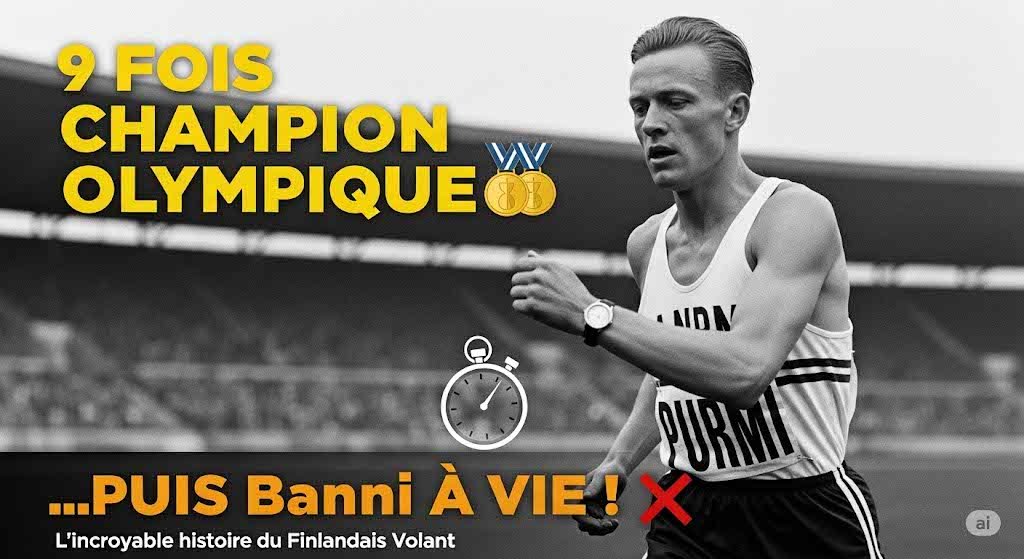Quelques pistes de lecture pour approfondir la réflexion :
Les 50 coureurs qui ont marqué l’histoire: Trail – marathon – Athlétisme : https://amzn.to/45OSDST
Les records sportifs : https://amzn.to/3VmUBoI
Guinness World Records 2025: 70e anniversaire : https://amzn.to/4lSKYsX
Mike Powell vs Carl Lewis : L’Odyssée Éternelle d’une Nuit Magique à Tokyo (1991) 🥇🇯🇵
Le monde de l’athlétisme a été le théâtre de nombreux exploits mémorables, mais rares sont les événements qui résonnent avec l’intensité et la grandeur du duel entre Mike Powell et Carl Lewis lors des Championnats du monde de Tokyo, le 30 août 1991. Cette soirée, depuis surnommée la « nuit magique à Tokyo », n’a pas seulement vu un record du monde tomber, elle a redéfini les limites de la performance humaine et gravé dans le marbre l’histoire d’une rivalité sportive comme nulle autre. C’est l’histoire d’un second couteau qui a éclipsé le roi, celle d’un record mythique brisé et d’une quête de reconnaissance enfin aboutie.
1. Une Rivalité sous les Projecteurs : Le Contexte Historique du Saut en Longueur 🚀
L’événement de Tokyo ne peut être pleinement apprécié sans comprendre le poids des attentes, la grandeur du record à battre, et la stature des deux hommes qui allaient s’affronter. Le saut en longueur, discipline exigeante alliant vitesse, puissance et technique, était à l’aube des années 1990 dominé par une figure tutélaire : Carl Lewis. Mais derrière lui, l’ombre d’un autre géant planait, celle de Bob Beamon, et un outsider déterminé rongeait son frein, Mike Powell.
1.1. L’Ombre de Bob Beamon : Un Record Jugé Insurpassable 🌌
Depuis le 18 octobre 1968, un record tenait en haleine le monde de l’athlétisme, celui de Bob Beamon et son bond de 8,90 mètres réalisé sous le ciel orageux de Mexico. Cette performance était alors considérée comme « invraisemblable ». Beamon avait amélioré le précédent record de pas moins de 55 centimètres, un écart colossal qui avait laissé les observateurs stupéfaits et convaincus que sa marque était « appelée à tenir durant des décennies ». Le mythe de Beamon était tel qu’il semblait intouchable, un Everest de la performance athlétique.
Pourtant, dès les années 1980, une nouvelle force émergeait, menaçant la longévité de ce record. La raison tenait en neuf lettres : Carl Lewis. La « megastar californienne » semblait « destinée à surpasser l’effarant saut de Mexico ». Pour la quasi-totalité du monde de l’athlétisme, c’était une évidence. Le décompte avant la chute du record de Beamon avait commencé, et le nom de Carl Lewis était sur toutes les lèvres.
1.2. Carl Lewis : Le Roi Incontesté en Quête d’Immortalité 👑
Carl Lewis, surnommé « King Carl », était sans conteste le monarque de l’athlétisme de son époque, et plus particulièrement l’empereur du saut en longueur. Sa domination était quasi absolue : il était invaincu depuis plus de dix ans et 65 concours dans cette discipline. Cette série d’invincibilité, entamée en juin 1981, à Sacramento, où le jeune Lewis, à moins de deux semaines de son 20e anniversaire, avait signé son premier coup d’éclat avec un saut à 8,62 mètres, la deuxième meilleure performance de tous les temps derrière Beamon, témoignait de sa régularité exceptionnelle.
1.2.1. Le Saut Fantôme d’Indianapolis (1982) : Une Prophétie Manquée 👻
Un an plus tard, en juillet 1982, à Indianapolis, Carl Lewis, alors âgé de 21 ans, semblait destiné à briser le record de Beamon. Lors du National Sports Festival, Lewis était « en état de grâce » et avait même « allègrement franchi les neuf mètres ». Pourtant, la légende ne s’est pas écrite ce jour-là. Lewis, encore à la sortie de l’adolescence et pas encore le « métronome, monstre de perfectionnisme » qu’il deviendrait, mordait ses trois premiers essais. Sur les deux premiers, il avait atterri « sur la ligne des neuf mètres ».
Avant sa quatrième tentative, Jason Grimes, alors en tête du concours, confia à son ami Dwight Stones qu’ils allaient assister à « un saut de 30 pieds » (environ 9,14 mètres), une marque plus symbolique que les 9 mètres pour les Américains. Lewis s’élança, atteignit la planche, et « retombe plus loin qu’aucun être humain ne l’a jamais fait avant ou après lui ». Dwight Stones, qui deviendra plus tard consultant pour NBC, jura l’avoir vu : « Carl a sauté 30 pieds. J’étais là, je l’ai vu ». Pendant deux secondes, Lewis fut recordman du monde, certain d’avoir pulvérisé les 8,90 mètres de Beamon.
Mais à la stupeur générale, le juge leva un drapeau rouge : mordu, encore. Lewis, qui savait son saut légal, ayant pris son impulsion avant la plasticine, fut « fou » de rage. Il plaida sa cause, montrant l’absence de trace de ses pointes sur la plasticine, mais « rien n’y fit ». Le râteau était déjà passé dans le sable, « effaçant tout stigmate de ce saut légendaire mais officiellement inexistant ». Lewis s’emporta devant les journalistes, déclarant que « ce sport n’est pas fait pour nous, les athlètes, ou pour les fans. Il appartient aux juges. Et ils ne prennent même pas la peine de vérifier s’ils n’ont pas commis d’erreur ». Grimes estima le saut à « trente pieds et deux pouces », soit environ 9,20 mètres. Lewis, plus mesuré, confirma : « Je ne sais pas si c’était au-delà des 30 pieds, mais c’était plus loin que Beamon, en tout cas ».
Ironiquement, cette déception précoce a eu un impact paradoxalement positif sur la carrière de Lewis. Avec le recul, il restait convaincu que s’il avait battu le record du monde si jeune, sa soif se serait tarie. « Ne pas avoir battu le record ce jour-là a été une bonne chose pour moi », estimait-il. « Cela m’a ouvert les yeux et m’a montré que si on voulait vraiment quelque chose, rien n’était impossible. Pour ma carrière, ça a été un jour très important. Ça a même tout changé ».
1.2.2. Le « Plafond de Verre » et le Retour en Forme à 30 Ans ⏳
Malgré sa domination incontestable et ses performances régulières au-delà des 8,60 mètres, Carl Lewis ne parviendra jamais officiellement à surpasser le record de Beamon. Il semblait toucher un « plafond de verre ». Son record personnel de 8,79 mètres, établi en 1983 à Indianapolis, resta sa meilleure marque jusqu’aux Championnats du monde de Tokyo huit ans plus tard. Seul Robert Emmiyan, un Soviétique, réussit à faire trembler Beamon avant Lewis, avec un saut à 8,86 mètres en Arménie en 1987, reléguant temporairement Lewis au second plan comme dauphin de Beamon.
En 1991, à l’âge de 30 ans, Carl Lewis était perçu par certains comme un « sprinter vieillissant ». Son meilleur saut de l’année, à 8,64 mètres, restait à une « distance respectable du mythique record ». Cependant, Tokyo allait tout changer. Quelques jours avant la longueur, le 25 août, Lewis avait « bluffé tout le monde » en décrochant son deuxième titre mondial sur 100 mètres, établissant un nouveau record du monde en 9″86. Ce regain de flamme laissait entrevoir la possibilité d’un nouvel exploit à la longueur, une discipline où personne « n’envisage sérieusement que Carl Lewis puisse être battu ». Les qualifications avaient d’ailleurs conforté cette impression, Lewis frappant fort avec 8,56 mètres.
1.3. Mike Powell : L’Outsider en Quête de Respect 🙏
Face à ce colosse qu’était Carl Lewis, se tenait Mike Powell. Décrit comme un « gai luron, attachant et toujours souriant », Powell cachait derrière cette façade joviale une profonde blessure : il « crevait de ne pas être pris au sérieux ». Il était perçu comme un « second couteau », toujours dans l’ombre de Lewis, une « star dont il avait toujours été dans l’ombre ». « Toute ma vie, j’ai été un outsider », dira-t-il lui-même. Ses statistiques, bien que solides avec un record personnel à 8,66 mètres en 1990 qui l’avait propulsé dans le Top 5 historique, ne lui conféraient pas la même aura que Lewis. En 1988, il avait été son dauphin sur le podium des Jeux de Séoul.
1.3.1. Une Haine Profonde pour le « Roi » 😡
La rivalité entre Powell et Lewis était empreinte d’une haine profonde, du moins du côté de Powell. Il « déteste par-dessus tout » Lewis, ne supportant « ni sa domination ni son sourire, dans lequel il ne voit que de l’arrogance ». Powell était « persuadé que Lewis le méprise », et il allait jusqu’à le « diaboliser ». Il ressentait une tension constante en sa présence : « Quand nous étions tous les deux dans la même pièce, j’avais toujours l’impression que nous allions nous battre. Mais il ne devait même pas remarquer ma présence ». Cette phrase révèle toute l’étendue de l’humiliation ressentie par Powell, l’impression d’être insignifiant aux yeux du champion.
Mike Powell aspirait à la reconnaissance, à « sa dose de gloire, sa part d’histoire ». Pour lui, Lewis représentait un « obstacle », « le seul, mais le plus imposant de tous ». Il devait le battre. Mais cela ne suffisait pas. Pour être « considéré comme unique », il lui fallait également le record de Beamon, de qui il avait également ressenti le « manque de considération ».
1.3.2. La Quête du Record de Beamon et la Prophétie de l’Autographe ✍️
Quelques semaines avant Tokyo, lors d’un meeting en Californie, Powell apprit que Bob Beamon, avec qui il partageait une formation de basketteur, était venu. Mais au moment de sauter, Beamon était déjà parti, une « claque en pleine figure » pour Powell. L’anecdote de son coach, Randy Huntington, aux Jeux de Séoul, où Beamon avait été invité pour les 20 ans de son saut, est encore plus révélatrice : Huntington lui avait dit être l’entraîneur du futur recordman, et Beamon l’avait regardé avec un visage exprimant le doute quant à sa sobriété. Ces épisodes renforçaient la détermination de Powell à non seulement battre Lewis, mais aussi effacer Beamon.
Pourtant, quand Powell affirmait sa foi en sa capacité à dominer Lewis et effacer Beamon, personne n’y croyait vraiment, l’écoutant poliment. À Tokyo, Powell rongeait son frein, attendant le septième jour de compétition pour entrer en lice, « visage fermé, ne parlant à personne ». La légende raconte qu’en donnant un autographe à un jeune Japonais, il a inscrit, à côté de sa signature : « 8.95 ». Que la légende soit vraie ou non, elle « traduit ses certitudes, qui elles sont bien réelles ». Son coach, Randy Huntington, confirmait : « Mike était absolument persuadé qu’il battrait le record de Beamon, explique Randy Huntington. En revanche, il doutait que cela suffise pour devenir champion du monde car il savait que Lewis, lui aussi, avait le record dans les jambes ». Cette dualité de conviction, celle de pouvoir battre le record mais pas forcément le champion, allait se jouer dans cette nuit électrique.
2. La Nuit Magique à Tokyo : Le Sommet de l’Athlétisme 🏟️
Le 30 août 1991, le stade olympique de Tokyo est le théâtre d’un événement qui allait entrer dans la légende. Une atmosphère palpable, presque surréelle, s’était emparée des lieux, annonçant une performance « exceptionnelle ».
2.1. Une Atmosphère Pré-Ouraganique 🌪️
Le vendredi 30 août, Tokyo était sous l’influence d’un typhon circulant aux alentours de la capitale nippone. Le taux d’humidité avait « grimpé en flèche », et le vent tourbillonnait, soufflant « dans un sens puis dans l’autre, tantôt dans le dos, tantôt défavorable » tout au long du concours. Mike Powell décrira cette atmosphère comme « électrique », la comparant à celle du Sud des États-Unis à l’approche d’un ouragan, où « l’air devient rare ». La tension était à son comble, et « la tempête n’est pas loin, mais c’est sur le stade qu’elle va s’abattre ».
2.2. Le Concours Dantesque : Un Échange de Coups de Maître 💥
La finale débute avec une intensité folle. Le « challenger » Mike Powell saute en premier, mais la nervosité et l’excitation le trahissent : 7,85 mètres. Un saut « complètement à côté ». Puis vient le tour de Carl Lewis. Dès sa première tentative, le « King » « assomme le concours » avec 8,68 mètres, sa meilleure performance depuis Séoul 1988. Un tel saut aurait suffi à lui assurer l’or dans la plupart des finales des trente dernières années. Ironiquement, ce sera « le moins bon des cinq sauts mesurés de Lewis à Tokyo ».
2.2.1. Lewis Frôle l’Éternité : Les Sauts Non Homologués 🌬️
Le concours de Lewis allait devenir « un chef-d’œuvre ». Après un deuxième essai mordu, il enchaîne avec « les deux meilleurs sauts de sa carrière » : 8,83 mètres, puis 8,91 mètres. Ce bond de 8,91 mètres est « un centimètre plus loin que le record de Bob Beamon ». Carl Lewis avait battu Beamon. Malheureusement pour lui, le vent, à chaque fois, soufflait « trop fort » : +2,3 m/s puis +2,9 m/s, au-delà de la limite autorisée de 2 m/s. Ses 8,91 mètres ne purent donc être homologués comme le nouveau record du monde. En voyant la mesure du vent puis sa marque, Lewis est passé de la grimace au sourire, avant de « lever les bras, triomphal ». Jusqu’à cet instant, « on n’a vu que lui ».
2.2.2. Powell face au Défi Ultime : Dépasser le Record et le Roi 👑
Après le 8,68 mètres initial de Lewis, Mike Powell savait qu’il lui faudrait battre son record personnel pour l’or. Maintenant, après le « bond de géant à 8,91m » de Lewis (même si non homologué), il savait qu’il devait « aussi améliorer le record du monde ». Après son catastrophique premier essai, Powell se ressaisit avec 8,54 mètres, puis 8,29 mètres.
Puis vint un moment crucial : Powell réussit ce qui aurait pu être le saut de sa vie s’il ne l’avait pas mordu. Il retomba « aux alentours de la ligne des neuf mètres », un « envol sidérant et interminable ». Mais, comme le disait Lewis, « un saut mordu est un saut qui n’existe pas ». En voyant le drapeau rouge, Powell devint « dingue ». Il « hurla, râla, et s’est même agenouillé devant la plasticine ». Il admettra avoir « fait un peu le show », sachant pertinemment qu’il avait mordu. Mordre était son « péché mignon », une conséquence de son désir ardent de passer « de l’ombre à la lumière », le poussant à manquer de contrôle à l’approche de la planche, ce qui lui avait valu le surnom de « Mike-Foul » par son coach Randy Huntington.
Malgré le zéro de cette tentative, ce saut, bien qu’invalidé, eut le mérite d’ancrer « un peu plus fortement encore les certitudes du clan Powell » : oui, il avait les moyens d’aller chercher « Lewis, Powell, l’or, le record, la légende. Sa légende ». C’est juste après ce saut de Powell que Lewis réalisa sa marque à 8,91 mètres. En quelques minutes, « cette finale a changé de dimension et chacun pressent que ce n’est pas fini ».
2.3. L’Envol Historique : 8.95m, Le Saut de l’Impossible 🚀
L’heure de vérité arriva à 19h07, pour le cinquième essai de Mike Powell. Son visage, marqué par une « mâchoire serrée, traits crispés », traduisait « la rage et l’envie qui le porte et non une quelconque nervosité ». Dans son attitude caractéristique, il agita les bras, faisant des « moulinets, de bas en haut, bras gauche, bras droit ». Il s’élança. Powell n’était pas un sprinter comme Lewis, mais « dans les dix derniers mètres avant la planche, il va aussi vite que Carl », selon Huntington. Cela expliquait parfois sa difficulté à contrôler son dernier appui.
Il s’envola. « À vue d’œil, comme lors de son précédent saut, il est aux environs des neuf mètres quand il reprend contact avec la terre ferme ». Carl Lewis, « nerveusement », remit puis ôta son sweat-shirt, peut-être avait-il déjà compris.
Ce qui suivit fut une attente « interminable » de 35 secondes, un « drame » en trois actes : la planche, le vent, le résultat. Pour Powell, Lewis, les 60 000 spectateurs et les millions de téléspectateurs, chaque seconde était une éternité. Cette fois, la planche est bonne : drapeau blanc. La bourrasque s’était calmée : le vent était de +0,3 m/s, ce qui signifiait que, « contrairement aux 8,91m de Lewis quelques minutes plus tôt, la marque sera officielle ».
Powell scruta « l’affichage électronique », ne tenant plus en place, il savait, il sentait. Lorsque « 8.95 » s’afficha, il « entame une course folle alors que le stade vient d’exploser dans un bruit infernal contrastant avec le silence de l’attente des secondes précédentes ». Mike Powell venait de battre le record du monde de Bob Beamon. En moins de cinq minutes, Lewis et lui étaient allés « au-delà des 8,90m de Mexico ». Ce fut un « moment de pure folie ».
À l’autre bout de la planète, chez Bob Beamon, le téléphone sonna à 6 heures du matin. Beamon, qui n’avait pas eu le courage de se lever pour regarder le concours en pleine nuit, craignait toujours deux choses à ces heures-là : un malheur familial, ou la chute de son record. Ce 30 août 1991, c’était la « réponse B ». Son ami Ron Freeman, médaillé de bronze à Mexico sur 400 mètres, lui annonça que, « pour la première fois depuis 22 ans, 10 mois et 12 jours, il n’est plus le recordman du monde du saut en longueur ». Plus encore que la nouvelle, « l’identité du ‘voleur' » lui imposa de s’asseoir. Beamon, philosophe, déclara : « Depuis bientôt 23 ans, on me répétait que mon record ne serait jamais battu, mais j’ai toujours su qu’il le serait un jour ».
3. L’Héritage d’un Exploit et la Longévité d’un Record 🏆
Après l’euphorie légitime, Mike Powell retomba sur terre. Sa prophétie de l’autographe s’était réalisée, mais une autre crainte le hantait : Lewis avait encore deux essais. Et s’il battait Beamon sans battre Lewis ? « Mon record tient depuis 23 ans, mais sur le coup, je n’étais pas certain qu’il tiendrait 23 minutes », avoua-t-il en 2014.
3.1. Carl Lewis : Le « Concours du Siècle sans la Victoire au Bout » 💔
Les craintes de Powell étaient fondées. Lors de ses deux dernières tentatives, Carl Lewis réalisa « les deux meilleurs sauts de sa vie avec un vent régulier » : 8,87 mètres puis 8,84 mètres. Relire sa série dans cette finale est « ahurissant » :
- 1er essai : 8,68m
- 2e essai : –
- 3e essai : 8,83m (vent trop favorable)
- 4e essai : 8,91m (vent trop favorable)
- 5e essai : 8,87m
- 6e essai : 8,84m
Sa moyenne sur ses cinq sauts mesurés atteignait 8,83 mètres. C’était « le concours du siècle face au saut du siècle ». Lewis, dans ses commentaires post-compétition, se montra fair-play mais avec une pointe d’amertume : « Mike était en grande forme, il le mérite. Il a fait un seul saut exceptionnel. Il ne le refera peut-être jamais. Moi, je pouvais difficilement faire un meilleur concours. J’aurais pu aller plus loin sur mon dernier essai mais je n’ai pas pu le faire. C’est quelque chose que je dois accepter ». Cette phrase révélait sa conviction d’avoir été à son apogée, tout en minimisant la reproductibilité de l’exploit de Powell.
3.2. L’Amertume et la Reconnaissance : Une Rivalité Apaisée par le Temps 🤝
Face à cet « hommage » teinté de « oui mais », Powell, qui venait de dominer Lewis pour la première fois en 15 confrontations, se montra « mitigé ». « Ça m’embête un peu qu’il ne reconnaisse pas pleinement ma supériorité, mais je peux le comprendre. Avec le temps, il sera en paix avec ça », déclara-t-il, avant de conclure, comme pour signifier que ce manque de considération n’avait plus d’importance : « De toute façon, on s’en fout, non ? ».
C’était son moment, « et personne ne peut le lui enlever ». « Tout ce que j’ai fait dans ma vie s’est concentré sur ce saut, tout a pris sens à cet instant », expliqua-t-il sur NBC. « C’était le moment et l’endroit pour montrer au monde entier qui j’étais ».
La frustration nippone de Lewis allait, de manière paradoxale, le propulser plus loin dans la légende. À Tokyo, Lewis avait un plan : après son record du monde au 100 mètres, il voulait battre celui de la longueur et se retirer de cette discipline pour se consacrer au sprint. Mais le dénouement de cette finale historique le fit changer d’avis. King Carl continua, et à défaut du record, il décrocha l’or à Barcelone puis à Atlanta, s’offrant un « quadruplé olympique à la longueur ».
Chacun des deux athlètes trouva sa place dans la légende de l’athlétisme, avec ses propres « manques ». Powell ne fut « jamais champion olympique », tandis que Lewis ne fut « jamais recordman du monde ». Powell affirma ne pas échanger son record contre une médaille d’or, mais « trois ou quatre, il y réfléchirait ».
Le temps, cependant, a apaisé le ressentiment. En 2016, Mike Powell ira même jusqu’à estimer que Lewis était « le plus grand sauteur de l’histoire ». Plus grand que lui, que Jesse Owens ou Bob Beamon, détenteurs du record du monde pendant 30, 25 et 23 ans respectivement, formant un « triptyque inégalé dans l’histoire de l’athlétisme ». « Carl nous a tous botté le cul pendant 10 ou 15 ans », dit Powell. « Si j’ai battu le record du monde, c’est parce que Carl Lewis a existé. Sans lui, battre le record de Beamon n’aurait pas été possible. Il est le plus grand, mais je suis le deuxième. ». À Tokyo, il fut même le premier. Le temps d’une soirée de feu. Une « soirée en forme de part d’éternité qui n’en finit plus de durer ».
3.3. Le Record de Powell : Une Longévité Inattendue ⏳
Le record de Mike Powell a résisté « très exactement trente ans », bien plus que ses « espérances au soir du phénoménal concours de Tokyo ». Il avait alors plaidé : « Beamon l’a eu pendant 23 ans, laissez-le-moi au moins deux ou trois ans ! ». Une autre prophétie à moitié réalisée.
En 1995, Ivan Pedroso réalisa un saut à 8,96 mètres à Sestrières, un centimètre de plus que Powell, avec un vent régulier. Mais après enquête, la fédération italienne refusa de transmettre le procès-verbal d’homologation, en raison de la présence d’un officiel, Luciano Gamello, « trop près de l’anémomètre, faussant ainsi le résultat ». Pedroso ne digérera jamais cet imbroglio.
En dehors de cet épisode, « jamais personne n’a menacé directement le record de Powell ». Le meilleur saut officiel depuis Tokyo est de 8,74 mètres (Erick Walder en 1994, Dwight Philipps en 2009). En 2019, Tajay Gayle a réalisé 8,73 mètres. Mais, « globalement, la discipline a régressé depuis le début du XXIe siècle ». Aux Jeux de Tokyo les plus récents, l’or fut décroché avec 8,41 mètres. Randy Huntington jugeait en 2015 que si « certains sauteurs auraient pu battre le record de Mike, parce qu’ils avaient les qualités physiques pour le faire », ils « n’avaient pas les fondamentaux techniques ». Il y a également « une part de chance, aussi. Un peu trop de vent, parfois ». Il rappela que Powell lui-même avait sauté « six fois au-dessus de 8,90m », mais sur « cinq de ces six sauts, le vent soufflait trop fort », comme son 8,99 mètres à Sestrières en 1992, non homologué.
4. Conclusion : L’Éternel Écho de Tokyo 1991 ✨
Le duel entre Mike Powell et Carl Lewis à Tokyo en 1991 reste l’un des moments les plus intenses et émouvants de l’histoire de l’athlétisme. C’était « un double clin d’œil du destin » : l’un « vachard » pour le roi déchu, l’autre « savoureux » pour l’outsider enfin reconnu. Cet événement n’a pas seulement fait tomber une marque, il a « tourné une page », marquant l’avènement d’une nouvelle légende tout en célébrant la grandeur de celle qui l’avait précédée. La « nuit magique à Tokyo » demeure une source d’inspiration, un rappel que la persévérance, la rage et le désir de respect peuvent transformer un « second couteau » en géant, et qu’un « envol historique » peut devenir une part d’éternité. C’est une histoire gravée à jamais dans les annales du sport.