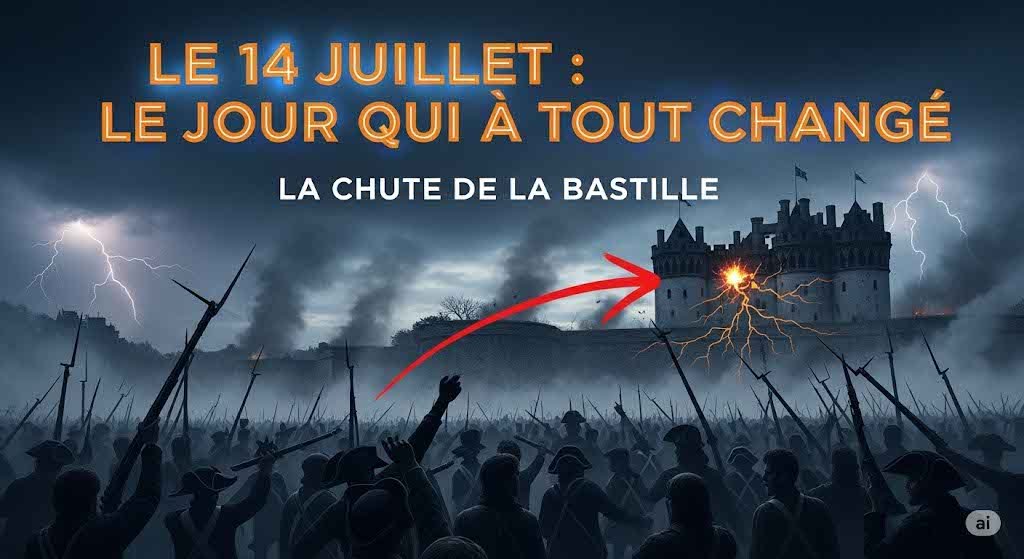Le Centre national d’information routière (CNIR) : Un Pilier de la Gestion du Trafic et de la Sécurité Routière en France 🇫🇷🚗
La France, avec son réseau routier en constante évolution et un parc automobile croissant, a mis en place des systèmes sophistiqués pour informer ses usagers. Au cœur de cette initiative se trouvait le Centre national d’information routière (CNIR), un organisme pionnier dont l’histoire et les missions ont profondément marqué la gestion du trafic et la sécurité sur les routes françaises pendant près de cinq décennies.
Introduction au CNIR et aux Centres d’Information Routière (CIR) 🗺️
Le Centre national d’information routière (CNIR) était une entité interministérielle, fruit d’une collaboration entre les ministères de la Défense, de l’Intérieur et de l’Écologie. Fondé en 1968, il était stratégiquement implanté à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Sa vocation principale était triple : le recueil, le traitement et la diffusion de l’information routière. Cette information était destinée à un large éventail d’acteurs, incluant les usagers de la route eux-mêmes, les médias et les autorités publiques.
Le CNIR exerçait sa compétence sur l’ensemble du territoire national de manière permanente, concentrant particulièrement son action sur le réseau routier principal et les événements majeurs impactant la circulation. Pour assurer une couverture et une réactivité optimales, le CNIR était appuyé par un réseau de sept Centres régionaux d’information et de coordination routières (CRICR). Ces CRICR, créés entre 1971 et 1980, étaient répartis dans des villes clés : Créteil, Lille, Metz, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes. Ils déclinaient la même mission que le CNIR, mais au niveau régional, permettant ainsi une gestion plus fine et localisée de l’information. L’ensemble formé par le CNIR et ces sept CRICR était parfois désigné sous l’appellation générique de Centres d’informations routière ou CIR.
L’ère du CNIR et des CRICR a pris fin le 1er mai 2016, date de leur dissolution. Leurs missions ont été réaffectées à d’autres structures étatiques. Pour le CNIR, la sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé (GRT) au sein de la Direction des Infrastructures de transport (DIT) de la Direction générale des Infrastructures, des transports et de la Mer (DGITM), relevant du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM), a pris le relais. Concernant les CRICR, ce sont désormais les Directions interdépartementales des routes (DIR) qui se chargent de la coordination des chantiers sur le réseau routier.
Les Prémices de l’Information Routière en France : Une Évolution Historique ⏳
L’histoire de l’information routière en France est étroitement liée à l’essor de l’automobile et à l’augmentation du trafic, particulièrement après les années 1950. À cette époque, de nombreux foyers français se dotent d’une voiture, et les Parisiens commencent à adopter l’habitude de quitter la capitale en voiture le week-end. Le corollaire de cette nouvelle mobilité est l’apparition, dès le dimanche soir, des premiers encombrements récurrents lors des retours. Cette situation a mis en lumière la nécessité d’organiser l’information et la gestion du trafic.
Radio France, en tant que média de masse accessible, a joué un rôle crucial et précurseur dans la diffusion de l’information routière. Dès 1950, l’émission « Route de nuit » est lancée sur Paris Inter, suivie en 1951 par la naissance du premier PC « Inter Route ».
Un tournant majeur survient en 1958 avec la mise en place d’un partenariat structurant : France Inter commence à diffuser des « points routes ». Ces informations étaient basées sur des données directement fournies par la Gendarmerie nationale. Les premières diffusions de ces « points routes » étaient réalisées depuis un lieu emblématique pour les automobilistes de l’époque : le carrefour de l’obélisque en forêt de Fontainebleau, point de croisement des Routes Nationales 6 et 7 (RN6 et RN7).
L’année 1960 marque une étape importante avec l’ouverture d’une section de l’autoroute A6 jusqu’au Coudray-Montceau, à environ 30 km au sud de Paris dans l’Essonne. Cette sortie se connectait directement à la RN7 et, avec le carrefour de l’obélisque (situé à 23 km au sud-est), formait un véritable entonnoir, drainant une circulation intense en provenance de tout le sud-est de la capitale.
Face à ces défis de trafic, la Gendarmerie de Seine-et-Marne innove en adoptant un dispositif alors inédit : la surveillance par axe. Le carrefour de l’obélisque, en raison de sa position stratégique, est choisi comme point de convergence de ce système. C’est là qu’un « PC avancé » est implanté en 1960. Ce poste avait pour mission de renseigner, aider, dépanner et même secourir les usagers. Installé dans une remorque de commandement, il assurait une permanence de 7h00 à 22h00 du lundi au jeudi, et 24h/24 les vendredis, samedis, dimanches, ainsi que les veilles et jours de fête. Ce « PC avancé » de Fontainebleau est reconnu comme la première structure dédiée à l’information de l’usager sur les conditions de circulation. C’est également à cette période que les premières surveillances aériennes du trafic sont réalisées.
En 1966, ce dispositif précurseur est généralisé à l’ensemble du territoire national. Cela conduit à la création du Centre d’information routière de la Gendarmerie au Fort de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ce centre devient rapidement célèbre auprès des médias et du grand public sous le nom de « PC de Rosny ».
Dans le même temps, le réseau d’infrastructures routières en France se développe à grande vitesse. En 1967, la France comptait déjà 1 000 km d’autoroutes, un chiffre qui atteindra 5 000 km en 1981 et près de 11 000 km en 2009. La surveillance de ces autoroutes est partagée entre la Gendarmerie, responsable des autoroutes de liaison (généralement concédées), et la Police, en charge des autoroutes de dégagement.
C’est dans ce contexte de croissance exponentielle du trafic et des infrastructures que la nécessité d’une coordination renforcée devient évidente. Les ministères en charge de la gestion du trafic et de la sécurité routière prennent la décision de mutualiser leurs moyens. C’est ainsi que le CNIR est créé en 1968, tel que défini précédemment. Une particularité notable de la France est la prise en charge au niveau national de l’intégralité de l’information routière par les pouvoirs publics, contrairement à d’autres pays européens comparables où cette gestion est principalement assurée par les exploitants de réseaux ou les automobiles-clubs.
La Naissance de « Bison Futé » : Une Réponse à la Crise 🐻❄️
L’année 1975 est marquée par un événement qui va profondément influencer l’information routière en France : le tristement célèbre embouteillage du 2 août 1975. Ce samedi caniculaire, un cumul de 600 km de bouchons est enregistré à travers le pays. La Route Nationale 10, reliant Paris à la frontière espagnole près de Bayonne, est saturée sur un quart de sa longueur. Les conséquences sont dramatiques : au cours de ce week-end, 145 personnes perdent la vie, notamment en raison d’accidents et des effets de la canicule.
Cet événement engendre une forte pression médiatique et publique sur les pouvoirs publics. Il devient impératif d’éviter qu’une telle catastrophe ne se reproduise. Pour cela, trois leviers principaux sont identifiés pour améliorer la gestion des grands départs et retours :
- L’étalement dans le temps des déplacements : encourager les usagers à ne pas partir ou revenir tous le même jour ou à la même heure.
- Le renforcement des itinéraires Bis : proposer des alternatives aux axes principaux saturés.
- La communication vers l’usager : informer activement et en amont les automobilistes.
Pour l’été 1976, des mesures concrètes sont mises en œuvre. Pas moins de 600 000 cartes de France sont éditées, détaillant 3 500 kilomètres d’itinéraires bis. De plus, 18 aires d’accueil sont aménagées sur les axes les plus chargés, anticipant les difficultés prévisibles. Les médias jouent un rôle essentiel en relayant ces conseils ; 64 quotidiens nationaux et régionaux publient notamment les heures de départ à éviter en fonction des régions.
C’est dans le cadre de cette campagne de grande envergure que naît un personnage qui deviendra emblématique : Bison futé. Créé par le publicitaire Daniel Robert, sur une idée originale de l’ingénieur béarnais Jean Poulit, Bison futé incarne cette nouvelle approche de la communication préventive. Le succès de cette opération est immédiat et retentissant, avec une réduction de 30 % des encombrements par rapport à l’année précédente. Face à une telle réussite, l’opération est pérennisée, et Bison futé devient un symbole durable de l’information routière en France.
L’Évolution de la Communication Routière 🛣️
Si la radio a toujours été un support privilégié pour la diffusion d’informations en temps réel aux automobilistes en raison de son accessibilité, la communication « Bison futé » s’est diversifiée au fil du temps, adoptant différents supports et formes.
Les Anciens Médias 🕰️
La carte Bison futé, lancée en 1976, a été un outil phare de l’information prévisionnelle. Publiée chaque année jusqu’en 2003, cette carte routière enrichie fournissait des informations précieuses :
- Les zones de bouchons étaient clairement identifiées par des points noirs.
- Les itinéraires Bis étaient mis en évidence en vert, offrant des alternatives aux axes principaux.
- Les points d’accueil étaient signalés par le logo Bison futé.
- Divers renseignements pratiques étaient également inclus, comme les stations de gonflage des pneumatiques ou les lieux d’activités sportives et de jeux.
L’année 2003 marque la dernière édition de cette carte emblématique. Plusieurs facteurs expliquent son retrait. D’une part, le maillage autoroutier de la France s’était considérablement renforcé. Des axes majeurs comme le Paris-Lyon-Marseille par les A6 et A7 avaient perdu de leur prépondérance grâce à la mise en service de nouvelles autoroutes comme l’A75, l’A5 et l’A39. Ces nouvelles infrastructures offraient aux usagers de multiples alternatives, notamment pour éviter le transit par la région parisienne (avec les A26 et A28 par exemple). D’autre part, les itinéraires Bis avaient évolué. De simples alternatives touristiques, ils étaient devenus des itinéraires de délestage activés lors d’opérations spécifiques de régulation du trafic, comme les plans Palomar. Ces plans, dont le nom dérive de l’axe PAris-LyOn-MARseille auquel ils s’appliquaient initialement, sont des dispositifs préétablis qui sont activés en temps réel lorsque le trafic autoroutier atteint un seuil critique.
D’autres médias ont également été utilisés par le passé avant de tomber en désuétude :
- Le système Antiope, un précurseur du télétexte, a permis la diffusion d’informations routières quotidiennes entre 1985 et 1991, avant de devenir obsolète.
- En 1986, le « 36 15 ROUTE » a été mis en service sur le Minitel. Ce service offrait non seulement des prévisions et des conseils, mais aussi des rubriques spécifiques pour les poids lourds, des informations sur les pays limitrophes, des rubriques saisonnières et des rappels de réglementation. Ce dispositif est devenu caduc lorsque le Minitel a été supplanté par l’Internet.
Les Supports Actuels 💻📱
Avec l’avènement des nouvelles technologies, l’information routière s’est modernisée et s’appuie désormais sur des supports numériques performants.
Information prévisionnelle : Depuis 1983, Bison futé publie un calendrier prévisionnel devenu une référence pour les automobilistes. Ce calendrier attribue à chaque jour une couleur spécifique indiquant les conditions de circulation attendues :
- Vert 🟢 : La circulation est normale, à l’exception des heures de pointe en agglomération.
- Orange 🟠 : Le trafic est dense, et les conditions de circulation sont globalement ou localement difficiles.
- Rouge 🔴 : Le trafic est très dense, et les conditions de circulation sont très difficiles.
- Noir ⚫ : Le trafic est extrêmement dense, et les conditions de circulation sont exceptionnellement difficiles sur l’ensemble du réseau.
Information en temps réel : La diffusion de l’information en temps réel vers le grand public repose principalement sur deux supports numériques majeurs :
- L’Audiotex, un serveur vocal, est disponible depuis 1996. Il permet d’obtenir la situation générale du trafic ainsi que des informations régionales détaillées.
- Le site Internet de Bison futé (www.bison-fute.gouv.fr) a été créé en 1997. Sa forme actuelle a été mise en ligne en 2006, et une nouvelle version, développée par la société Capgemini, a été déployée le 21 novembre 2013, disponible à la fois sur PC et sur mobile. Pour les systèmes informatiques, un site dédié à la diffusion numérique de l’information routière offre un accès en temps réel à la situation routière.
L’Organisation des Centres d’Information Routière 🏛️
L’efficacité des Centres d’Information Routière (CIR) reposait sur une organisation structurée et une direction collégiale, garantissant une approche coordonnée de la gestion du trafic et de la sécurité routière.
La Direction et la Gestion 🤝
La direction des CIR était assurée de manière collégiale. À tous les niveaux, qu’il s’agisse du niveau national (CNIR) ou régional (CRICR), les ministères chargés de la gestion du trafic et de la sécurité routière étaient représentés.
Un Comité de direction se réunissait une fois par an. Son rôle était de fixer les orientations stratégiques et de statuer sur l’organisation générale des CIR. Il était composé de figures clés de l’État : le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le Directeur général de la Police nationale et le Directeur de la sécurité et de la circulation routière.
Un Comité de gestion tenait des réunions plus fréquentes, quatre fois par an. Sa mission était de fixer les règles de gestion des CIR. Il était composé de deux représentants de chacune des directions mentionnées ci-dessus, assurant une représentation équilibrée des différentes administrations.
Chaque centre, qu’il soit national ou régional, était divisé en trois divisions distinctes : Gendarmerie, Police et Transports. Les décisions étaient prises à l’unanimité des trois chefs de division, qui assuraient chacun à tour de rôle, par roulement hebdomadaire, la permanence de la direction du centre. Cette structure garantissait une coordination inter-services constante et une prise de décision concertée.
Les Zones de Compétence 🌐
La répartition des compétences entre le CNIR et les CRICR était clairement définie pour optimiser la couverture et la réactivité de l’information routière.
Le CNIR exerçait sa compétence sur l’ensemble du réseau d’intérêt national. Plus spécifiquement, son action ciblait le réseau défini dans le cadre du Schéma directeur d’information routière (SDIR), mis en place en l’an 2000, qui correspond au Réseau routier national tel que défini par le décret du 5 décembre 2005.
Les CRICR, quant à eux, avaient compétence sur tout le territoire couvrant une zone de défense et de sécurité. Leur rôle incluait également le développement d’échanges d’informations avec les pays et provinces frontalières, facilitant la coordination transfrontalière du trafic. Un décret du 16 janvier 2002, relatif aux pouvoirs des préfets de zone, plaçait les CRICR sous l’autorité de ces préfets. Cela leur permettait d’élaborer ou de participer à l’élaboration des plans de gestion du trafic (PGT) et d’assurer, en temps de crise, la coordination des mesures d’information.
Les Missions Essentielles 🎯
Un protocole d’accord daté du 4 novembre 1998 a formellement défini les missions fondamentales des centres d’information routière. Les CIR avaient trois missions essentielles :
- L’information prévisionnelle et en temps réel des usagers de la route : L’objectif principal était d’améliorer leur sécurité et leurs conditions de voyage.
- La préparation et la coordination des mesures d’exploitation routière et des plans de gestion du trafic : Cela incluait l’anticipation et la mise en œuvre de stratégies pour fluidifier le trafic.
- Le renseignement et le conseil des autorités : Il s’agissait d’apporter un soutien informé aux autorités chargées de l’anticipation ou de la gestion des crises ayant une incidence sur la circulation et la sécurité routières.
Pour mener à bien ces missions cruciales, les centres d’Information routière suivaient un processus rigoureux : ils recueillaient, traitaient, validaient et diffusaient l’information. Le rôle du Centre national d’information routière (CNIR) était particulièrement central dans ce dispositif. Il était chargé d’animer, de coordonner et de contrôler l’activité des sept Centres régionaux d’information et de coordination routières (CRICR). Le CNIR veillait également à la cohérence et à l’homogénéité de l’information diffusée à l’échelle nationale. Enfin, il participait activement à la préparation des opérations nationales d’exploitation et de sécurité routières.
Le Processus de l’Information Routière : De la Prévision à la Diffusion 🔄
L’information routière est un cycle continu de planification, de collecte de données et de diffusion rapide, essentiel pour la fluidité et la sécurité du réseau.
L’Élaboration des Prévisions 📊
Les prévisions de trafic élaborées par les centres d’information routière ne servaient pas uniquement à informer les usagers. Elles étaient également un outil essentiel pour préparer des actions d’exploitation routière, arrêter les dispositions réglementaires nécessaires et mobiliser le personnel des services gestionnaires de voirie et des services de police de la circulation. Parmi les actions planifiées grâce à ces prévisions figuraient :
- Le calendrier des jours hors chantiers : Pour éviter que des travaux routiers de longue durée ne perturbent la circulation lors des grandes migrations, certaines journées étaient classées « sans chantier ». Les responsables devaient alors, dans la mesure du possible, libérer les voies de circulation.
- La participation à l’élaboration des plans de gestion de trafic (PGT) et la coordination des mesures prises sous l’autorité du préfet de zone : Cela incluait des plans spécifiques comme le plan Palomar (déjà mentionné pour sa gestion des flux sur l’axe Paris-Lyon-Marseille), les plans neige, et les plans intempéries. L’objectif principal de ces plans était d’améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers en organisant une meilleure répartition des flux de circulation automobile, par exemple en mettant en place des itinéraires de délestage ou en organisant le stationnement des poids lourds.
- Les restrictions complémentaires de circulation des poids lourds.
- L’interdiction de transport de marchandises dangereuses en périodes sensibles.
- L’interdiction du transport d’enfants par autocars les journées noires.
- La planification des journées « primevères » : Ces journées voyaient un renforcement des forces de l’ordre sur les routes, notamment pour la prévention et le contrôle.
Le Recueil du Renseignement en Temps Réel 📡
La collecte des données relatives aux événements ayant une incidence sur la circulation était une tâche continue et complexe. Ces renseignements étaient principalement recueillis sur le terrain par les forces de l’ordre (Gendarmerie, Police) et les exploitants routiers. Les informations collectées couvraient un large éventail de situations :
- Les flux de circulation (densité, vitesse)
- Les bouchons et les ralentissements
- Les coupures d’axes et les déviations
- Les manifestations et événements publics ayant un impact sur la route
- Les accidents de la circulation
- Les conditions météorologiques (neige, verglas, brouillard, pluie intense)
- Les chantiers en cours
Ces renseignements étaient obtenus par différentes sources :
- Directement : Via les canaux internes de la Gendarmerie, de la Police et des Transports.
- Auprès de partenaires : Incluant les sociétés d’autoroutes, les Conseils départementaux, les acteurs du tourisme, Météo France et les services de secours.
- Parfois même auprès d’usagers : Grâce à leurs signalements.
Un nouveau système d’information, appelé Tipi, développé par le ministère de l’écologie, visait à regrouper progressivement l’ensemble de ces informations, centralisant ainsi les données pour une meilleure efficacité.
La Diffusion de l’Information 📢
Une fois recueillies, traitées et validées, les informations étaient transmises à un large éventail de destinataires :
- Les autorités compétentes.
- Les professionnels de la route (transporteurs, logisticiens).
- Les médias (radio, télévision, presse).
- Les opérateurs privés (GPS, applications de navigation).
- Les usagers de la route, cible finale de cette information.
En plus du site internet et du serveur vocal mentionnés précédemment, les informations validées et diffusées par les CRICR et le CNIR prenaient diverses formes :
- Au moins trois bulletins d’information quotidiens : Ces bulletins comprenaient une description de l’état du trafic, des accidents et des perturbations en cours, ainsi qu’une section sur les difficultés prévisibles à court terme.
- Une synthèse des événements routiers à J+1 : Fournissant une rétrospective et des perspectives pour le lendemain.
- Des communiqués événementiels : Actualisés en temps réel pour des incidents spécifiques et urgents.
La visibilité de l’information routière était parfois renforcée par des initiatives médiatiques, comme l’émission « Ils font bouger la France » présentée par Béatrice Schönberg, qui a été diffusée en direct depuis la salle d’exploitation du CNIR le 20 mai 2009, offrant au grand public un aperçu du travail quotidien du centre.
L’Architecture : Du Siège à la Réhabilitation Urbaine 🏗️
Au-delà de ses missions opérationnelles, le siège du CNIR à Rosny-sous-Bois est également le témoin d’une histoire architecturale et urbaine.
Conception Initiale 📏
Le bâtiment qui abritait le siège du CNIR à Rosny-sous-Bois a été construit en 1986. Sa conception a été l’œuvre des architectes Gilbert Delecourt et Ludwik Peretz. Ce bâtiment était spécialement conçu pour abriter les complexes infrastructures et équipes nécessaires au recueil et au traitement de l’information routière nationale.
Abandon et Réhabilitation 🏙️➡️🏡
Après la dissolution du CNIR en 2016, le bâtiment a été malheureusement laissé à l’abandon. Cependant, en 2020, une nouvelle page s’est ouverte pour ce site. La ville de Rosny-sous-Bois et le bailleur social Batigère ont retenu le site pour un ambitieux projet de réhabilitation en logement social.
En 2022, la pertinence et la qualité de ce projet ont été reconnues au niveau national. Il a été confirmé que la réhabilitation de l’ancien siège du CNIR ferait partie des 97 projets retenus du programme « Engagés pour la qualité du logement de demain », une initiative lancée conjointement par le ministère de la Culture et le ministère de l’Écologie. L’appel à manifestation d’intérêt pour ce projet a été remporté par l’atelier d’architecture Canal Architecture, connu pour ses approches innovantes.
Le projet de réhabilitation est d’envergure. Il comprend la construction d’une extension en béton du côté du fort de Rosny, ainsi que l’ajout d’étages supplémentaires en bois préfabriqué. Ces ajouts permettront d’augmenter la superficie totale du bâtiment, passant de 2 500 m² à 2 700 m².
Cette initiative de réhabilitation s’inscrit dans un cadre urbain plus large et socialement significatif : le démantèlement du foyer de travailleurs migrants (FTM) de Rosny-sous-Bois. Ce foyer, construit en 1978 et géré par Coallia, est situé en face de l’ancien siège du CNIR. Les 310 chambres du FTM seront réparties entre une nouvelle résidence sociale construite sur le même terrain que l’ancien FTM (qui accueillera 170 logements) et l’ancien siège du CNIR, qui sera transformé pour offrir 169 logements. Cette nouvelle résidence sera nommée « résidence Ludwik Peretz », en hommage à l’un des architectes originaux du bâtiment.
Le chantier a débuté en 2024, et la livraison du bâtiment réhabilité est prévue pour 2025, marquant une nouvelle vie pour ce site historique de l’information routière française.
En somme, l’histoire du CNIR est celle d’une réponse organisée et innovante aux défis posés par la démocratisation de l’automobile en France. De ses origines modestes avec le « PC avancé » de Fontainebleau à l’institution nationale qu’il est devenu, en passant par la création de l’icône Bison futé, le CNIR a joué un rôle majeur dans l’information des usagers et la gestion du réseau routier. Sa disparition en 2016 ne marque pas la fin de ses missions, mais leur continuation sous de nouvelles formes, adaptées aux exigences contemporaines de la mobilité et de la technologie.
Voici la chronologie détaillée des événements principaux et la liste des personnages principaux mentionnés dans les sources :
Chronologie Détaillée
Années 1950
- Début des années 1950 : Augmentation de l’équipement automobile des foyers français et apparition des premiers embouteillages récurrents, notamment les dimanches soirs au retour des week-ends.
- 1950 : Création de l’émission radio « Route de nuit » sur Paris Inter, marquant les débuts de l’information routière radiophonique.
- 1951 : Création du premier « PC Inter Route » par Radio France.
Années 1950-1960
- 1953 : Début de la construction de l’autoroute A6.
- 1958 : Partenariat entre France Inter et la Gendarmerie pour la diffusion de « points routes » basés sur les informations de la Gendarmerie, diffusés depuis le carrefour de l’obélisque en forêt de Fontainebleau.
- 1960 :L’autoroute A6 est ouverte jusqu’au Coudray-Montceau.
- Mise en place d’un « PC avancé » dans une remorque de commandement au carrefour de l’obélisque, premier dispositif structuré d’information, d’aide et de secours aux usagers.
- Premières surveillances aériennes du trafic.
Années 1960
- 1966 : Généralisation du dispositif d’information routière à l’ensemble du territoire et création du Centre d’information routière de la Gendarmerie au Fort de Rosny-sous-Bois (connu sous le nom de « PC de Rosny »).
- 1967 : La France compte 1 000 km d’autoroutes.
- 1968 : Création du Centre national d’information routière (CNIR), organisme interministériel regroupant les ministères de la Défense, de l’Intérieur et de l’Écologie, mutualisant les moyens pour l’information routière.
Années 1970
- Entre 1971 et 1980 : Création de sept Centres régionaux d’information et de coordination routières (CRICR) à Créteil, Lille, Metz, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes.
- Samedi 2 août 1975 : « Embouteillage du 2 août 1975 » – Journée caniculaire avec 600 km de bouchons cumulés et 145 décès, suscitant une forte pression sur les pouvoirs publics.
- 1976 : Lancement de l’opération « Bison futé » suite à l’embouteillage de 1975. Publication de 600 000 cartes décrivant 3 500 km d’itinéraires bis et aménagement de 18 aires d’accueil. L’opération réduit les encombrements de 30% par rapport à l’année précédente et est pérennisée.
- 1978 : Construction du foyer de travailleurs migrants (FTM) de Rosny-sous-Bois en face de l’emplacement futur du CNIR.
Années 1980
- 1981 : La France compte 5 000 km d’autoroutes.
- 1983 : Bison futé commence à publier un calendrier prévisionnel des conditions de circulation (vert, orange, rouge, noir).
- 1985-1991 : Utilisation du système Antiope (précurseur du télétexte) pour la diffusion d’informations quotidiennes.
- 1986 :Mise en service du service « 36 15 ROUTE » sur le Minitel.
- Construction du siège du CNIR à Rosny-sous-Bois par les architectes Gilbert Delecourt et Ludwik Peretz.
Années 1990
- 1996 : Mise en place de l’Audiotex (serveur vocal) pour la diffusion d’informations routières en temps réel.
- 1997 : Création du site Internet de Bison futé (www.bison-fute.gouv.fr).
- 4 novembre 1998 : Signature d’un protocole d’accord définissant les missions des CIR (information, préparation et coordination des mesures d’exploitation, conseil aux autorités).
Années 2000
- 2000 : Mise en place du Schéma directeur d’information routière (SDIR).
- 16 janvier 2002 : Décret plaçant les CRICR sous l’autorité des préfets de zone pour l’élaboration et la coordination des plans de gestion du trafic en temps de crise.
- 2003 : Dernière édition de la carte papier Bison futé, en raison du renforcement du maillage autoroutier et de l’obsolescence des itinéraires Bis en tant qu’alternatives touristiques.
- 5 décembre 2005 : Décret définissant le Réseau routier national, auquel s’identifie le réseau de compétence du CNIR.
- 2006 : Mise en ligne de la forme actuelle du site Internet de Bison futé.
- 2009 : La France compte presque 11 000 km d’autoroutes.
- 20 mai 2009 : L’émission télévisée « Ils font bouger la France » est diffusée en direct depuis la salle d’exploitation du CNIR.
Années 2010
- 21 novembre 2013 : Lancement d’une nouvelle version du site Internet de Bison futé (PC et mobile), développée par Capgemini.
- 1er mai 2016 : Dissolution du CNIR et des sept CRICR. Leurs missions sont reprises par la sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé (GRT) au sein de la DGITM du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) pour le CNIR, et par les Directions interdépartementales des routes (DIR) pour les CRICR.
- Après la dissolution en 2016 : Le bâtiment du CNIR à Rosny-sous-Bois est laissé à l’abandon.
Années 2020
- 2020 : Le site de l’ancien CNIR est retenu par la ville et Batigère pour être réhabilité en logement social.
- 2022 : Confirmation du projet de réhabilitation de l’ancien siège du CNIR dans le cadre du programme « Engagés pour la qualité du logement de demain ». L’appel à manifestation d’intérêt est remporté par l’atelier d’architecture Canal Architecture.
- 2024 : Début des travaux de réhabilitation de l’ancien siège du CNIR.
Années 2020 (Prévisions)
- 2025 : Livraison prévue de la nouvelle résidence sociale, nommée « résidence Ludwik Peretz », incluant des logements dans l’ancien siège du CNIR et une nouvelle construction.
Personnages Clés
- Jean Poulit : Ingénieur béarnais à l’origine de l’idée de créer un personnage pour la campagne d’information routière, qui deviendra Bison futé.
- Daniel Robert : Publicitaire qui a concrétisé l’idée de Jean Poulit en créant le personnage emblématique de « Bison futé ».
- Gilbert Delecourt : Architecte, co-concepteur du siège du CNIR à Rosny-sous-Bois, construit en 1986.
- Ludwik Peretz : Architecte, co-concepteur du siège du CNIR à Rosny-sous-Bois, construit en 1986. La future résidence sociale réhabilitée sur le site portera son nom.
- Béatrice Schönberg : Présentatrice de l’émission « Ils font bouger la France » diffusée en direct depuis la salle d’exploitation du CNIR le 20 mai 2009.
- Directeur général de la Gendarmerie nationale : Membre du Comité de direction du CNIR, chargé de fixer les orientations et l’organisation des CIR.
- Directeur général de la Police nationale : Membre du Comité de direction du CNIR, chargé de fixer les orientations et l’organisation des CIR.
- Directeur de la sécurité et de la circulation routière : Membre du Comité de direction du CNIR, chargé de fixer les orientations et l’organisation des CIR.
- Préfets de zone : Autorités sous l’autorité desquelles les CRICR sont placés depuis 2002 pour élaborer ou participer à l’élaboration des plans de gestion du trafic et coordonner les mesures d’information en temps de crise.