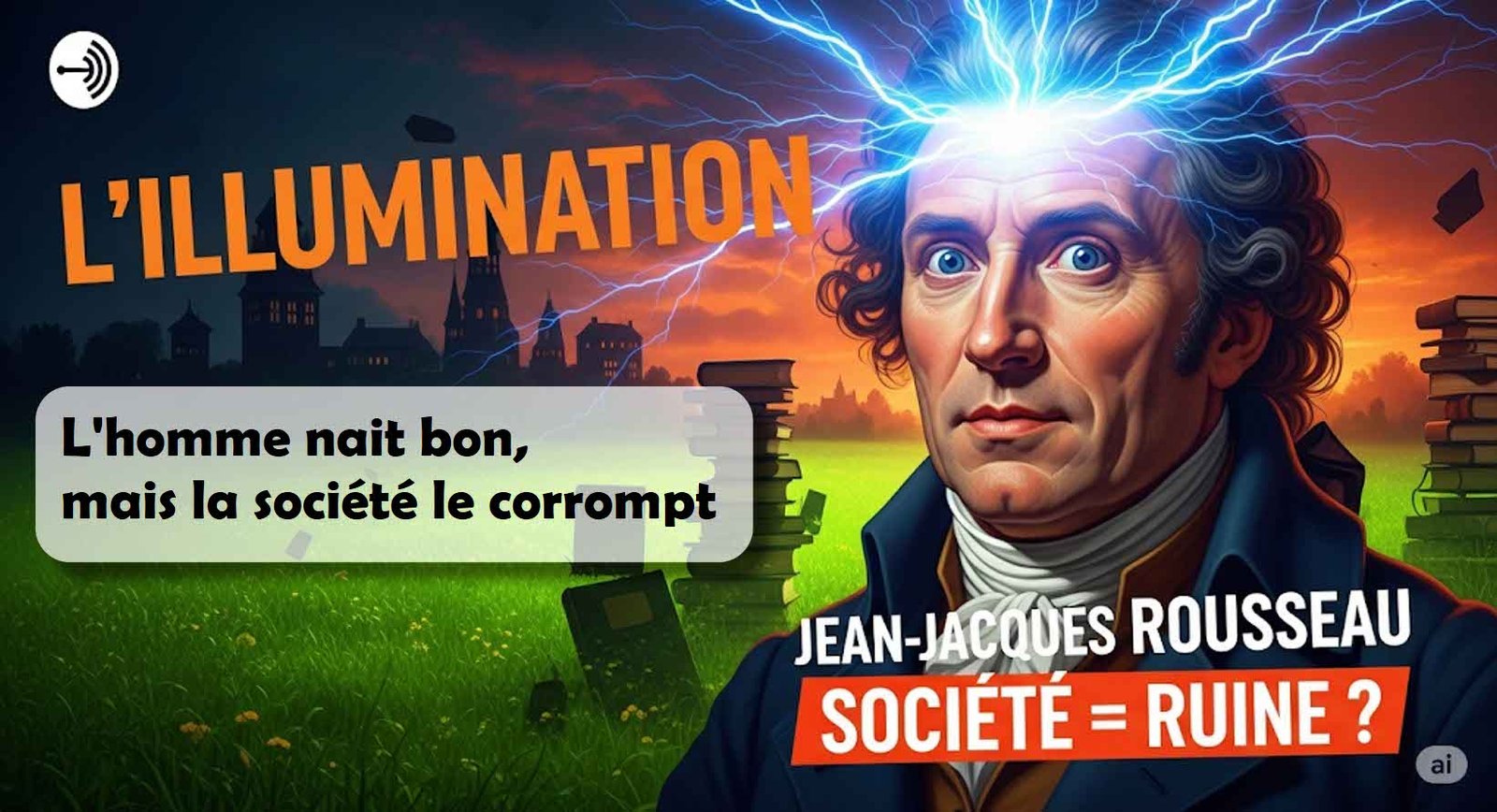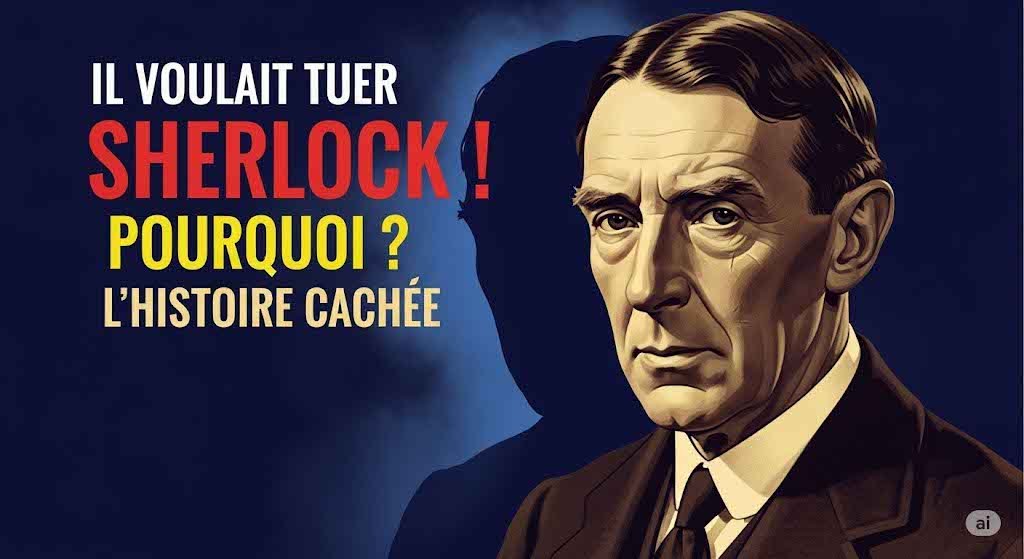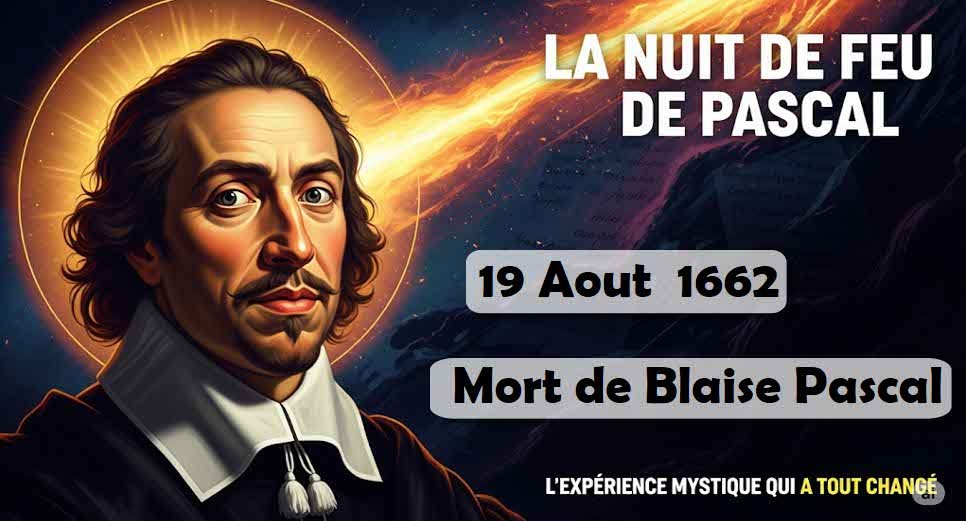George Orwell : Une Vie Engagée et une Œuvre Visionnaire ✍️📚
George Orwell, pseudonyme célèbre d’Eric Arthur Blair ([dʒɔː(ɹ)dʒ ˈɔːwel]), fut un écrivain, essayiste et journaliste britannique dont la vie et l’œuvre ont profondément marqué le XXe siècle et continuent de résonner dans les débats contemporains. Né le 25 juin 1903 à Motihari, en Inde, alors sous le Raj britannique, et décédé le 21 janvier 1950 à Londres, Orwell a puisé dans ses expériences personnelles la matière de ses engagements contre l’impérialisme, pour la justice sociale, et contre les totalitarismes. Son regard acéré sur les systèmes de pouvoir et sa défense intransigeante de la vérité et de la liberté d’expression ont fait de lui une figure incontournable de la littérature et de la pensée politique.
Biographie : Le Parcours d’un Observateur Engagé 🌍📖
La vie d’Eric Arthur Blair, plus connu sous le nom de George Orwell, fut un voyage jalonné d’expériences hétéroclites qui forgèrent ses convictions et son style littéraire inimitable. De son enfance coloniale à ses engagements politiques, chaque étape de son existence a nourri son œuvre, la rendant profondément ancrée dans la réalité de son époque.
Une Éducation Anglaise sous le Raj 🎒👨🎓
George Orwell naît à Motihari, dans l’actuel État du Bihar, en Inde, le 25 juin 1903, au sein d’une famille de la moyenne bourgeoisie britannique. Son père, Richard Wellesley Blair, était un fonctionnaire de l’administration des Indes, en charge de la Régie de l’opium, un monopole d’État à l’époque, orienté principalement vers le commerce avec la Chine. Sa mère, Ida Mabel Blair (née Limouzin), était née en Angleterre mais avait vécu en Birmanie, où son propre père, Francis Limouzin, un Français originaire de Bordeaux, avait prospéré dans le négoce de bois. Orwell avait deux sœurs, Marjorie (l’aînée) et Avril (la cadette).
Il arrive en Grande-Bretagne en 1904, accompagné de sa mère et de sa sœur. Il ne reverra son père qu’en 1907, lors d’une permission, et ce dernier ne rejoindra définitivement la famille qu’en 1911, après sa retraite.
Dès son plus jeune âge, Eric Blair devient pensionnaire à la preparatory school St Cyprian à Eastbourne, dans l’East Sussex. Cette période lui inspirera bien plus tard, dans les années 1946-1947, un récit autobiographique publié à titre posthume, intitulé Such, Such Were the Joys (Tels, tels étaient nos plaisirs). Dans cet ouvrage, il décrira ces années d’internat comme un « épouvantable cauchemar ». Malgré cela, le jeune Eric se distingue par son excellence scolaire : il est un élève brillant et travailleur, perçu par ses camarades comme un « intellectuel ». Ses maîtres le motivent en lui rappelant constamment qu’il doit son admission à St Cyprian à une bourse.
Signe de son brio académique, Blair obtient une bourse pour l’illustre collège d’Eton, la plus réputée des public schools. Il y étudie de 1917 à 1921. C’est là qu’il a notamment pour professeur de français Aldous Huxley, le futur auteur du Meilleur des mondes. Les sources rapportent qu’Orwell appréciait Huxley, qui enseignait des « mots rares et étranges, de manière assez concertée ». Cependant, Huxley était également perçu comme « un professeur d’une totale incompétence », incapable de faire respecter la discipline en raison de sa myopie et de sa difficulté à percevoir ce qui se passait en classe, ce qui le rendait constamment chahuté. Orwell trouvait cela « cruel » et en était passablement énervé. Malgré les difficultés de Huxley à maintenir l’ordre, ses cours n’étaient pas vains : ils laissèrent aux jeunes gens « le goût des mots, de leur usage précis et signifiant », une dette que Steven Runciman, ami et condisciple d’Orwell à l’époque, reconnaît.
Pendant ses années à Eton, Orwell conserve un assez bon souvenir de son séjour, malgré le fait qu’il travaille peu, passant d’élève brillant à médiocre. Il fait montre d’un tempérament volontiers rebelle, bien que cette rébellion ne semble pas, à l’époque, liée à des revendications politiques ou idéologiques. Le jeune Blair nourrit alors deux grandes ambitions : devenir un écrivain célèbre (il écrit déjà des nouvelles et des poèmes, qualifiés de « banals », dans une revue du collège) et retourner en Orient, qu’il connaît surtout par les souvenirs de sa mère.
Au Service de l’Empire, puis le Dégoût 👮♂️🇵🇬
La prospérité relative de la famille Blair est intrinsèquement liée à l’impérialisme britannique. Outre son père, d’autres membres de sa famille ont tiré parti de ce système : Charles Blair, l’arrière-grand-père paternel du futur George Orwell, était propriétaire d’esclaves en Jamaïque, et son grand-père maternel était marchand de teck en Birmanie. C’est donc presque naturellement, bien que cela représente une conclusion peu glorieuse à une scolarité dans des établissements si prestigieux, qu’Eric Blair enfile l’uniforme en 1922 et retourne aux Indes pour devenir sergent dans la police impériale en Birmanie.
La situation sur place est alors tendue, voire explosive, entre les Birmans et leurs colonisateurs. Le nationalisme birman est en plein essor, marqué par des mouvements de grève fréquemment réprimés avec violence. La mission des Britanniques, selon un ancien gouverneur adjoint de Birmanie, est de « faire régner la loi et l’ordre dans des régions barbares ».
Orwell décrira plus tard ses cinq années de service comme ayant consisté en « cinq années d’ennui au son des clairons ». Après neuf mois à l’école d’entraînement de la police, il connaît six affectations différentes, souvent dans des lieux peu attrayants, comme Moulmein. Il y laisse l’image d’un jeune homme grand, taciturne et solitaire, occupant la majeure partie de son temps libre à la lecture. Une anecdote notable de cette période est sa présence à une exécution capitale, qui lui inspirera l’essai Une pendaison. Cet essai est considéré comme « son premier écrit qui témoigne d’un style distinctif et du talent d’Orwell ».
Le détail de son évolution intérieure, le faisant passer de l’ennui au dégoût pour sa fonction de rouage de l’administration coloniale, n’est pas connu avec certitude. Cependant, il est probable que les propos de Flory, l’anti-héros d’Une histoire birmane, reflètent fidèlement ce que pensait le fonctionnaire de police Eric Blair vers 1927 : « Le fonctionnaire maintient le Birman à terre pendant que l’homme d’affaires lui fait les poches ». Quoi qu’il en soit, à la fin de l’année 1927, il jette l’éponge, invoquant des raisons de santé inconnues, et rentre en Angleterre pour donner sa démission. Il annonce alors à sa famille sa décision de se consacrer à l’écriture. Pendant les vingt-deux années qui lui restent à vivre, il demeurera un ennemi déclaré de l’impérialisme britannique.
Des Débuts d’Écrivain Difficiles et l’Immersion dans la Misère struggling writer ✍️ impoverished
Eric Blair ne semblait pas avoir de dons particuliers pour l’écriture au début, selon les témoignages de ceux qu’il fréquentait à l’époque. Il travaille donc acharnement, écrivant des poèmes, quelques nouvelles, et multipliant les ébauches de romans.
En parallèle, à l’automne 1927, il entreprend d’explorer les bas-fonds londoniens, menant une enquête sur les conditions de vie des plus démunis. Il les suit sur les routes et dans les sinistres asiles de nuit, espérant tirer de cette expérience la matière d’un ouvrage sur la pauvreté. Son objectif est également d’exorciser la culpabilité qui le ronge d’avoir « été l’exécutant d’un système d’exploitation et d’oppression » en Birmanie.
Au printemps 1928, il s’installe à Paris, où vit l’une de ses tantes, dans le but d’écrire. Il y reste dix-huit mois, une période dont on sait peu de choses, si ce n’est qu’à l’automne 1929, à court d’argent, il donne quelques leçons d’anglais avant de travailler comme plongeur pendant quelques semaines dans un hôtel de luxe de la rue de Rivoli. Durant ce séjour parisien, il publie épisodiquement des articles dans des journaux communistes, comme Monde, une revue fondée et dirigée par Henri Barbusse. Ce sont ses premiers textes publiés, directement en français et signés Eric Blair (le pseudonyme George Orwell n’apparaîtra qu’en 1933). Le tout premier de ces articles s’intitule « La censure en Angleterre ». Il retourne en Angleterre en décembre 1929, juste à temps pour Noël, sans argent, sans avoir rien publié de prometteur, et avec une santé affaiblie par une pneumonie contractée l’hiver précédent, ce qui fait de son « équipée parisienne » un « fiasco intégral ».
Au printemps suivant, il reprend son exploration des bas-fonds de la société britannique, partageant la vie des vagabonds et des clochards, tantôt quelques jours, tantôt une semaine ou deux. Cependant, il est contraint d’interrompre ces expéditions quelques mois plus tard, n’ayant plus les moyens financiers de poursuivre ses errances.
Il se résout alors à accepter un poste d’enseignant dans une école privée à Hayes, une petite ville du Middlesex où il s’ennuie. Il profite de cette opportunité pour achever Dans la dèche à Paris et à Londres, qui paraît au début de l’année 1933. C’est à cette occasion qu’il adopte le célèbre pseudonyme de George Orwell. Bien que les critiques soient bonnes, les ventes sont médiocres. De plus, son éditeur, Victor Gollancz, craint un procès en diffamation pour Une histoire birmane, dont la rédaction est achevée à l’automne 1934. Pour cette raison, l’ouvrage est d’abord publié aux États-Unis, puis, avec quelques changements de noms, en Angleterre en 1935. Durant cette période, Orwell s’enthousiasme pour l’Ulysse de James Joyce et contracte une nouvelle pneumonie, qui l’oblige à abandonner son poste d’enseignant (ou, plutôt, l’en libère).
À la fin de l’automne 1934, il achève avec difficulté la rédaction de son deuxième roman, Une fille de pasteur, dont il est peu satisfait, confiant à un correspondant : « C’était une bonne idée, mais je crains de l’avoir complètement gâchée ». Là encore, la précision des références à des lieux et personnages réels fait craindre à Victor Gollancz des poursuites pour diffamation. Il décide néanmoins de le publier, après des corrections mineures, au début de l’année 1935.
La « Conversion » au Socialisme et l’Engagement en Espagne ✊🇪🇸
Entre-temps, Orwell s’installe à Londres et trouve un emploi à la librairie Booklover’s Corner, dans le quartier de Hampstead, « qui était, et demeure, un quartier d’intellectuels (réels ou prétendus) ». Il y rencontre Eileen O’Shaughnessy, qu’il épouse en juin 1936. Avant cela, il publie un autre roman, Et vive l’Aspidistra !, que Bernard Crick décrit comme « le dernier de ses livres consciemment “littéraires” ».
Dans le cadre d’une commande de son éditeur Victor Gollancz, Orwell se rend dans le nord de l’Angleterre pour étudier les conditions de vie des mineurs des régions industrielles. Ce reportage donnera naissance au livre Le Quai de Wigan, qui sera publié alors qu’il est en Espagne. La seconde partie de cet ouvrage est très polémique, car l’auteur y analyse les raisons de l’échec de la gauche à gagner les classes laborieuses à la cause socialiste. Sa publication s’accompagne d’une mise au point hostile de Victor Gollancz, l’initiateur du projet, qui se désolidarise de son aboutissement.
Cette rencontre avec le prolétariat des régions minières marque surtout la « conversion » d’Orwell à la cause socialiste. Cette prise de conscience survient brutalement, comme une évidence, face au spectacle de l’injustice sociale et de la misère du prolétariat anglais.
Courant 1936, alors que la guerre d’Espagne fait rage, opposant les républicains à la tentative de coup d’État militaire de Francisco Franco, Orwell décide de se rendre en Espagne pour écrire des articles, mais aussi pour se battre. Orwell et son épouse quittent Londres le 22 septembre 1936. Ils s’arrêtent une journée à Paris, où Orwell rend visite à Henry Miller, qui tente en vain de le dissuader de son projet. Ils prennent ensuite le train pour Portbou, à la frontière espagnole, et arrivent à Barcelone le 26 décembre 1936. Grâce à des lettres de recommandation du Parti travailliste indépendant (Independent Labour Party, ILP), ils rejoignent les milices du Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM).
À son arrivée à Barcelone, Orwell est fasciné par l’atmosphère qu’il y découvre. Lui qui, l’année précédente, se désolait de ne pas pouvoir briser la barrière de classe le séparant des prolétaires qu’il était allé rencontrer, voit une société où cette barrière semble s’effondrer. Les milices du POUM, en particulier, dans lesquelles il est nommé instructeur grâce à son expérience birmane, lui apparaissent comme « une sorte de microcosme de société sans classes ». Son épouse Eileen travaille également au POUM avec les militants américains Charles et Lois Orr.
Après avoir passé quelque temps sur le front d’Aragon, Orwell retourne à Barcelone et participe aux « troubles de mai », un conflit qui oppose les forces révolutionnaires au gouvernement catalan et au Parti socialiste unifié de Catalogne (PSUC), et qui verra la victoire de ces derniers. Il retourne au front, où il est blessé par balle à la gorge. Démobilisé et contraint de quitter clandestinement l’Espagne pour éviter d’être arrêté (le POUM, dénoncé comme un « parti fasciste » par la propagande du PSUC, est déclaré illégal le 16 juin 1937), Orwell et son épouse gagnent la France en juin 1937, via Perpignan. Orwell y retrouve Fenner Brockway, le secrétaire général du Parti travailliste indépendant, avec qui il discute toute la nuit. Alors que Brockway se rend à Barcelone le lendemain, Orwell part se reposer trois jours à Banyuls-sur-Mer, où il commence la rédaction d’un article pour un journal anglais intitulé « Les pieds dans le plat espagnol ».
À son retour à Londres début juillet, Orwell est atterré par la manière dont les intellectuels de gauche, en particulier ceux proches du parti communiste, rendent compte des événements en Espagne, notamment les calomnies propagées sur le compte du POUM, systématiquement accusé d’être une organisation fasciste ou manipulée par les fascistes. C’est dans l’intention de rétablir la vérité sur les événements dont il a été témoin qu’il écrit un article pour le mensuel du Parti travailliste indépendant (traduit en septembre 1937 en français dans la revue La Révolution prolétarienne), puis qu’il entreprend la rédaction de son célèbre Hommage à la Catalogne, qu’il publie, malgré quelques difficultés, en avril 1938. À partir de ce moment, il écrira en 1946, « tout ce [qu’il] a écrit de sérieux […] a été écrit, directement ou indirectement, et jusque dans la moindre ligne, contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique ». Dans cette perspective, il adhère au Parti travailliste indépendant (ILP) en juin 1938, estimant que « le seul régime qui, à long terme, peut accorder la liberté de parole est un régime socialiste ».
Le Patriotisme Révolutionnaire et l’Engagement Anti-Totalitaire 🇬🇧⚔️
Alors que la menace d’un nouveau conflit européen se précise, Orwell défend initialement une position antiguerre et critique l’insuffisance de l’antifascisme des fronts populaires. Selon lui, cette guerre ne ferait que renforcer les impérialismes européens qui, face à la menace fasciste, se présentent comme des démocraties, alors qu’ils exploitent sans scrupule « six cents millions d’êtres humains privés de tous droits ».
Cependant, quelques mois plus tard, il change radicalement de position. Tandis que le parti communiste, qui appelait auparavant à la lutte contre les dictatures fascistes, se découvre pacifiste à la suite du Pacte germano-soviétique, Orwell prend conscience qu’il a toujours été, au fond, un patriote. Il établit une distinction entre le patriotisme et le nationalisme, et oppose le premier au conservatisme. De ce fait, il s’éloigne « sur la pointe des pieds » de l’ILP, qui persiste dans le pacifisme et s’oppose à l’engagement dans le conflit.
Malgré son désir de s’engager dans l’armée, sa faible santé le fait réformer. Malgré cela, il s’engage en 1940 dans la Home Guard, une milice de volontaires organisée par l’État pour résister à l’invasion nazie si les Allemands parvenaient à débarquer en Grande-Bretagne. Par ailleurs, en 1941, il est engagé comme producteur à la BBC, où il diffuse des émissions culturelles et des commentaires de guerre à destination des Indes. Une statue de George Orwell, inaugurée en 2017 par Martin Jennings, est érigée devant le siège de la BBC à Londres. Sur le mur derrière l’écrivain, une inscription cite son avant-propos de La Ferme des animaux (1945) : « Si la liberté a un sens, elle signifie le droit de dire aux autres ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre ».
Parallèlement à ces activités, Orwell envoie, entre 1941 et 1946, seize articles, les « Lettres de Londres », à la revue américaine d’inspiration trotskiste Partisan Review. Son patriotisme depuis le début de la guerre ne lui a pas fait abandonner ses aspirations révolutionnaires, bien au contraire. Il estime que la victoire du Royaume-Uni sur les dictatures fascistes passera nécessairement par une révolution sociale en Grande-Bretagne. Il en perçoit les signes avant-coureurs dans le mécontentement croissant des classes populaires face aux privations dues à l’état de guerre (qui n’affectent pas les couches supérieures de la société) et aux revers militaires de l’armée britannique, qu’il attribue à l’incurie des dirigeants militaires et politiques. De ce point de vue, la Home Guard lui apparaît comme ce « peuple en armes » qui renversera, si nécessaire par la force, le pouvoir en place avant de défaire les armées hitlériennes.
Il développe ces points de vue dans son essai intitulé Le Lion et la Licorne, publié en 1941 dans la collection « Searchlight », dont il est le cofondateur. Il y imagine un programme en six points :
- Nationaliser la terre, les mines, les chemins de fer, les banques et les principales industries. La socialisation massive, telle qu’énoncée dans ce premier point, était aux yeux d’Orwell la condition « indispensable » à tout changement important, c’est-à-dire à l’instauration d’une démocratie socialiste et révolutionnaire.
- Instaurer une échelle des revenus de un à dix.
- Réformer l’éducation sur des bases démocratiques.
- Octroyer sur-le-champ le statut de dominion à l’Inde puis lui garantir la pleine et entière indépendance, si elle l’exige, la guerre contre les puissances de l’Axe achevée.
- Créer un Conseil général de l’Empire dans lequel les « peuples de couleur » seraient représentés.
- S’allier avec la Chine, l’Éthiopie et toutes les nations frappées par le fascisme.
Fin 1943, il rappelle dans Tribune que le socialisme n’a d’autre but que de « rendre meilleur » le monde, et rien de plus, d’où la nécessité de « dissocier le socialisme de l’utopie ».
Orwell défend la liberté religieuse tout en se prononçant pour la séparation de l’Église et de l’État. Il est par ailleurs extrêmement critique à l’égard de l’impérialisme et du racisme, affirmant que « L’Empire des Indes est un despotisme […] qui a le vol pour finalité ». En 1940, il rapporte avoir entendu en Inde des « théories raciales » aussi « imbéciles » que celles des nazis. Il établit un parallèle saisissant en déclarant : « Hitler n’est que le spectre de notre propre passé qui s’élève contre nous. Il représente le prolongement et la perpétuation de nos propres méthodes ».
En novembre 1943, Orwell démissionne de son poste à la BBC. Il devient alors directeur des pages littéraires de Tribune, l’hebdomadaire de l’aile gauche du parti travailliste, et commence la rédaction de La Ferme des animaux. Il espère que le combat du peuple britannique contre l’Allemagne nazie débouche sur une révolution.
D’après l’éditeur Thierry Discepolo, Orwell défendait la notion de common decency (« honnêteté commune »). Ce concept, emblématique des valeurs associées à la classe ouvrière (droiture morale, générosité, sens de l’entraide, haine des privilèges, soif d’égalité et attachement à l’idée d’une vérité objective), est pour Orwell hérité du christianisme et de la Révolution française. Si cette « morale sociale et économique » perdure davantage dans le rapport des petites gens à la vie et aux autres, ce n’est pas qu’elle serait innée, mais qu’un certain type de vie en facilite la pérennité et la transmission. Toutes les classes sociales en abritent plus ou moins les valeurs, mais les rapports de domination qui structurent nos sociétés les offensent en permanence. C’est pourquoi, selon Orwell, il est nécessaire de faire la révolution : pour abolir la division en classes qui interdit l’instauration d’un ordre social juste, dont la common decency deviendrait le socle moral commun.
Les Dernières Années : Œuvres Majeures et Fin de Vie 🕊️💔
Orwell achève l’écriture de La Ferme des animaux en février 1944. L’ouvrage ne paraît qu’un an plus tard, en août 1945, après avoir été refusé par quatre éditeurs. La critique radicale de l’URSS qu’il contient semblait en effet prématurée à un moment où la guerre contre l’Allemagne hitlérienne n’était pas terminée.
Toujours en 1945, Orwell, qui a démissionné de son poste au Tribune, devient envoyé spécial de The Observer en France et en Allemagne, où il est chargé de commenter la vie politique. C’est à Cologne, en mars, qu’il apprend le décès de sa femme, Eileen, atteinte d’un cancer. Il rentre à Londres et entame la rédaction de ce qui va devenir son œuvre la plus célèbre : 1984.
En parallèle, à partir d’août 1945, il devient vice-président du Freedom Defence Committee, présidé par le poète anarchiste Herbert Read. Ce comité s’est donné pour tâche de « défendre les libertés fondamentales des individus et des organisations, et [de] venir en aide à ceux qui sont persécutés pour avoir exercé leurs droits à la liberté de s’exprimer, d’écrire et d’agir ». Orwell soutient le comité jusqu’à sa dissolution en 1949.
En 1949, il publie 1984, qu’il a achevé à la fin de l’année précédente sur l’île de Jura, en Écosse. C’est là qu’il s’improvise également fermier, s’entourant d’une vache et de quelques oies, tout en faisant état de ses inquiétudes quant à l’avenir du monde « après cinquante ans d’érosion du sol et de gaspillage des ressources énergétiques de la planète ». C’est dans ce roman qu’il crée le concept de Big Brother, passé depuis dans le langage courant de la critique des techniques modernes de surveillance et de contrôle des individus. L’adjectif « orwellien » est également fréquemment utilisé en référence à l’univers totalitaire imaginé par cet écrivain britannique.
Gravement malade de la tuberculose, il est admis en septembre 1949 à l’University College Hospital de Londres, où il prend des notes en vue d’un futur roman. Il épouse en secondes noces Sonia Brownell le 13 octobre de la même année. Il décède le 21 janvier 1950 à Londres.
Orwell est enterré dans le petit cimetière de l’église de Sutton Courtenay, près d’Abingdon dans l’Oxfordshire, bien qu’il n’ait aucun lien avec ce village. Il avait laissé des instructions claires : « Après ma mort, je ne veux pas être brûlé. Je veux simplement être enterré dans le cimetière le plus proche du lieu de mon décès ». Cependant, son décès ayant eu lieu au centre de Londres et aucun des cimetières londoniens n’ayant assez de place pour l’inhumer, sa veuve, Sonia Brownell, craignant que son corps ne soit incinéré, a demandé à tous ses amis de contacter le prêtre (anglican) de leur village d’origine pour voir si leur église disposerait d’une place dans son cimetière. C’est ainsi qu’il fut, par pur hasard, inhumé à Sutton Courtenay.
Sur sa tombe, figurent ces simples mots : Ci-gît Eric Arthur Blair né le 25 juin 1903 mort le 21 janvier 1950 sans aucune mention de ses œuvres ni de son nom de plume « George Orwell ».
Après sa mort, sa veuve fait publier une collection de ses articles, essais, correspondances et quelques nouvelles sous le titre Collected Essays, Journalism, and Letters (1968).
Postérité et Influence d’Orwell 🌟🏛️
George Orwell, bien que parfois méconnu en France dans les années 1950, a vu son influence grandir de manière exponentielle au fil des décennies, devenant une référence mondiale en matière de critique sociale et politique.
L’Accueil Posthume de son Œuvre 📰📈
Dans les années 1950, la presse française fait peu référence à George Orwell. Son décès ne passe cependant pas inaperçu : outre le journal Le Monde, qui publie un très bref article, le quotidien Combat fait paraître le 26 janvier 1950 un texte favorable, puis Le Libertaire publie deux articles en février saluant à la fois l’écrivain et le militant socialiste. Par la suite, des années 1980 aux années 2000, Orwell est l’objet d’une quarantaine d’essais et est abondamment cité par la presse.
À l’approche de l’année 1984, l’attention médiatique explose : Le Monde écrit autant sur Orwell en 1982-1983 qu’au cours des trente années précédentes. Le rythme des citations diminue par la suite, mais à partir de 1995, il est de nouveau fréquemment cité, et plus que jamais dans les années 2010. En janvier 2008, le Times le classe deuxième dans sa liste des « 50 plus grands écrivains britanniques depuis 1945 ».
Hommages Divers 🏅🌍
L’héritage d’Orwell est célébré à travers le monde par divers hommages :
- Une statue de George Orwell par Martin Jennings (2017) est située devant le siège de la BBC à Londres.
- La Plaça de George Orwell se trouve dans le quartier gothique de Barcelone.
- Des rues portent son nom à Chihuahua (Mexique), Milan (Italie), Barbastro et Palma (Espagne), Woerden, Eindhoven et Arnhem (Pays-Bas).
- Une place à Gérone et des jardins à Lérida sont également nommés en son honneur.
- L’astéroïde (11020) Orwell a été nommé en sa mémoire.
Controverses Posthumes : L’Affaire des « Cryptocommunistes » 🤔🕵️♂️
Une polémique posthume majeure a secoué l’image de George Orwell, survenue en 1996, près d’un demi-siècle après sa mort.
Révélations et Accusations 🗞️🗣️
Le 11 juillet 1996, un article publié dans le quotidien anglais The Guardian révèle qu’en 1949, George Orwell aurait communiqué une liste de noms de journalistes et d’intellectuels « cryptocommunistes », « compagnons de route » ou « sympathisants » de l’Union soviétique à une fonctionnaire de l’Information Research Department (IRD), une section du ministère des Affaires étrangères britannique liée aux services de renseignements, nommée Celia Kirwan. La réalité de cette collaboration est prouvée par un document déclassifié la veille par le Public Record Office.
L’information est relayée en France par Le Monde (12 et 13 juillet 1996) et Libération (15 juillet 1996). Le public français apprend ainsi que l’auteur de 1984 « dénonçait au Foreign Office les “cryptocommunistes” » (Le Monde, 13 juillet 1996). Le magazine L’Histoire, dans son numéro d’octobre 1996, va plus loin en affirmant qu’Orwell aurait « spontanément participé à la chasse aux sorcières » organisée contre les intellectuels communistes par le Foreign Office.
Contexte et Nuances 💬💡
Ces articles français omettent cependant de mentionner plusieurs informations essentielles. Tout d’abord, Celia Kirwan, belle-sœur de l’écrivain Arthur Koestler, était une amie intime d’Orwell, dont elle avait repoussé la demande en mariage en 1945, alors que l’écrivain était veuf depuis quelques mois. Ensuite, la remise des informations a eu lieu lors d’une visite de Kirwan à Orwell, peu avant la mort de ce dernier, alors qu’il était déjà dans un sanatorium. Kirwan lui confie alors qu’elle travaille pour un service gouvernemental chargé de recruter des écrivains et des intellectuels susceptibles de produire de la propagande antisoviétique. Orwell, après lui avoir donné les noms de quelques personnes de sa connaissance lui paraissant aptes à être recrutées, propose de lui indiquer, à titre privé, les noms d’autres personnes qu’il est inutile d’approcher, en raison de leurs convictions politiques (lesquelles sont souvent de notoriété publique).
La fameuse liste, rendue publique en 2003 mais déjà mentionnée dans la biographie de Bernard Crick parue en 1980 (celui-ci ayant simplement consulté la copie disponible dans les Archives Orwell), confirme ce qui précède. Crick signale que « quelques-uns (des individus), recensés comme ayant simplement des opinions “proches”, semblent sélectionnés pour des raisons tirées par les cheveux et peu pertinentes ». Simon Leys, pour sa part, répond que la liste établie pour Kirwan ne l’est pas uniquement en fonction de critères politiques, mais signale également des individus dont il est inapproprié de solliciter la collaboration en raison de leur « malhonnêteté » ou de leur « stupidité ».
Dans sa biographie politique d’Orwell, John Newsinger mentionne que l’auteur a manifesté à plusieurs reprises, à la fin des années 1940, son hostilité à toute tentative d’instaurer un « maccarthysme anglais ». Il indique également que, « lorsque l’IRD a été créé par le gouvernement travailliste, son but affiché est de mener des activités de propagande en faveur d’une troisième voie entre le communisme soviétique et le capitalisme américain. Il n’est absolument pas évident à l’époque qu’il s’agissait d’une arme des services secrets britanniques ».
L’année 1949, au cours de laquelle cette affaire a lieu, est également l’une des plus terribles de la Guerre froide. Staline est vieillissant et sa paranoïa ne cesse de s’aggraver ; l’URSS a mis au point l’arme atomique et termine son processus de satellisation des pays d’Europe de l’Est ; la guerre de Corée est sur le point de débuter ; et le Royaume-Uni grouille d’espions du NKVD (notamment les fameux Cinq de Cambridge). Orwell, très éloigné des sympathies soviétiques d’une partie de l’intelligentsia occidentale, a pu voir pendant la guerre civile espagnole le stalinisme au pouvoir à Barcelone, lors de la répression du Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM), de sensibilité antistalinienne, dont il était proche.
Le détail de cette affaire est notamment exposé dans le pamphlet Orwell devant ses calomniateurs, publié en 1997. Simon Leys aborde également la question dans la réédition de son essai Orwell ou l’horreur de la politique, concluant : « Le fait que, un demi-siècle après sa mort, Orwell ait pu encore être la cible d’une aussi crapuleuse calomnie montre bien quelle formidable et vivante menace il continue à présenter pour tous les ennemis de la vérité ».
Analyse de son Œuvre et de sa Pensée 🧠✍️
Au-delà de ses récits autobiographiques et de ses romans marquants, la pensée d’Orwell se déploie dans une riche production d’essais, révélant un esprit critique aiguisé et une préoccupation constante pour la clarté et la vérité.
La Critique de la Langue de Bois : « Politics and the English Language » 📝🚫
Dans un manifeste intitulé « Politics and the English Language » (1946), Orwell critique sévèrement la presse britannique pour son « style ampoulé » (inflated style) et sa propension à utiliser des mots détournés de leur sens premier. Selon lui, tout cela contribue à brouiller le sens des idées. Orwell préconise que les gens de lettres s’en tiennent à une « langue dépouillée » (plain English), évitant les euphémismes, les allusions et les tournures interro-négatives.
Orwell vise essentiellement le discours politique, qu’il décrit comme étant « conçu pour faire passer le mensonge comme véridique, l’assassinat respectable, et conférer à ce qui n’est que du vent une apparence de crédit ». Pour illustrer son propos, Orwell cite cinq auteurs qu’il juge fautifs, puis propose une réécriture d’un verset de l’Ecclésiaste dans ce qu’il appelle « cet anglais moderne de la pire espèce ».
En conclusion de son article, il formule six règles qui, bien qu’elles n’empêchent pas absolument les discours fumeux, serviront de guide aux auteurs sincères :
- N’utilisez jamais de métaphore, d’analogie ou d’autre figure de style que l’on trouve trop souvent dans l’imprimé. Orwell cite en exemple des métaphores qu’il juge désuètes, employées trop souvent sans que l’auteur en connaisse la portée exacte ou le sens originel, telles que « arrondir les angles », « talon d’Achille », « chant du cygne » et « foyer » (d’agitation).
- N’utilisez jamais un mot long là où un mot plus court conviendrait aussi bien.
- S’il est possible de supprimer sans dommage un mot dans une phrase, supprimez-le.
- N’utilisez jamais la voix passive si vous pouvez employer une tournure active.
- Bannissez les expressions de langue étrangère, les mots scientifiques ou le jargon si vous trouvez un équivalent en anglais courant.
- Renoncez à n’importe laquelle de ces règles plutôt que d’écrire une phrase incompréhensible.
Orwell et l’Espéranto : La Genèse de la Novlangue de 1984 🗣️🔗
Une théorie, issue d’une publication d’un membre du centre d’espéranto de Londres en 1984, suggère qu’Orwell n’aurait pas apprécié l’espéranto et l’aurait utilisé comme modèle pour la novlangue de son roman 1984. Cependant, les sources indiquent que l’espéranto comme source de la novlangue demeure douteux.
Le but de la novlangue, tel que clairement défini par Orwell, était l’appauvrissement de la langue pour empêcher toute critique contre le système, selon l’idée que l’on ne peut concevoir quelque chose que si l’on peut l’exprimer. Cela diffère totalement de l’espéranto, dont la possibilité d’associer racines et affixes multiplie, au contraire, le nombre de mots et, en conséquence, nuance presque sans limite les manières de s’exprimer.
L’origine de la novlangue tient surtout à la connaissance par l’auteur du terrorisme politique, médiatique et linguistique des empires hitlérien et stalinien. Orwell avait recueilli des témoignages directs par l’intermédiaire de ses amis de la gauche travailliste et du POUM en Espagne. Par exemple, Hitler préconisait un enseignement de l’allemand pour les peuples slaves et juifs limité uniquement à la compréhension des ordres donnés dans cette langue. Ces observations réelles de la manipulation du langage à des fins totalitaires ont donc servi de fondement bien plus solide à la création de la novlangue que l’espéranto.
Conclusion : Un Auteur Indispensable pour Comprendre le Monde Contemporain 💡✨
George Orwell, ou Eric Arthur Blair, fut un homme dont la vie fut intrinsèquement liée à ses convictions et ses luttes. De son service dans la police impériale en Birmanie, qui le forgea en ennemi de l’impérialisme, à ses immersions dans les bas-fonds de Londres et Paris, qui aiguisèrent son sens de la justice sociale, chaque étape de son parcours l’a conduit à une compréhension profonde des mécanismes de l’oppression. Son expérience de la guerre d’Espagne, en particulier, lui fit prendre la mesure de la menace totalitaire, qu’elle soit nazie ou stalinienne, et orienta l’ensemble de son œuvre sérieuse contre ces idéologies.
Ses écrits, notamment La Ferme des animaux et 1984, sont devenus des classiques intemporels, alertant sur les dangers de la surveillance de masse, de la manipulation de la vérité et de l’asservissement de la pensée. Le concept de « Big Brother » et l’adjectif « orwellien » sont des preuves éloquentes de la perspicacité de sa vision et de son impact durable sur le langage courant.
Malgré les polémiques posthumes, notamment l’affaire des « cryptocommunistes », il demeure un fervent défenseur de la liberté d’expression et de la recherche de la vérité. Sa critique de la « langue de bois » dans « Politics and the English Language » offre des outils précieux pour déjouer les manipulations du discours. Orwell nous a laissé une œuvre qui, au-delà de sa valeur littéraire, constitue une boussole essentielle pour naviguer dans un monde complexe et résister aux menaces toujours présentes contre la liberté et la démocratie. Son héritage continue d’inspirer et de provoquer la réflexion sur les défis auxquels nos sociétés sont confrontées.