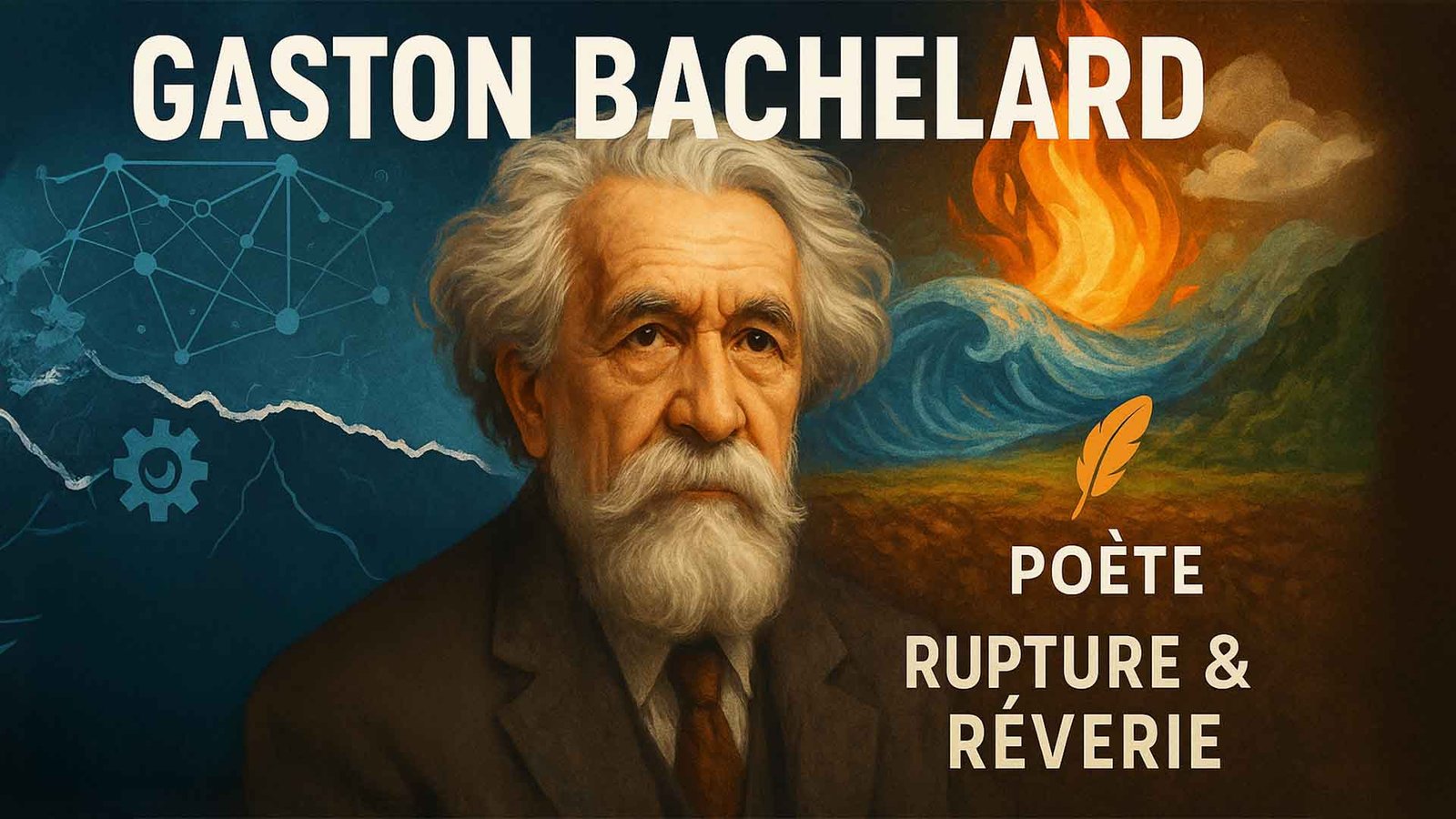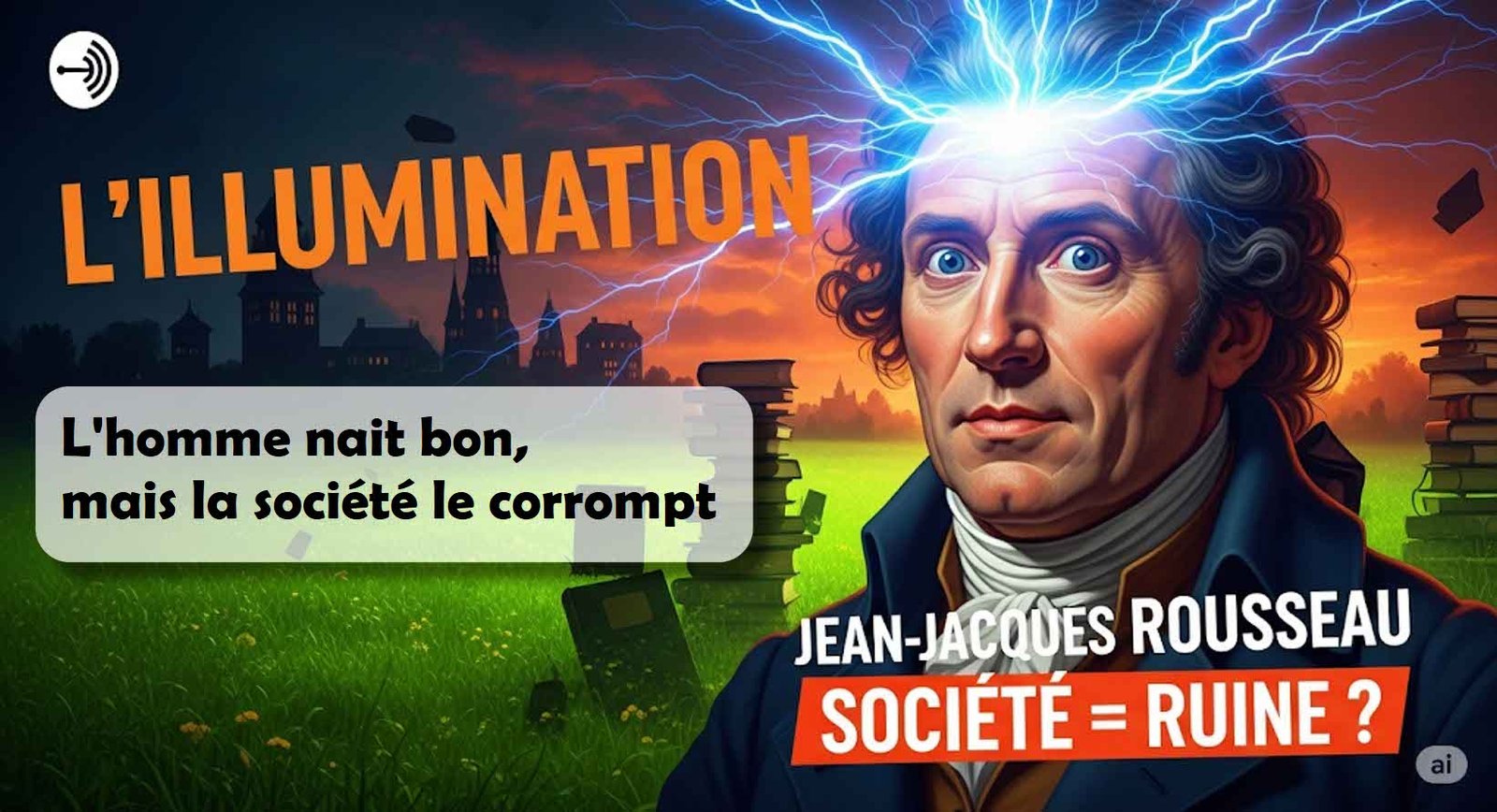Gaston Bachelard : L’Esprit Qui a Réinventé la Science et la Rêverie 🧠✨
Gaston Louis Pierre Bachelard (1884-1962) est une figure majeure et singulière de la philosophie française du XXe siècle. Son œuvre, d’une richesse et d’une originalité remarquables, traverse des domaines aussi variés que la philosophie des sciences, la poésie, l’éducation et même la conception du temps. Reconnu comme l’un des principaux représentants de l’école française d’épistémologie historique, il a su briser les frontières traditionnelles entre la rationalité scientifique et la profondeur de l’imaginaire. Cet article explore la vie, les idées novatrices et l’héritage durable de ce penseur qui a su poser un regard neuf sur la connaissance et la création.
Une Vie Façonnée par la Diversité des Expériences 🛤️📚
La trajectoire de Gaston Bachelard est loin d’être celle d’un philosophe classique, issu d’une lignée académique directe. Son parcours personnel, marqué par des expériences variées et souvent inattendues, a profondément nourri sa pensée, lui offrant une perspective unique sur le monde et la connaissance.
Des Origines Modestes à l’Érudition : Le Parcours Initial (1884-1919) 🧒📜
Né le 27 juin 1884 à Bar-sur-Aube, Gaston Bachelard grandit dans un milieu modeste, son père étant cordonnier et sa mère d’abord sans profession, puis dépositaire de journaux et de tabac. Cette appartenance à la ruralité et au peuple, qu’il revendiquera toute sa vie, jusqu’à la Sorbonne, a façonné sa sensibilité.
Son éducation débute au collège de Bar-sur-Aube en 1896, où il suit la filière moderne, moins prestigieuse que les humanités. Malgré un parcours scolaire excellent, il doit interrompre ses études une fois le baccalauréat philosophie en poche. Trente-six ans plus tard, il critiquera ces cursus jugés trop courts, véhiculant des « vérités scolaires à courte vue » et incapables de former en profondeur. C’est de cette expérience que naîtront ses concepts de « formation tout au long de la vie » et de « formation continuée pour les scientifiques », considérant le savant comme un écolier perpétuel.
Initialement répétiteur au collège de Sézanne de 1902 à 1903, Bachelard se détourne rapidement de l’enseignement qu’il juge trop conservateur. Fasciné par les grandes découvertes scientifiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (radioactivité, mécanique quantique, relativité, électromagnétisme, télégraphie sans fil), il embrasse une carrière postale pour vivre au quotidien la « révolution télégraphique ». De 1903 à 1905, il est surnuméraire des Postes et Télégraphes à Remiremont, travaillant soixante heures par semaine tout en préparant un baccalauréat scientifique. Cette décennie d’expérience dans le domaine postal sera déterminante pour l’élaboration de sa pensée, lui permettant de donner une dimension technologique au savoir scientifique et de penser le risque de la raison face à l’invention. C’est à Remiremont que naissent ses concepts de « rupture », de « brisure » et de « césure » entre les idées et les images.
De 1905 à 1907, il effectue son service militaire comme cavalier télégraphiste, puis poursuit sa carrière postale à Paris, rêvant de devenir ingénieur des Postes et Télégraphes. Il obtient une double licence en mathématiques, physique et chimie, mais la Première Guerre mondiale brise son rêve d’ingénierie et le conduit vers l’enseignement, non sans regret. Mobilisé en août 1914, il passe 38 mois dans les tranchées des unités combattantes et reçoit la Croix de guerre.
Durant cette période, il se marie en juillet 1914 avec Jeanne Rossi, directrice d’école. Il la remplace même comme instituteur de classe unique pendant une permission, une expérience concluante qui renforce son attachement indéfectible à l’école.
L’Émergence d’un Philosophe et Professeur (1919-1940) 👨🏫🎓
Démobilisé en mars 1919 et sans emploi, Bachelard obtient en octobre un poste de professeur de physique et de chimie au collège de Bar-sur-Aube. Sa fille Suzanne naît le 18 octobre de la même année. Malheureusement, sa femme meurt prématurément en juin 1920. Bachelard élève alors seul sa fille, Suzanne Bachelard, qui deviendra elle-même une mathématicienne et philosophe reconnue. Ce dévouement familial, allant à l’encontre des stéréotypes sexistes de l’époque, souligne son souci de l’épanouissement de sa fille et sa vision féministe.
À 36 ans, débute sa carrière philosophique inattendue. Agrégé en 1922, il soutient ses thèses de doctorat ès lettres à la Sorbonne en 1927, sous la direction d’Abel Rey et Léon Brunschvicg. Ces thèses seront publiées, marquant le début de sa reconnaissance académique. Il devient chargé de cours à la faculté des lettres de Dijon en octobre 1927, tout en restant au collège de Bar-sur-Aube jusqu’en 1930. Son engagement pour l’éducation se manifeste par sa participation aux élections municipales de 1929, où il défend le projet d’un collège pour tous. Par la suite, il accompagne sa fille Suzanne dans ses études supérieures, adaptant ses propres choix de carrière pour faciliter les siennes, notamment en acceptant un poste de professeur à l’Université de Bourgogne quand elle entre dans le second degré, et à la Sorbonne en 1940 quand elle y commence ses études supérieures.
La Consécration et l’Héritage (1940-1962) 🏆🌟
En 1940, Gaston Bachelard est nommé professeur à la Sorbonne, où il occupe la chaire d’histoire et de philosophie des sciences, succédant à Abel Rey. Il devient également directeur de l’Institut d’histoire des sciences et des techniques (IHST). Durant cette période, il dirige la thèse de Jean Gosset, figure de la Résistance, qui mourra en déportation en 1944. Bachelard lui-même éprouve de fortes sympathies pour la Résistance, appréciant particulièrement le contenu subversif du poème « Liberté » de Paul Éluard en 1942, et tentant même d’intervenir pour sauver Jean Cavaillès, fusillé en 1944.
Sa carrière est jalonnée de reconnaissances : chevalier de la Légion d’honneur en 1937, officier en 1951, et commandeur en 1960. En 1954, il devient professeur honoraire à la Sorbonne. Il est élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 1955. En 1956, il est nommé commandeur de l’Ordre du Mérite postal, un clin d’œil à son passé. La consécration ultime arrive en 1961 avec l’obtention du Grand Prix national des Lettres. Gaston Bachelard décède à Paris le 16 octobre 1962 et est inhumé à Bar-sur-Aube, sa ville natale, aux côtés de sa fille Suzanne.
L’Épistémologue de la Rupture et du Non 🤯🔬
L’un des apports les plus significatifs de Bachelard à la philosophie concerne l’épistémologie, c’est-à-dire l’étude de la connaissance scientifique. Il y développe une approche profondément originale, en rupture avec les conceptions traditionnelles.
Le Concept d’Obstacle Épistémologique 🚧🧠
Dans son ouvrage « La Formation de l’esprit scientifique », Bachelard introduit le concept fondamental d’obstacle épistémologique. Il s’agit des entraves à la connaissance scientifique, souvent constituées par des « a priori notionnels » liés aux acquis préexistants, qu’ils soient d’ordre intellectuel, métaphorique ou psychologique. Ces obstacles peuvent séduire l’esprit du chercheur ou de l’élève, mais les empêchent de progresser dans la compréhension des phénomènes. Pour Bachelard, l’ignorance n’est pas une simple absence de savoir ou de la négligence, mais une « structure constituée de représentations cohérentes ». L’élève, par exemple, n’est pas ignorant par mauvaise volonté, mais parce qu’il est soumis à des représentations qui le ferment à de nouvelles manières de concevoir.
En complément, il forge le concept de « profil épistémologique » dans « La Philosophie du non », soulignant que les obstacles varient selon l’expérience du sujet. Il l’applique à des exemples tirés de la logique, de la physique, de la chimie ou des mathématiques, n’hésitant pas à prendre appui sur son propre parcours. Il collectionne et classe ces obstacles (méthodologiques, philosophiques, psychologiques) dans « La Formation de l’esprit scientifique », illustrant et analysant leur typologie.
La Rupture Épistémologique et la Discontinuité ⚡️📈
Bachelard est l’un des penseurs clés de l’épistémologie historique, et il s’oppose frontalement à la conception continuiste de l’histoire des sciences, héritée du positivisme d’Auguste Comte. Pour lui, l’histoire des sciences n’est pas un progrès linéaire et cumulatif, mais une succession de ruptures, de « brisure, de césure, de coupure et de fracture ». Ces ruptures marquent des moments où la science se détache du sens commun et des théories antérieures, pour construire de nouvelles connaissances radicalement différentes. Cette vision discontinuiste est proche de celle d’Alexandre Koyré et, plus tard, de Thomas S. Kuhn.
En critiquant la conception bergsonienne de la continuité du temps dans « L’Intuition de l’instant » et « La Dialectique de la durée », Bachelard affirme que le temps est une « suite d’instants ». La durée n’est qu’une construction de la volonté, et le temps ne « dure qu’en inventant ». La continuité psychique est ainsi « non pas une donnée, mais une œuvre ».
La Philosophie du Non et le Surrationalisme 🚫💡
La « Philosophie du non » de Bachelard est une tentative de penser les conséquences philosophiques des révolutions scientifiques du début du XXe siècle, notamment la géométrie non-euclidienne et la mécanique non-newtonienne. Pour Bachelard, la science moderne ne peut plus être décrite par les philosophies traditionnelles (empirisme, rationalisme, matérialisme, idéalisme prises individuellement). Il propose un « polyphilosophisme » ou une « philosophie du non », où chaque nouvelle théorie scientifique d’importance doit s’accompagner d’une nouvelle philosophie et d’une nouvelle métaphysique. La « généralisation du non » inclut ce qu’elle nie, et l’essor de la pensée scientifique provient de ces « généralisations dialectiques avec enveloppement de ce qu’on nie ». C’est une négation constructive et enveloppante.
Cette approche mène au concept de « surrationalisme » ou « rationalisme dialectique », qui multiplie les occasions de penser en redonnant à la raison humaine sa fonction de « turbulence et d’agressivité ». Le « surrationalisme » est le centre d’un spectre épistémologique, entre l’idéalisme et le réalisme. Pour Bachelard, les instruments scientifiques sont des « théories matérialisées », qu’il nomme « phénoménotechnique ». Cela signifie que toute théorie est intrinsèquement liée à une pratique.
Le Nouvel Esprit Scientifique : Une Révolution Copermicienne 🌌🔄
Dans son œuvre majeure « Le Nouvel Esprit scientifique » (1934), Bachelard dépasse le débat séculaire entre empirisme et rationalisme. Pour lui, « la science crée de la philosophie ». Il renverse la tradition qui faisait de la philosophie la reine des sciences, affirmant que c’est la science qui « donne du grain à moudre aux philosophes ». Cette « révolution copernicienne » positionne Bachelard comme un précurseur du constructivisme épistémologique.
Un aspect essentiel de son épistémologie est l’importance du « sens du problème ». Il soutient que les problèmes scientifiques ne se posent pas d’eux-mêmes et que « toute connaissance est une réponse à une question ». Pour l’esprit scientifique, « rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit ». Cette vision souligne l’activité et la construction nécessaires à l’acquisition de la connaissance scientifique, s’opposant à une conception passive de l’apprentissage.
La Poétique de l’Imaginaire et de la Rêverie 💭📜
Au-delà de son rôle d’épistémologue, Gaston Bachelard a profondément renouvelé l’approche philosophique et littéraire de l’imagination. Il a exploré les liens complexes, parfois conflictuels, parfois complémentaires, entre l’imaginaire et la rationalité.
L’Exploration de l’Imagination Créatrice 🎨✍️
À partir de 1937, Bachelard se tourne vers l’étude de l’imaginaire poétique. Il s’intéresse à une multitude d’artistes, poètes (Lautréamont, Edgar Allan Poe, Novalis, Henri Bosco, Hölderlin), écrivains, peintres (Marc Chagall, Claude Monet, Jean Revol), sculpteurs et graveurs. Il explore également le symbolisme et l’alchimie.
Pour Bachelard, une image au fort pouvoir affectif peut être un obstacle pour le scientifique, en provoquant des illusions (comme l’image du feu obstruant la connaissance de l’électricité). Cependant, cette même image produit en littérature des effets inattendus et poétiquement surchargés, dotés d’un pouvoir de fascination considérable. La rêverie poétique « sympathise » intimement avec le réel, tandis que l’approche scientifique est « antipathique », prenant ses distances avec la charge affective.
Dans une conférence de 1954, « Le dormeur éveillé », Bachelard affirme que « Notre appartenance au monde des images est plus forte, plus constitutive de notre être que notre appartenance au monde des idées ». Il plaide pour les douceurs de la rêverie et développe une « métapoétique », un projet de discours philosophique sur la poésie qui vise à fonder une analyse littéraire descriptive et objective, notamment par la classification des métaphores.
Les Quatre Éléments comme Sources d’Inspiration 💧🔥🌬️🌍
Bachelard classe les inspirations poétiques en quatre catégories, reprenant les quatre éléments des Anciens et des alchimistes : l’eau, le feu, l’air et la terre. Ces catégories ne sont pas de simples classifications, mais des méthodes poétiques et psychanalytiques d’approche des textes littéraires.
Sa série d’ouvrages dédiés aux éléments commence par « La Psychanalyse du feu » (1938), puis « L’Eau et les rêves », « L’Air et les Songes », « La Terre et les Rêveries du repos », et « La Terre et les Rêveries de la volonté », pour s’achever avec « La Flamme d’une chandelle », une autobiographie qui revisite l’élément qui le fascine le plus. Sa fille, Suzanne Bachelard, éditera même une œuvre posthume, « Fragments d’une Poétique du Feu », portant le total à trois ouvrages sur le feu.
- Le Feu 🔥: Symbolisant la consumation totale du moi dans la nature, le feu est particulièrement présent dans le courant romantique. Bachelard l’évoque à travers Héraclite (le feu comme principe universel en devenir), Empédocle (qui se jeta dans l’Etna), Novalis (dont la poésie est un effort pour revivre la primitivité), Hölderlin et Goethe (Werther). Les poètes animés par la « salamandre » partagent cette volonté de dispersion du moi dans les choses, une « mort cosmique » où un univers entier s’anéantit avec le penseur. La « flamme d’une chandelle » devient une « nourriture de verticalité, un aliment verticalisant », donnant un sens vital aux déterminations poétiques.
- L’Eau 💧: L’imaginaire de l’eau est lié à la maternité et à la rêverie. Bachelard analyse l’œuvre d’Edgar Allan Poe dans « L’Eau et les Rêves », et commente Novalis, pour qui l’eau est une « flamme mouillée », montrant l’interconnexion des éléments dans l’imaginaire poétique. L’eau berce le rêveur, le protège, le transporte, comme une « Grande Mère Nature ».
- L’Air 🌬️: L’air est associé à l’élévation, la légèreté et la mobilité. Bachelard consacre de longs passages à Nietzsche (« le type même du poète vertical, du poète des sommets, du poète ascensionnel »), Shelley, Balzac et Rilke. L’esthétique nietzschéenne de la légèreté s’oppose à la « lourdeur névrotique », et le poète de l’air se meut dans la douceur, transporté et protégé, contrairement à la dissolution passionnée du poète du feu. L’air et le feu partagent néanmoins l’idée d’élévation et d’ascension.
- La Terre 🌍: L’imaginaire de la terre, exploré dans « La Terre et les Rêveries du repos » et « La Terre et les Rêveries de la volonté », est profondément lié aux racines et à l’ancrage. Bachelard, lui-même un « terrien » aux liens marqués pour la terre et ses fruits, aimait les longues randonnées et la proximité avec la nature. Son enfance rurale à Bar-sur-Aube, son attachement à la Place Maubert à Paris comme à un « village », et ses promenades dans les collines autour de Voigny, témoignent de cette affinité.
La Rêverie : Un Monde Indépendant de la Raison 🌠🧘
Pour Bachelard, le monde de la rêverie, de l’imagination et de la poésie est celui de l’image, « indépendant du monde rationnel du concept ». Il affirme qu' »Il faut donc accepter une véritable rupture entre la connaissance sensible et la connaissance scientifique ». C’est à cette condition que l’Homme peut atteindre une « physique de la sérénité » et « devenir un être en harmonie parfaite avec le cosmos ».
La rêverie poétique est une « rêverie cosmique » qui donne au moi un « non-moi » enchantant, permettant au rêveur de « vivre [sa] confiance d’être au monde ». Cette position peut être interprétée comme une adéquation avec les philosophies de Spinoza et Einstein, où la liberté humaine consiste à choisir les moyens de se situer dans l’espace-temps. Bachelard croit même que « l’univers pense le sujet ». L’homme, par la rêverie, se dilate au cosmos et s’y fond, rejoignant sa « vraie nature cosmique ».
Un Penseur Engagé dans l’Éducation et la Société 🍎🌍
L’œuvre de Bachelard n’est pas seulement théorique ; elle est profondément ancrée dans une réflexion sur l’éducation et sur des questions de société, révélant un humanisme éclairé et un sens aigu des injustices.
La Pédagogie Bachelardienne : L’Erreur comme Progrès 💡🌱
La pédagogie occupe une place centrale dans la philosophie de Bachelard. Il se considère avant tout comme un « professeur de sagesse » et non un simple sage, avouant en 1949 être « sans doute plus professeur que philosophe ». Son attachement à son expérience pédagogique est tel qu’elle est la « source de l’épistémologie historique » et éclaire la construction des connaissances. Les concepts de « formation », « refonte » et « réorganisation » ont ainsi une double face, pédagogique et épistémologique.
Un des piliers de sa pédagogie est la réévaluation de l’erreur. Contrairement à la science déterministe qui éliminait les problèmes et considérait l’erreur comme une faute, le « nouvel esprit scientifique » (et pédagogique) voit la connaissance comme une « erreur rectifiée » et la compréhension comme un « malentendu surmonté ». Pour Bachelard, l’ignorance d’un élève n’est pas due à la négligence, mais à des représentations préexistantes qui l’empêchent de progresser. C’est pourquoi la « bienveillance magistrale » n’est pas seulement une vertu, mais une « nécessité pédagogique » pour aider les élèves à vaincre leurs résistances.
Bachelard préconise une psychanalyse bachelardienne pour éliminer les obstacles à la connaissance, non pas une reconstruction freudienne, mais un « déplacement des intérêts subjectifs et la réorientation du regard de l’image vers l’objet », un travail cathartique de purification des représentations.
Construire une Pédagogie du Non et de la Coopération 🤝🔄
Dès ses débuts, Bachelard s’est éloigné de l’enseignement traditionnel, jugeant son conservatisme inacceptable. Il promeut l’ouverture à l’expérimentation, aux découvertes et aux inventions, car « on ne s’instruit qu’en construisant ». Il critique le professeur qui se contente de reproduire son capital culturel et « exige l’obéissance aveugle ». Face à cet autoritarisme, Bachelard considère la désobéissance comme un atout et prône une relation professeur/élèves « dialectique et féconde », résumée par la formule « qui enseigne est enseigné ». Cette réciprocité rend l’apprentissage indissociable de sa transmission.
Grâce à sa polyvalence et à ses observations d’enfants, Bachelard développe une démarche respectueuse du sujet et de son développement. Il s’appuie sur les besoins manifestes des enfants, intégrant le positif comme le négatif dans la construction des apprentissages. Il critique les « matériaux pauvres et uniformes » offerts aux enfants, le « bridage de leur spontanéité », l’inadéquation des rythmes scolaires et les pratiques punitives. Il prône l’éveil de l’intelligence scientifique par des « situations-problèmes ».
Il s’intéresse également aux travaux psychiatriques pour comprendre les « aberrations » et les « troubles » de l’esprit. Inspiré par Alfred Korzybski, il attribue la schizophrénie à un langage trop figé et des concepts enkystés, soulignant la nécessité de « découvrir et d’inventer » en permanence. Il valorise la « méthode du labyrinthe », qui confronte le sujet à des choix multiples et une « pluralité d’interprétations », l’obligeant à s’ouvrir à l’invention. Pour lui, c’est une « pédagogie active » et la pratique des mathématiques qui sauvent l’esprit de ses égarements. Il étend sa réflexion aux troubles du comportement et handicaps sensoriels, insistant sur l’importance de la coopération et la mutualisation dans la construction des apprentissages, préfigurant l’idée d’une « intelligence collective ».
Sensibilités Sociales et Écologiques 💚⚖️
Bachelard se distingue par son profond humanisme. Son origine sociale modeste le rapproche du peuple et le rend méfiant envers les puissants. Il rappelle en 1961 qu’il n’habitait pas « la Champagne des riches marchands de champagne » et préférait les « travailleurs de la matière » ou « l’union des travailleurs de la preuve » aux oisifs et aux politiques soucieux de leur puissance.
Il possède une « fibre sociale » et s’inspire du solidarisme de Léon Bourgeois pour préconiser une « technique sociale » visant à « supprimer ou amoindrir cette misère faite d’injustices sociales évidentes ». En tant que non-héritier, il sait que pour les gens du peuple, « rien n’est donné et tout est à construire ».
Sa sensibilité s’étend à l’écologie. Il déplore l' »outrage à la nature » des rivières souillées par les égouts et usines, s’indignant du spectacle affligeant des « fontaines souillées dans nos campagnes ». Il met en garde contre les risques d’un usage « irréfléchi de la puissance scientifique ».
Engagement Citoyen et Résistance ✊🇫🇷
Bien que la question politique ne soit pas au cœur de ses préoccupations majeures, Bachelard fait des choix éthiques forts. Outre sa participation infructueuse au conseil municipal de Bar-sur-Aube, il n’a pas d’engagement politique notable. Cependant, il subit l’occupation allemande en 1940 et éprouve de fortes sympathies pour la Résistance. Il est proche des philosophes de la Résistance, notamment Jean Cavaillès, pour qui il interviendra personnellement et à qui il rendra un hommage appuyé en 1950.
Les Influences et la Postérité d’une Pensée Complexe 🌐📚
L’œuvre de Gaston Bachelard, par sa profondeur et son originalité, a marqué durablement la philosophie, la pédagogie et les sciences humaines, tout en dialoguant avec les grands courants de pensée de son temps.
Dialogue avec l’Épistémologie Française et Allemande 🇫🇷🇩🇪
Bachelard s’inscrit dans la lignée de l’épistémologie française, s’inspirant du positivisme d’Auguste Comte pour une approche méthodique et historique de la science, tout en s’opposant à sa conception continuiste. Il remplace la loi des trois états de Comte par sa propre vision du processus scientifique : « réalisme naïf », « rationalisme » et « surrationalisme » (ou « rationalisme dialectique »).
Il critique la conception du temps et du réel de Bergson, mais reconnaît l’influence de la philosophie bergsonienne de la mobilité dans des ouvrages comme « L’Air et les Songes ». Sa philosophie des sciences est également proche de celle de Ferdinand Gonseth concernant la logique mathématique.
Jean-Jacques Wunenburger décrit la pensée de Bachelard comme une « pensée rhénane » qui fait communiquer la tradition française (clarté, rationalité analytique) avec la tradition allemande (poésie, images synthétiques de la Nature). Bachelard est à la fois positiviste en philosophie des sciences et romantique en philosophie de la poésie, cherchant à réduire le fossé entre ces deux traditions.
Il reprend à Kant l’idée que la théorie est logiquement antérieure à l’expérience et l’informe, mais critique le caractère a priori (universellement valide) des catégories kantiennes, soulignant que les théories sont souvent erronées et que la science avance par correction continuelle. De Hegel, il retient l’idée d’une rationalité « dialectique », en mouvement, et une connaissance scientifique faite d’allers-retours entre raison et expérience. Cependant, il critique le caractère « clos » du système hégélien et propose une « raison ouverte » qui se réforme et produit constamment de nouvelles connaissances.
Psychanalyse : Outil d’Épistémologie et de Poétique 🛋️💭
Les travaux psychanalytiques ont profondément inspiré Bachelard, qui réinterprète les conceptions freudiennes (inconscient, censure, rêve, libido) pour les appliquer à la fois à son épistémologie (« psychanalyse de la connaissance objective ») et à sa poétique (« psychanalyse de l’imagination subjective »). Bien qu’il introduise la psychanalyse dans sa pensée dès 1938 avec « La Psychanalyse du feu » et « La Formation de l’esprit scientifique », il s’appuie davantage sur les idées de Carl Gustav Jung, Marie Bonaparte, Françoise Dolto et Charles Baudouin que sur Freud lui-même.
De Jung, il reprend la théorie des symboles et la notion d’archétype, ce qui le conduit à considérer l’imaginaire, et non la perception, comme l’origine première de la vie psychique. Il décrit et classe les catégories de la rêverie, affirmant la rupture entre le monde de l’image et le monde rationnel du concept.
Bachelard admet l’inconscient freudien et jungien et admire l’œuvre de Robert Desoille, y voyant des contributions à la « puissance créatrice de l’être humain ». Pour lui, l’homme est « ergothérapeute de soi » et c’est dans la solitude que l’Homme se rapproche de sa « vraie nature cosmique ». Par la rêverie, l’être se dilate au cosmos et s’y fond, mais aussi, par l’abstraction, adhère au cosmos. Pour Bachelard, l’individu est un moyen de prospection dans l’univers, non une fin, car « l’univers pense le sujet ».
Divergences avec l’Épistémologie Viennoise 🇦🇹🚫
Bachelard et les philosophes français des sciences ont eu des désaccords profonds avec l’empirisme logique du Cercle de Vienne. Ces désaccords concernent le statut de la logique et des mathématiques (qui ne seraient pas une syntaxe universelle), et le rôle de l’observation, de l’expérimentation, des outils et instruments dans le processus scientifique.
L’empirisme logique prône un « désengagement ontologique radical », abandonnant la métaphysique et la question du « pourquoi ? » au profit de l’analyse et de la construction logique des énoncés. Il délaisse également l’étude du contexte historique, social et politique de la découverte scientifique. À l’inverse, Bachelard et ses successeurs (Canguilhem, Althusser, Foucault) étudient les mentalités et idéologies liées aux théories scientifiques.
Pierre Jacob résume les quatre thèses essentielles retenues par les héritiers de Bachelard :
- Les instruments scientifiques sont des « théories matérialisées » (la « phénoménotechnique »), ce qui signifie que toute théorie est une pratique.
- Toute étude épistémologique doit être historique.
- Il existe une double discontinuité : entre le sens commun et les théories scientifiques, et entre les théories scientifiques successives (la « rupture épistémologique »).
- Aucune philosophie traditionnelle ne peut décrire adéquatement les théories de la physique moderne (le « polyphilosophisme » ou « philosophie du non »).
L’Héritage Pédagogique et Épistémologique 🏫🔬
Les propositions audacieuses de Bachelard en pédagogie ont eu une influence décisive sur la construction d’une pédagogie moderne. Elles ont contribué à la création des sciences de l’éducation grâce à son élève Gaston Mialaret. Elles ont également engendré deux axes didactiques majeurs :
- Les sciences : Avec les travaux de Jean-Pierre Astolfi sur les obstacles pédagogiques aux apprentissages.
- Les arts : Avec les recherches sur la formation poétique de Georges Jean, sur l’imaginaire de Gilbert Durand, et sa construction par Bruno Duborgel.
Cette pédagogie renouvelée a servi de lien entre les sciences et l’épistémologie, et à repenser l’esthétique. Bachelard, qui ne séparait jamais la connaissance de l’expérimentation et la pensée de l’action, a toujours considéré l’école comme trop importante pour être confiée au monde de la finance et de l’industrie. Fidèle à Jules Ferry, il a défendu une « société faite pour l’école » qui promeut l’égalité de droit et l’accès au savoir pour tous.
Sa philosophie a profondément influencé l’épistémologie historique et la sociologie françaises, avec des penseurs tels que Koyré, Althusser (qui développa la notion de « coupure épistémologique »), Canguilhem (qui s’intéressa aux sciences biologiques et médicales), Simondon (qui tenta une synthèse bergsonisme/bachelardisme), Foucault, Dagognet et Bourdieu. Michel Serres a même qualifié Bachelard de « dernier des symbolistes », saturant l’espace de symboles au croisement de la science et de la culture.
L’Influence sur l’Herméneutique et la Philosophie de l’Imagination 📚✨
Les réflexions de Bachelard sur l’imagination, la poésie et le symbolisme, teintées de surréalisme, ont marqué des penseurs de l’herméneutique et de la philosophie postmoderne. Ricœur lui rend hommage pour sa « phénoménologie de l’imagination ». Deleuze, bien que discutant son interprétation de Nietzsche (terrestre vs. aérien), s’en inspire également. Peter Sloterdijk prolonge explicitement les analyses de Bachelard sur l’imaginaire aquatique dans sa trilogie des « Sphères », citant « L’Eau et les Rêves » en incipit. L’anthropologue culturel Gilbert Durand a également été influencé par ses travaux sur l’imaginaire. Même le cinéaste et écrivain Alejandro Jodorowsky affirme avoir été marqué par son enseignement sur l’alchimie.
La Question de la Métaphore et les Critiques 🗣️❓
Jacques Derrida a critiqué le projet métapoétique de Bachelard dans le cadre d’une étude de la métaphore. Pour Derrida, la tradition philosophique, dont Bachelard est fidèle sur ce point, a toujours cherché à dominer la métaphore, à la rationaliser et à la cantonner à un domaine contingent. Or, pour Derrida, aucun discours, y compris philosophico-scientifique, ne peut échapper à la métaphore, car elle traverse l’ensemble du discours. La classification des métaphores par Bachelard présuppose une distanciation rationnelle que Derrida juge impossible, car la « philosophie, comme théorie de la métaphore, aura d’abord été une métaphore de la théorie ».
Cependant, Bachelard lui-même a évolué sur cette question, comme en témoigne « La Poétique de la rêverie », où il déclare : « L’image ne peut être étudiée que par l’image, en rêvant les images telles qu’elles s’assemblent dans la rêverie. C’est un non-sens que de prétendre étudier objectivement l’imagination, puisqu’on ne reçoit vraiment l’image que si on l’admire ». Ceci suggère une reconnaissance plus profonde de l’impossibilité d’une analyse purement rationnelle de l’imaginaire.
Conclusion : Un Penseur Indispensable pour Comprendre la Connaissance et l’Imaginaire 🔚🌟
Gaston Bachelard restera une figure incontournable de la pensée contemporaine. Son parcours atypique, de cordonnier à professeur à la Sorbonne, en passant par le métier de télégraphiste et les tranchées, lui a conféré une perspective unique sur la complexité de l’expérience humaine.
Il a non seulement révolutionné l’épistémologie en introduisant des concepts fondamentaux comme l’obstacle épistémologique et la rupture épistémologique, mais il a également ouvert de nouvelles voies dans la philosophie de l’imaginaire, en explorant la rêverie et les quatre éléments comme sources d’inspiration poétique. Sa philosophie du non a poussé à repenser les fondements mêmes de la connaissance scientifique, en affirmant que « rien n’est donné, tout est construit ».
Au-delà de ses contributions théoriques, Bachelard fut un pédagogue passionné, qui voyait dans l’erreur une source de progrès et prônait une « pédagogie du non » axée sur la coopération et l’éveil de la curiosité. Son humanisme se manifeste par son soutien à l’autonomie féminine, sa sensibilité sociale et son souci écologique.
L’héritage de Bachelard est immense et continue d’inspirer chercheurs, éducateurs et artistes à travers le monde. Son œuvre nous invite à une compréhension plus profonde et dialectique des rapports entre la raison et l’imagination, entre la science et la poésie, offrant des outils conceptuels précieux pour naviguer dans la complexité de notre monde. Il demeure un guide essentiel pour quiconque cherche à « multiplier les occasions de penser ».